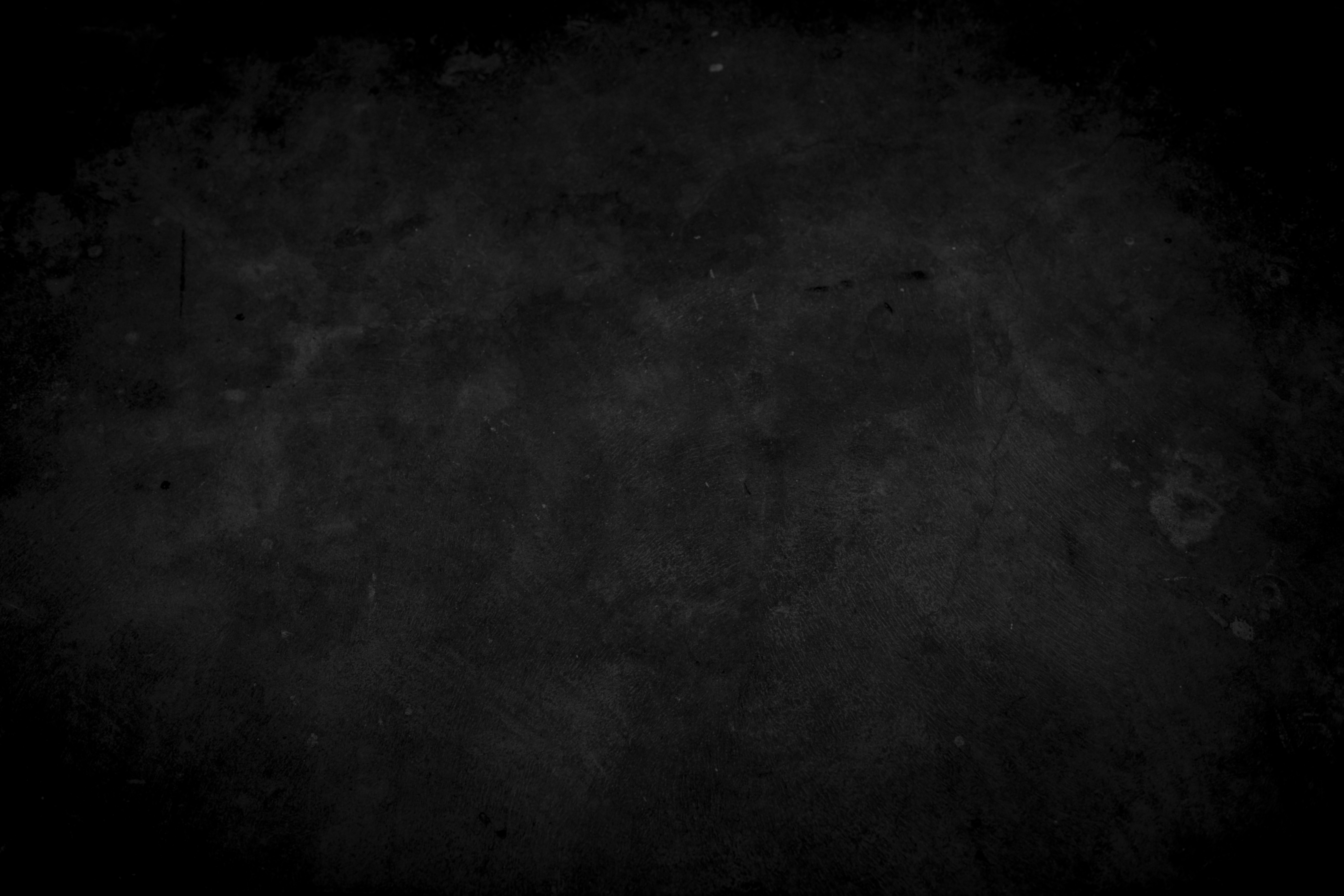Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Diagnostic "Culture et création en mutations"
ICOM France relaie l'enquête du projet de diagnostic sur les métiers de la culture, piloté dans le cadre Plan d’investissement d’avenir - compétences et métiers d’avenir « Culture et créations en mutation 2CM »
Le diagnostic "Culture et création en mutations" vise à étudier les conséquences des mutations en cours qui touchent les métiers de la culture et de la création et leurs conséquences en matière de besoins et modalités de formation.
L’étude se déroule dans le cadre du PIA 4 compétences et métiers d’avenir, elle est menée par un consortium composé d’Hesam, du Cnam, de l’AFDAS, de Paris 1-école des arts de la Sorbonne, du campus des métiers et des qualifications de la mode, des métiers d’art et du design, du Centquatre et des Augures. Elle est dirigée par Lucie Marinier, professeure du CNAM, titulaire de la chaire d’ingénierie de la culture et de la création.
Quatre mutations sont plus particulièrement étudiées :
- La question écologique ;
- Les transitions numériques et l’innovation ;
- Les mutations des lieux/ espaces de culture (investissement de l’espace public, nouvelles missions des institutions culturelles, tiers lieux, en ligne/en présence) ;
- Les nouvelles questions posées à la création et à l’ingénierie culturelle par les questions de diversité, droits culturels, participation.
Elles font évoluer les organisations, les métiers, les compétences et la position socio-économique des ingénieurs culturels et des créateurs.
Plusieurs phénomènes, qui touchent les organisations, les projets culturels, les métiers, les compétences et la formation des créateurs comme des ingénieurs culturels semblent en découler, que l’étude s’attache à énoncer/observer/confirmer/infirmer/illustrer.
Un focus particulier sera mis sur les arts visuels, les arts appliqués et les musées.
L'étude s'achèvera en juillet 2023 et ouvrira sur un certain nombre de préconisations en matière de structuration de formation initiale et continue.
Durée estimée : 18 minutes
Date limite de participation : 12 juin 2023
Pour toute autre question/information, n'hésitez pas à contacter : faustine.dehan@hesam.eu
RGPD
Dans le cadre du Règlement Général de la protection des Données Personnelles, les données collectées feront l'objet d'un traitement anonymisé ayant pour seule finalité la réalisation de cette étude.
Conférence annuelle du comité international ICOMAM
Le thème de la conférence annuelle du comité international pour les musées d'armes et d'histoire militaire - ICOMAM - est "Histoire militaire et collections dans la société contemporaine : Perspectives, pratiques et rôle de l'État-nation".
Envoyez une soumission avec un résumé (max 300 mots) à Dimitri Minchev : drminchev@abv.bg
Date limite 30 juin 2023
Programme de la conférence :
Lundi 23 octobre 2023
- 09.00-15.00 Processus d'inscription
- 09.00-10.30 Réunion du Bureau
- 11.00-12.30 Séance d'ouverture
- 12.30 13.00 Dépôt de fleurs au Monument du héros inconnu
- 13.00-14.30 Déjeuner au CMC
- 15.00-16.30 Session de travail
- 16.30-19.00 Visite guidée de l'ancienne Sofia : Église Sainte Sofia souterraine, fouilles romaines dans le centre ville de Sofia. Si le temps le permet, visite du musée archéologique.
- 19.30 Dîner.
Mardi 24 octobre
- 09.00-10.30 Session de travail
- 10.30-11.00 Heure du café
- 11.00-12.30 Séance de travail
- 12.30 14.00 Déjeuner
- 14.00-15.30 Séance de travail
- 15.30-16.00 Heure du café
- 16.00-17.30 Visite du musée de la ville de Sofia
- 17.30-19.30 Temps libre
- 19.30-22.00 Dîner.
Mercredi 25 octobre
- 09.00-10.30 Session de travail
- 10.30-11.00 Heure du café
- 11.00-12.30 Session de clôture. Assemblée générale
- 12.30-14.00 Déjeuner
- 14.00-16.00 Visite du Musée national d'histoire militaire
- 16.00-21.30 Visite de l'Académie de défense G. S. Rakovski : programme culturel et dîner d'adieu.
Programme des visites post conférences :
Jeudi 26 octobre
- 08.30 Réunion à la cathédrale St. Alexander Nevski. Début du voyage d'étude en bus. Arrivée à Plovdiv.
- 10.30 12.30 Architecture néo-classique des bâtiments de Plovdiv
- 12.30-14.00 Déjeuner
- 14.00 Arrivée à l'hôtel.
- 15.00-19.00 Poursuite de la visite. Visite des musées et des sites de la ville de Plovdiv.
- 19.00-21.00 Dîner
Vendredi 27 octobre
- 08.00-09.00 Petit déjeuner
- 09.00-12.30 Excursion au monastère de Bachkovo. Le long de la route, visite de la forteresse d'Asen.
- 12.30-14.00 Déjeuner
- 14.00-16.00 Visite du musée de l'aviation
- 16.00-19.00 Temps libre.
- 19.00-21.00 Voyage à Sofia
Samedi 28 octobre
- 08.00-09.00 Petit déjeuner
- 09.30 Départ de l'hôtel. Voyage à Sofia
Retrouvez plus d'informations sur le site d'ICOMAM
Conférence annuelle du comité international ICOMAM
Le thème de la conférence annuelle du Comité international pour les musées d'armes et d'histoire militaire - ICOMAM - est "Histoire militaire et collections dans la société contemporaine : Perspectives, pratiques et rôle de l'État-nation".
Programme de la conférence :
Lundi 23 octobre 2023
- 09.00-15.00 Processus d'inscription
- 09.00-10.30 Réunion du Bureau
- 11.00-12.30 Séance d'ouverture
- 12.30 13.00 Dépôt de fleurs au Monument du héros inconnu
- 13.00-14.30 Déjeuner au CMC
- 15.00-16.30 Session de travail
- 16.30-19.00 Visite guidée de l'ancienne Sofia : Église Sainte Sofia souterraine, fouilles romaines dans le centre ville de Sofia. Si le temps le permet, visite du musée archéologique.
- 19.30 Dîner.
Mardi 24 octobre
- 09.00-10.30 Session de travail
- 10.30-11.00 Heure du café
- 11.00-12.30 Séance de travail
- 12.30 14.00 Déjeuner
- 14.00-15.30 Séance de travail
- 15.30-16.00 Heure du café
- 16.00-17.30 Visite du musée de la ville de Sofia
- 17.30-19.30 Temps libre
- 19.30-22.00 Dîner.
Mercredi 25 octobre
- 09.00-10.30 Session de travail
- 10.30-11.00 Heure du café
- 11.00-12.30 Session de clôture. Assemblée générale
- 12.30-14.00 Déjeuner
- 14.00-16.00 Visite du Musée national d'histoire militaire
- 16.00-21.30 Visite de l'Académie de défense G. S. Rakovski : programme culturel et dîner d'adieu.
Programme des visites post conférences :
Jeudi 26 octobre
- 08.30 Réunion à la cathédrale St. Alexander Nevski. Début du voyage d'étude en bus. Arrivée à Plovdiv.
- 10.30 12.30 Architecture néo-classique des bâtiments de Plovdiv
- 12.30-14.00 Déjeuner
- 14.00 Arrivée à l'hôtel.
- 15.00-19.00 Poursuite de la visite. Visite des musées et des sites de la ville de Plovdiv.
- 19.00-21.00 Dîner
Vendredi 27 octobre
- 08.00-09.00 Petit déjeuner
- 09.00-12.30 Excursion au monastère de Bachkovo. Le long de la route, visite de la forteresse d'Asen.
- 12.30-14.00 Déjeuner
- 14.00-16.00 Visite du musée de l'aviation
- 16.00-19.00 Temps libre.
- 19.00-21.00 Voyage à Sofia
Samedi 28 octobre
- 08.00-09.00 Petit déjeuner
- 09.30 Départ de l'hôtel. Voyage à Sofia
La Conservation du patrimoine musical dans les musées et les institutions d'Amérique latine et des Caraïbes
En tant que territoire, catégorie ou idée, l'Amérique latine a été un front commun en termes géopolitiques, économiques et culturels. Qu'est-ce que cela a représenté dans la conservation du patrimoine musical sauvegardé par nos musées et institutions ? Qu'entend-on par patrimoine dans les communautés multiples et diverses qui composent cette région ? Quelles sont les caractéristiques des lieux qui le sauvegardent, le conservent et le promeuvent ? Qui en est responsable et quels sont leurs profils ? Existe-t-il des programmes spécialisés pour leur sauvegarde ? Le "musée de la musique" est-il la seule figure qui nous permette d'appréhender de manière globale les significations de notre patrimoine musical ?
Ce ne sont là que quelques questions qui découlent de réflexions communes sur les différentes situations en Amérique latine. Chaque question soulève un univers de particularités qui méritent d'être partagées dans le cadre d'un colloque consacré à cette région.
C'est pourquoi le Conseil international des musées (ICOM) depuis ses sièges nationaux en Amérique latine et dans les Caraïbes, le Comité international des musées et collections d'instruments et de musique (CIMCIM) et l'Association internationale pour la protection du patrimoine culturel (ASINPPAC) vous invitent cordialement à participer à une réunion qui aura lieu du 10 au 12 juillet 2023, dont l'objectif sera de présenter des recherches et des cas sur l'organologie, la conservation, la restauration, la documentation, la diffusion, la muséographie et la collecte du patrimoine musical latino-américain, en particulier celui qui se trouve dans des collections privées ou publiques, des musées, des institutions académiques ou des institutions dédiées à la diffusion culturelle.
Ce colloque se tiendra uniquement sur plateforme.
Conférence annuelle du Comité international UMAC
Le thème de la conférence annuelle 2023 du comité international pour les musées et les collections universitaires - UMAC - est "La vérité à travers les musées et les collections universitaires".
La conférence internationale de l'UMAC se tiendra à l'Université de Sidney (Australie) au Chau Chak Wing Museum du 29 au 31 août 2023
L'UMAC 2023 aura lieu à l'Université de Sydney, sur le territoire des Premières Nations australiennes. Le comité d'organisation de l'UMAC reconnaît le peuple Gadigal de la nation Eora en tant que propriétaire traditionnel de ces terres et de ces eaux et rend hommage aux anciens, anciens et actuels, ainsi qu'aux nombreux propriétaires traditionnels du pays à travers l'Australie.
L'Université de Sydney est la première université d'Australie et abrite le musée ultramoderne Chau Chak Wing. Ce musée rassemble les collections d'art, d'antiquités et d'histoire naturelle de l'université. L'UMAC 2023 réunit des délégués à Sydney, en Australie, pour explorer le thème de la conférence " Dire la vérité à travers les musées et les collections universitaires ".
Alors que l'environnement opérationnel de l'enseignement supérieur évolue, les musées et les collections peuvent jouer un rôle important en aidant à façonner l'identité et le récit d'une institution. Ils permettent à divers publics de dialoguer avec l'histoire, les travaux universitaires et les questions contemporaines, tout en servant d'espace théâtral pour des recherches et des pratiques novatrices.
UMAC 2023 examinera les relations entre les musées et les collections et leurs hôtes institutionnels, leur relation avec les missions tripartites de l'enseignement, de la recherche et de l'engagement, ainsi que leur pertinence par rapport aux questions globales de l'enseignement supérieur et de la société en général.
Les propositions de communications pour la conférence sont désormais closes.
Les inscriptions sont ouvertes.
Les thèmes abordés lors des conférences sont les suivants :
- Collections, responsabilités socioculturelles et intendance
- La vérité et la politique muséale
- Les collections patrimoniales dans les musées universitaires
- Les musées universitaires sont-ils le reflet de leur université ? L'université valorise-t-elle la contribution ?
- Le rapatriement, un contexte mondial
- Art et vérité
- Que signifie être un artiste/scientifique socialement responsable au 21e siècle ?
- Engagement des étudiants : études de cas d'expériences d'apprentissage formelles et informelles
- Les étudiants et le musée en tant que vecteur d'action sociale
- Publics : à qui s'adressent les musées universitaires ?
- Élargir l'accès au campus : évolution de l'engagement académique dans les musées universitaires
- Espaces, durabilité et expérience
- Des collections historiques pour l'avenir ? Comment les collections des musées universitaires peuvent-elles être utilisées dans les discussions sur le changement climatique ?
- Remettre en question le modèle des universités occidentales - reconnaître les idées des pays du Sud
- Droit et musées universitaires
- La justice réparatrice pour un avenir juste
- Musées universitaires numériques
- Musées durables : action collective pour un avenir positif
Conférence annuelle du Comité international CIDOC
Le thème de la conférence annuelle 2023 du Comité international pour la documentation - CIDOC est "Frontières de la connaissance. Musées, documentation et données connectées"
La conférence CIDOC 2023 abordera l'importance de construire et de transformer les frontières de la connaissance dans la documentation des musées et l'intégration numérique de leurs informations, afin de savoir à quels objectifs nous aspirons et où nous voulons aller. Nous comprenons ces frontières comme des limites qui obéissent à des positions culturelles, institutionnelles et académiques que nous devons constamment remettre en question et dépasser pour changer l'avenir de notre patrimoine culturel.
L'organisation et l'ouverture des connaissances sont des tâches importantes pour les musées et les diverses institutions du patrimoine culturel, directement liées à leurs pratiques de documentation. Cette organisation est réalisée à partir de différentes approches et objectifs de la gestion institutionnelle : administration, recherche, publication et diffusion, entre autres. Les objectifs visent généralement une meilleure identification du patrimoine, la génération d'inventaires et de catalogues pour sa conservation et son exposition, ainsi que des bases de données, des plateformes technologiques et des données ouvertes liées qui permettent sa diffusion, son utilisation et sa redistribution à des publics plus larges. Tous ces éléments constituent des frontières, des horizons académiques et institutionnels qui conduisent à des pratiques de documentation et à des résultats d'intégration des connaissances.
L'une des frontières les plus courantes est celle qui se concentre sur l'accès à l'information. Avec cet objectif, les développements technologiques de l'information se concentrent sur la publication de différents produits culturels afin de les intégrer dans le monde numérique ; la visibilité est ainsi privilégiée avec des modèles de données qui peuvent laisser de côté la complexité et l'hétérogénéité des sources produites par l'observation scientifique ou académique.
L'accès ne doit donc pas être notre seule frontière. Il en existe d'autres, liées à une meilleure expression de la richesse contextuelle et hétérogène de la documentation patrimoniale, à l'optimisation des processus de documentation, ainsi qu'à l'avancement du développement d'une meilleure infrastructure permettant la représentation adéquate de la connaissance. Il s'agit de créer des clés qui invitent ceux qui les utilisent à suivre l'origine des données et à amplifier le contenu généré par les organisations qui ont la responsabilité de conserver les biens culturels.
Ces frontières sont l'occasion de nous interroger sur les objectifs que nous nous fixons en matière de publication de contenus numériques et sur l'horizon qui nous reste à atteindre. En ce sens, nous invitons à un dialogue basé sur des questions telles que : quelles sont les frontières de la connaissance dans la documentation des biens patrimoniaux ? Quelles frontières avons-nous atteintes et quels nouveaux horizons pouvons-nous envisager ?
La conférence se tiendra à l'Universidad Nacional Autónoma de México du 24 au 28 septembre 2023.
Les thèmes abordés seront les suivants :
Les frontières de la connaissance:
- Stratégies visant à réduire la fracture numérique entre les pays, les institutions et les personnes
- Gestion institutionnelle et ouverture des connaissances : l'importance d'une approche globale entre la planification institutionnelle et l'ouverture des connaissances (science ouverte)
- Développement de technologies de l'information flexibles axées sur les biens du patrimoine culturel
- Collaboration pour le développement de thésaurus et de systèmes d'autorité.
- Application standard pour générer des données de qualité et leur mise en relation avec les communautés internationales.
Documentation muséale
- Documentation et enseignement dans les musées
- Décolonisation et documentation : les collections en ligne face aux débats culturels sur les relations de pouvoir
- Initiatives émergentes de documentation muséale
- Musées, documentation et attention au public : médiation entre disciplines et acteurs
- Vocabulaires contrôlés, interopérabilité et systèmes d'organisation des connaissances
- Nouvelles approches interdisciplinaires pour la recherche muséale
Normes, intégration et interopérabilité des connaissances
- Normes relatives au patrimoine culturel
- Préservation numérique
- Frontières technologiques dans la documentation du patrimoine culturel : plateformes de gestion, publication, utilisation de l'intelligence artificielle, etc.
- Collaboration ouverte et distribuée (crowdsourcing)
Conférence annuelle du Comité international COSTUME
Le thème de la conférence annuelle 2023 du comité international pour les musées et collections de costume, mode et textile - COSTUME - est "Toutes les couleurs du noir".
Le noir n'est pas, techniquement, considéré comme une couleur ; scientifiquement, il représente l'absence ou l'absorption complète de la lumière visible. Pourtant le noir est un élément récurrent de la palette de couleurs et du langage de la mode. Il est à la fois la couleur de l'amour et de l'amitié. Il est à la fois la couleur de la protestation, du deuil et de la mélancolie ; il est sinistre - associé à la nuit, à la mort, au péché et au mal.
Il est à la fois sérieux, inspirant le respect, la diligence et l'humilité comme lorsqu'il est porté par les religieux, et rebelle comme dans le style des sous-cultures punk et gothique. Le noir est à la fois sophistiqué et chargé d'érotisme ; il est à la fois pieux et pervers.
Les significations paradoxales du noir ont une longue histoire dans l'habillement et le textile. Il s'agit d'une couleur difficile à obtenir et son apparition dans les vêtements était autrefois synonyme de grande richesse. Elle a d'abord été popularisée dans les cours d'Europe de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1396-1467) en deuil de son père après 1419, à l'empereur d'Espagne Charles Quint (1500-1558) et à Catherine de Médicis (1519-1589), reine consort d'Henri II de France (1519-1589).
Le symbolisme du noir va bien au-delà des tendances vestimentaires. Dans l'Égypte ancienne par exemple, comme dans d'autres régions d'Afrique et d'Asie, le noir symbolisait à la fois la vie et la mort. Elle est décrite par le célèbre professeur historien des couleurs, Michel Pastoureau, comme la "couleur des entrailles de la terre et du monde souterrain". Son interprétation dans l'habillement, le textile et la mode souligne donc à quel point notre relation aux vêtements est profondément personnelle, liée à notre matérialité politique, économique et culturelle.
Les conférences aborderont les thèmes suivants :
- Connotations religieuses et spirituelles du noir
- Symbolisme culturel varié du noir
- Le processus et les défis de la création de teintures noires
- Les associations genrées du noir dans la mode
- Le noir en relation avec le dandysme - dans un contexte aussi large que le dandy du 19e siècle, le dandy noir ou le dandy féminin.
- Le noir comme couleur de protestation
- Le rôle du noir dans l'histoire du style sous-culturel
- La tenue de deuil et/ou l'étiquette du port du noir pour observer les rites funéraires
- Le rôle des cours royales dans la popularisation du noir dans la mode
Retrouvez le programme de la conférence ci-contre
Conférence annuelle du Comité international DEMHIST
Le thème de la conférence annuelle 2023 du Comité international pour les Demeures historiques/musées - DEMHIST est "Souvenirs des choses perdues : déclencher la mémoire de la maison historique par la perte et la récupération".
Cette conférence se concentre sur l'implication des musées privés (familiaux) ou publics dans la restauration et la sauvegarde de la mémoire qui a été perdue pour diverses raisons, notamment la guerre, la confiscation par l'État, les actions colonialistes, etc.
En tant que professionnels des musées, nous avons l'obligation morale d'examiner en profondeur et de mettre à jour les récits. On trouve de nombreux exemples de ces maisons en Serbie, dont certains seront présentés lors de la conférence à Belgrade. Toutes ces maisons représentent une couche distincte de l'histoire complexe des habitations historiques résultant des effets de la Seconde Guerre mondiale dans cette région du monde.
L'objectif principal de cette conférence est de montrer comment la gestion d'un patrimoine difficile et les défis liés à la protection du patrimoine (gestion des risques liés aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine) peuvent conduire aux mêmes préoccupations en matière de mémoire perdue. Ces questions doivent être abordées non seulement dans le contexte de l'histoire européenne du milieu du XXe siècle, mais aussi dans le monde entier, dans les communautés ravagées par les actions colonialistes, comme les Maoris de Nouvelle-Zélande, les communautés du fleuve Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les communautés indigènes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, d'Afrique subsaharienne et les Premières nations des Amériques.
Lorsqu'il s'agit de maintenir le feu du souvenir vivant et pertinent dans le présent, qu'est-ce qui caractérise les foyers historiques et traditionnels individuels à travers le monde, mais qui constitue également un facteur commun ? Quels sont les outils disponibles pour entretenir la flamme de la mémoire ? Comment les musées de maisons historiques peuvent-ils préserver l'histoire qui est encore inscrite dans les murs d'une maison, mais qui a été physiquement perdue ? L'inexistence physique du détenteur de la mémoire, c'est-à-dire de l'objet, est-elle si importante qu'elle ne peut être remplacée par un simple récit ou une copie ?
La mise en œuvre de techniques de déclenchement de la mémoire peut-elle nous aider, où que nous soyons dans le monde, à conserver des histoires vivantes même après avoir quitté une maison historique ? Qu'est-ce que nous choisissons de nous rappeler et qu'est-ce que nous décidons d'oublier ? On peut se demander si le souvenir choisi est toujours pertinent pour le public ou s'il aborde des questions de société. Le message de l'oubli, cependant, peut être plus crucial pour un examen attentif et peut contribuer à la guérison d'une communauté. Cela nous amène à la question suivante : comment conserver les souvenirs perdus et oubliés ?
Thèmes abordés lors des conférences :
Souvenirs perdus et retrouvés
Les conservateurs, les propriétaires et les gestionnaires de maisons historiques sont confrontés à l'absence de l'objet ou à la perte de mémoire de l'objet ou de la mémoire perdue. Lorsqu'il s'agit de protéger les maisons historiques dans le monde entier, nous utilisons en fait la méthodologie de Proust pour déclencher la mémoire individuelle et collective à travers les objets. En quoi l'utilisation de cette méthodologie nous aide-t-elle dans le processus de réinventer le récit de la maison historique ?
- Comment pouvons-nous conserver la mémoire de l'objet lorsque l'objet est manquant ou définitivement perdu ? Le pouvoir de la perte et donc de l'inconnu aujourd'hui, en le faisant connaître et en le rendant visible, sert d'outil pédagogique pour les jeunes publics.
- À la recherche des déclencheurs (oubliés) de la mémoire.
- Comment conserver la mémoire perdue ou présenter une histoire d'objets perdus ? Discuter de l'éthique derrière l'utilisation de répliques ou de pièces d'époque similaires. Si nous devons utiliser le substitut, comment le paradoxe de l'authenticité est-il traité ? Perdons-nous la possibilité de raconter l'histoire de quelque chose qui a été perdu en premier lieu ? Quelle perte de mémoire choisissons-nous de partager ? Pouvons-nous partager les deux récits et, si oui, comment ?
Les maisons historiques comme déclencheurs de l'engagement communautaire
Comment maintenir à jour la mémoire préservée d'une maison historique, résoudre les problèmes de déconnexion et relier l'interprétation à des publics en constante évolution sont les principaux défis de la conservation d'une maison historique. Comment les conservateurs de musées de maisons publiques et les propriétaires familiaux privés peuvent-ils continuer à être pertinents tout en offrant la facilité d'accès à la maison historique ? (comme pendant le processus de reconstruction d'après-guerre) ?
- Collaboration avec la communauté locale en vue de sécuriser le récit de la mémoire partagée mais perdue de la maison historique.
- Façons de raconter une histoire pour évoquer la recherche de la mémoire personnelle (perdue) à la sortie de la maison historique.
- Remise en question de la mémoire actuelle conservée.
- La conservation de la mémoire difficile, oubliée et abandonnée.
Evolution des valeurs
Selon la nouvelle définition de musée de l'ICOM, qu'est-ce qui peut changer lorsque nous parlons d'une maison historique ? Les concepts d'inclusion, de participation communautaire et de durabilité sont pour la première fois reconnus dans le monde entier dans la définition du champ muséal. Comment les intégrer dans les maisons historiques ? Comment pouvons-nous utiliser e pouvoir du numérique et le pouvoir de la communauté (qu'il s'agisse de la communauté numérique ou de la communauté dans les environs de la maison historique) pour assurer une nouvelle couche de mémoire ?
L'évolution des valeurs due à un changement dans les récits de l'histoire publique peut libérer tout le potentiel d'interprétation des maisons historiques.
- Comment le visiteur contemporain peut-il bénéficier du changement potentiel de l'interprétation actuelle de la maison historique ?
- Comment la maison historique peut-elle contribuer à fournir des réponses actualisées aux problèmes de la communauté ?
- Le potentiel du numérique. Les musées et les particuliers adoptent l'environnement numérique, mais si la politique de libre accès a été mise en œuvre par les musées du monde entier, qu'en est-il réellement ? Que faisons-nous réellement de toute cette mémoire numérisée ?
- Le potentiel de conservation de la mémoire dans le domaine numérique au-delà de la collection numérisée de la maison historique.
- Le souvenir numérique - la mémoire partagée comme moyen de sécuriser la perte individuelle de la mémoire.
II - Médiation du développement durable
Les musées face à leurs responsabilités environnementale et sociétale : vers un modèle éthique et durable
ICOM France et ses partenaires ICOM Canada, ICOM Espagne, ICOM Liban, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arab, ICOM LAC, et l'université du Québec Trois Rivières lancent un nouveau cycle de débats consacré à l'élaboration d'un modèle éthique et durable dans les musées.
Ce cycle de rencontres/débats est destiné aux professionnels de musée. Y interviendront des collègues pouvant faire état d’expériences innovantes en matière de développement durable. Cette notion est ici comprise dans sa dimension à la fois écologique et sociétale. Il s’agira de présenter autour de thématiques choisies, des retours d’expérience inspirants, visant à montrer comment les musées peuvent aujourd’hui concrètement s’engager dans leurs actions quotidiennes pour construire un avenir plus durable.
Ce cycle prendra la forme de 6 séances participatives sur plate-forme numérique de mai à novembre 2023.
Session 2
Médiation du développement durable
Mercredi 7 juin 2023
17h30 - 19h
Le musée a, par essence, un rôle important à jouer en termes de médiation des enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale. A travers des exemples concrets, la session donnera la parole à des professionnels de la médiation impliqués mais aussi à des artistes qui témoignent de ces enjeux à travers leur production artistique.
Venez dialoguer et échanger avec :
- Anne Charpentier, directrice du Jardin botanique de Montréal, Canada
- Tamar Mayer, professeur adjoint, conservateur en chef, galerie d'art de l'université Genia Schreiber, université de Tel Aviv, Israël
- Marina Piquet, Curatrice, Museu do Amanha, Brésil
- Ludivine Vendé, Centre de culture scientifique, technique et industrielle, Muséum de Nantes, France
La séance sera modérée par Philippe Guillet, vice-président de NATHIST.
Elle se tiendra simultanément en français, en anglais et en espagnol.

Le cycle est conçu avec le soutien financier de l'ICOM, de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et l'université du Québec à Trois-Rivière.
III - Enjeux sociétaux du développement durable
Les musées face à leurs responsabilités environnementale et sociétale : vers un modèle éthique et durable
ICOM France et ses partenaires ICOM Canada, ICOM Espagne, ICOM Liban, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arab, ICOM LAC, et l'université du Québec Trois Rivières lancent un nouveau cycle de débats consacré à l'élaboration d'un modèle éthique et durable dans les musées.
Ce cycle de rencontres/débats est destiné aux professionnels de musée. Y interviennent des collègues pouvant faire état d’expériences innovantes en matière de développement durable. Cette notion est ici comprise dans sa dimension à la fois écologique et sociétale. Il s’agit de présenter autour de thématiques choisies, des retours d’expérience inspirants, visant à montrer comment les musées peuvent aujourd’hui concrètement s’engager dans leurs actions quotidiennes pour construire un avenir plus durable.
Ce cycle prend la forme de 6 séances participatives sur plate-forme numérique de mai à novembre 2023.
Session 3
Enjeux sociétaux du développement durable
Mercredi 5 juillet 2023
17h30 - 19h
La prise en compte des publics et de leur développement sont constitutifs de la durabilité : comment envisager la durabilité sans imaginer et favoriser le renouvellement des publics ? Comment favoriser l’inclusion et la diversité si l’on n’encourage pas l’appropriation de l’art par le plus grand nombre ? Comment rendre les musées plus actifs sur ces questions ?
Dialogues et échanges :
- Amareswar Galla, président de la Chaire de l’UNESCO sur les musées inclusifs et le développement durable du patrimoine - Inde
- Marie-Claude Mongeon, responsable du secrétariat général et des projets stratégiques du musée d'art contemporain de Montréal - Canada
- Diala Nammour, directrice du MACAM (Modern and Contemporary Art Musem) à Beyrouth - Liban
- Xavier Roigé Ventura, professeur de muséologie à l'université de Barcelone - Espagne