
Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
L’assurance des œuvres d’art : sinistralité et enjeux de responsabilité
Les œuvres d’art sont exposées à des risques divers et croissants : vol, vandalisme, malveillance, incendie, dégât des eaux, dommage lors d’un transport ou pendant une exposition… sont autant d’événements passés ou potentiels qui doivent attirer l’attention des professionnels du patrimoine sur la protection juridique et physique des collections qu’ils doivent conserver et transmettre. Intégrer ces risques dans la politique patrimoniale globale ou de proximité, du musée ou de toute institution culturelle conservant ou présentant les richesses de la nation, est une absolue nécessité.
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels conservant et/ou présentant des collections de faire le point sur le cadre juridique de l’assurance des œuvres d’art, les acteurs de ce marché et les enjeux de responsabilité dans la gestion et le règlement des sinistres.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
- évaluer les facteurs de risques dans la politique patrimoniale de son institution (expositions, transports, prêts, réserves, restaurations, sinistres) ;
- déterminer ses besoins en assurance pour ses collections ;
- comprendre les règles juridiques et les mécanismes de l’assurance d’œuvres d’art ;
- connaître la réglementation des contrats d’assurance relatifs aux œuvres et aux expositions ;
- comprendre les rôles et responsabilités des compagnies d’assurances, des experts et des courtiers ;
- mettre en place à titre préventif les moyens de protection requis par les compagnies d’assurances.
Coordonnatrice : Hélène Vassal, chef du service des collections, musée national d’art moderne - Centre Pompidou
Infos pratiques
Public concerné
Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, assistants de conservation, régisseurs d’œuvres d’art, restaurateurs, transporteurs, assureurs, responsables de collections patrimoniales, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé
Dates : 29, 30 et 31 octobre 2019
Durée : 3 jours
Lieu : Paris, Inp et établissements patrimoniaux
Prix : 630 euros (voir les conditions d’inscription)
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Guillaume Durand (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 54
Editer un ouvrage patrimonial – de la définition du besoin à la livraison de l’ouvrage
Ce module d’introduction à l’édition de livres d’art visera à donner les premières bases pour mettre en œuvre un projet d’édition dans un contexte de valorisation de collections.
Un panorama de l’édition d’art permettra au préalable de présenter la variété des productions, de manière à pouvoir cibler au mieux la publication recherchée. Les notions essentielles concernant les cadres économiques, administratifs et juridiques seront exposées, avant de se pencher plus concrètement sur les différentes étapes de réalisation d’un ouvrage, tant sur le plan éditorial que sur celui de sa fabrication.
1re journée :
- Un livre, des livres : panorama éditorial dans le domaine (du scientifique au grand public)
- Les conditions de naissance d’un ouvrage : contexte économique (monter un budget prévisionnel), administratif et juridique
2e journée :
- La vie du livre : les grandes étapes de la chaîne éditoriale
- Les arcanes de la fabrication
Coordonnateur : Sophie Laporte, directrice des éditions à la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais
Infos pratiques
Public concerné
Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, assistants de conservation, responsables de collections patrimoniales, responsables de projets d’éditions, ingénieurs d’étude, ingénieurs de recherche, chargés de projets d’exposition, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé.
Dates : 30 et 31 octobre 2019
Durée : 2 jours
Lieu : Paris, Inp
Prix : 420 euros (voir les conditions d’inscription)
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Sandrine Erard (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 51
Télécharger le bulletin d’inscription (PDF)
Les matériaux de l’art contemporain : enjeux de leur conservation
Si l’art contemporain est multiple dans son expression artistique depuis Duchamp, il l’est également par les matériaux et composants utilisés. Les matériaux du XXème siècle présents dans les œuvres d’art contemporain, et en particulier les polymères, sont apparus dans les collections publiques depuis une cinquantaine d’années. Face à leur diversité, hétérogénéité, parfois fragilité, les solutions de conservation sont liées à la fois à l’identification des matériaux, leur mode d’utilisation, et l’intention de l’artiste voire à la connaissance de l’esprit et de l’usage de l’œuvre. Sur un même plan d’égalité, l’étude des mécanismes de dégradation de ces matériaux permet de mieux comprendre à la fois les phénomènes de vieillissement et leur interaction avec d’autres matériaux environnant les œuvres d’art. Parmi les matériaux les plus dégradables, on trouve les caoutchoucs, les polyuréthanes et latex et les peintures fluorescentes dont les dégradations, bien qu’irréversibles, peuvent être inhibées ou ralenties.
Le monde de la conservation bénéficie aujourd’hui à la fois de la documentation précise des matériaux employés et des processus créatifs des artistes, ainsi que les procédés de fabrication et la connaissance de la durabilité des polymères, continuellement optimisés par le milieu de la recherche industrielle.
Le stage vise à identifier ces matériaux, leur processus d’altérations et les enjeux de conservation. Il montrera aussi que ces phénomènes se réfèrent autant au processus de création qu’à la caractérisation des produits industriels utilisés par les artistes, nécessitant de nouvelles approches méthodologiques et documentaires. Enfin il abordera quelques enjeux spécifiques tels que la conservation des œuvres imprimées en 3D, holographie et œuvre virtuelle ou des matériaux comme par exemple les résines thermodurcissables qui interrogent certains principes déontologiques de restauration telle que la réversibilité.
Coordonnateurs : Alain Colombini, ingénieur, spécialisé dans les œuvres d’art contemporain, CICRP ; Roland May, conservateur général du patrimoine, directeur du CICRP
Infos pratiques
Public concerné
Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, chercheurs, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, assistants de conservation, chargés de documentation, régisseurs d’œuvres d’art, restaurateurs, responsables de collections patrimoniales, responsables d’acquisitions, responsables de projets d’aménagement urbain, professionnels du marché de l’art, libraires, médiateurs, chargés des publics, représentants d’associations en lien avec le Street Art, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé.
Dates : 13, 14 et 15 novembre 2019
Durée : 3 jours
Lieu : Marseille, I2MP
Prix : 795 euros (voir les conditions d’inscription)
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Muriel Marcellesi (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 52
Programme modulaire pour le nettoyage des polychromies
Ce programme informatique, par sa base de données très complète, permet d’assister le restaurateur dans le choix et la formulation des méthodes de nettoyage à mettre en œuvre en fonction des cas rencontrés. Mis au point par Chris Stavroudis à partir des méthodes développées par Richard Wolbers, ce programme intègre les théories actuelles concernant les solutions aqueuses, les gels de solvants, les émulsions et micro-émulsions.
Les sessions pratiques permettront de préparer les solutions qui servent de base au système.
En fonction des cas rencontrés et du nettoyage recherché, le programme vous proposera alors des combinaisons de ces solutions de base afin qu’elles soient les plus performantes et adaptées. De même, les préparations de gels, de solvants et d’émulsions permettront de résoudre d’autres problèmes de dégagement de couches ou d’adhésifs. Cette première partie concernera les solutions aqueuses.
Chris Stravroudis a commencé à enseigner cette méthode alors qu’il était l’assistant de Richard Wolbers dans un cours sur les nouvelles méthodes de nettoyage parrainé par le Getty Conservation Institute. Depuis lors, il a continué à présenter et à affiner ses techniques dans de nombreuses conférences, des cours d'ateliers et des publications.
Formation bilingue anglais-français
Coordonnatrice : Laetitia Desvois, restauratrice de peinture ; Nathalie Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation continue, Inp.
Intervenant : Chris Stavroudis, restaurateur de peinture, Hollywood
Traduction : un service de traduction simultanée sera proposé
Infos pratiques
Public concerné
Restaurateurs de polychromies et/ou d’œuvres vernies
Date : 13, 14 et 15 novembre 2019
Durée : 3 jours
Lieu : Inp, Aubervilliers
Prix : 795 euros (voir les conditions d’inscription)
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Laëtitia Letendard (formation.permanente.restaurateurs@inp.fr) - Institut national du patrimoine département des restaurateurs – 124, rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers. Renseignements au 01 49 46 57 04
Textiles et costumes : adapter sa politique de conservation, de restauration et d’exposition à sa collection
Depuis plusieurs années, on note un regain d’intérêt pour les collections de costumes de toutes époques et de tous domaines. Face à l’intérêt du public pour ces fonds, ceux qui ont la charge de les conserver, de les restaurer et de les valoriser rencontrent de multiples questions et obstacles : fragilité et vieillissement des matériaux et de leur mise en œuvre, sensibilité à la lumière, mode d’exposition (mannequinage ou à plat), choix de scénographie mais aussi enjeux de restauration. Comment exposer sans dégrader ? Comment faire comprendre une pièce qui a perdu ses volumes ? Comment transmettre avec elle le patrimoine immatériel dont elle est porteuse ? Comment faire les bons choix de restauration au cas par cas ?
Cette formation se propose d’aider les responsables de collection et tous ceux qui ont la charge de restaurer ou de valoriser des fonds de costume à trouver des réponses au travers d’exemples et de témoignages qui feront se croiser costumes populaires et historiques, collections ethnographiques et vêtements de haute couture.
En alternant points théoriques et moments pratiques, en particulier autour du mannequinage, ces deux journées de formation donneront aux stagiaires des outils permettant d’améliorer et d’enrichir leurs pratiques professionnelles autour du costume.
Coordonnatrice : Aurélie Samuel, conservatrice du patrimoine, directrice des collections de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent
Infos pratiques
Public concerné : conservateurs du patrimoine, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, assistants de conservation, régisseurs d’œuvres d’art, restaurateurs, responsables de collections patrimoniales, scénographes, muséographes, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé
Dates : 18, 19 et 20 novembre 2019
Durée : 3 jours
Lieu : Paris, Inp et Musée Yves Saint Laurent Paris
Prix : 630 euros (voir les conditions d’inscription).
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Guillaume Durand (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 54
Les réserves sont-elles le cœur des musées ?

Organisée par ICOM France et l’Institut national du patrimoine, cette soirée-débat sur les réserves de musées s'est déroulée autour de trois questions :
- Les innovations professionnelles et techniques, notamment en matière de sécurité des collections, de conditions de conservation et restauration, de capacité de travail scientifique sur les objets, de principes organisationnels
- Les aspects économiques : quelles sont les composantes du coût de conception et de rénovation de réserves, les enjeux de mutualisation et d’externalisation...
- Les aspects culturels et sociaux : les projets en cours, des sites architecturaux à part entière ? Pour quels publics ? Quel outil/rôle pédagogique pour des futurs professionnels, comment associer des partenaires ? Quelle médiation pour les réserves ? Comment sensibiliser des élus à ces investissements ?
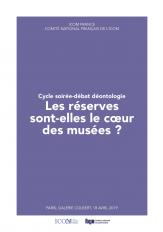
"Musées et genre"
Museum International
Vol. 72, Nº 285 – 286 : Musées et genre (Museums and Gender)
Appel à contributions
La prochaine édition de Museum International, préparée par l’ICOM, sera consacrée au thème « musées et genre ». Tous les résumés d'articles reçus seront évalués afin de juger de leur pertinence, et les articles sélectionnés, seront soumis à un processus d'évaluation par des pairs (en lecture anonyme). La date prévue pour la publication du numéro, en collaboration avec Taylor&Francis/Routledge, est fixée au mois de juillet 2020.
Musées et genre
Ce numéro de Museum International aura pour objectif de provoquer une réflexion de fond sur les questions de genre au sein des musées, en particulier : la corrélation entre genre et musées, et le rôle que doivent jouer les musées dans un monde qui, désormais, privilégie « l’égalité des genres ». La question du genre influence tous les aspects de la pratique muséale, tels que la gouvernance ou le type de publics. Ce numéro envisagera les sous-thèmes suivants : la représentation du genre en matière de gouvernance, de gestion opérationnelle et de tutelle. En outre, l’on s’interrogera sur les manières dont le genre est représenté au sein des collections, dans les expositions et les programmations culturelles et actions éducatives.
Dans la mesure où la construction sociale du genre, ainsi que les mesures ayant trait au genre, varient selon les sociétés, les problématiques liées au genre et à la sexualité au sein de ces institutions sont aussi vastes que spécifiques. Les interrogations touchant aux objets, aux histoires qui les accompagnent, et à la manière dont l’ensemble est conservé et présenté concernent autant les musées d’histoire, d’histoire culturelle et les « musées vivants » (living museums) que les musées de sciences et d’histoire naturelle. Aussi est-il grand temps de mener une réflexion critique sur, d’une part, le rôle que jouent les institutions culturelles et patrimoniales pour nous aider à comprendre la question du genre, et d’autre part, la manière dont celles-ci placent la question du genre au cœur même de leur propre structure. Les musées sont-ils à même, aujourd’hui, de devenir une figure de proue à propos de la question de l’égalité des genres ?
On considère les musées comme des lieux de sauvegarde du passé, d’apprentissage et de divertissement, et des arbitres de l’avenir. Mais certains musées se font encore l’écho de 2 valeurs culturelles issues d’un modèle impérialiste ancré dans les premières pratiques de collection et d’exposition, comme en témoignent l’absence criante d’artistes femmes, ou la dissimulation méticuleuse d’images de déesses et de créatures hermaphrodites. D’autres, en revanche, défient ce système de stéréotypes afin de rendre plus juste le discours sur l’Histoire. Le secteur muséal, dans son entier, devra fournir beaucoup d’efforts pour s’attaquer à ces préjugés sexistes.
Parmi les thèmes envisageables, citons entre autres exemples :
• Gestion et fonctionnement du musée
• Égalité des genres / discrimination (différences salariales, sécurité dans l’environnement professionnel)
• Sexualité : représentation et discrimination
• Représentations d’hier et d’aujourd’hui
• Genre et impérialisme
• Politiques d’acquisition et déontologie
• Sexisme et misogynie
• Éducation
• Fréquentation des publics, contrôle et évaluation
• Collections et archives
• Programmation culturelle et médiation publique
Nous sommes à la recherche de regards critiques, et proposant des solutions à cette problématique si essentielle aux professionnels des musées.
Processus de sélection
Les résumés d'articles, de 250 à 300 mots et rédigés en anglais, en français ou en espagnol, doivent être envoyés à publications@icom.museum.
Les contributions ne sont pas rémunérées.
Merci d'inclure les détails suivants dans votre résumé :
• Titre de l’article
• Noms de l'auteur (des auteurs)
• Expérience professionnelle
La date limite d'envoi est fixée au 13 septembre 2019.
Les résumés d'articles seront examinés à l'aveugle par des spécialistes des politiques publiques, du développement durable et des musées.
Museum International n'est, à ce jour, diffusé qu'en anglais. Toutefois, nous acceptons également des résumés d'articles dans les deux autres langues officielles de l'ICOM (le français et l’espagnol). Si votre résumé d'article est accepté, il vous est possible de rédiger votre texte dans l'une des trois langues officielles de l'ICOM, à savoir l'anglais, le français, ou l'espagnol.
Structure attendue d'un résumé d'article
Un résumé d'article, d’une longueur 250 à 300 mots, doit donner, de manière succincte, l’essence du propos, comme un texte à part entière. Pour ce, il doit comprendre les sections suivantes :
- Une introduction, qui décrit le sujet dans son ensemble, y compris le contexte de l'étude présentée.
- Une problématique ou les principaux axes de réflexion, qui articule les différents aspects critiques ou thématiques envisagés dans le texte. Tout aspect non étudiés précédemment par la critique, il convient de les identifier.
- L'originalité de la démarche adoptée par l'auteur doit être mise en lumière.
- La description de la méthode adoptée doit décrire l’approche élaborée pour les études de cas, les entretiens, etc. (entre autres exemples).
- La conclusion décrit l'impact et la portée de la recherche ou du propos, en expliquant l'importance des résultats obtenus.
- Une bibliographie sélective, citant les sources principales qui seront citées dans l’article
La construction métallique : connaître, conserver, restaurer/réhabiliter
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Pôle Culture et Patrimoines à Arles et l’Institut national du patrimoine
La construction métallique englobe différents domaines comme la charpente, le pont, les décors et divers ouvrages en totalité ou partiellement métalliques.
Cette formation a pour objectif d’évoquer les constructions métalliques constituant le patrimoine en mettant l’accent sur la charpente, son histoire, ses développements et sur les problématiques de restauration rencontrées aujourd’hui. Au travers de nombreux exemples, théoriques et pratiques - visites de sites et en atelier - cette formation abordera le sujet sous des angles épistémologiques, techniques ou de réglementation. L’histoire de la construction métallique monumentale, l’approche historique d’un monument, les altérations et pathologies des métaux, les aspects règlementaires en vigueur - en particulier la problématique plomb sur les métaux peints - et les différentes étapes d’un projet de restauration / réhabilitation jusqu’à la valorisation seront au cœur de ces trois jours de formation. Comment établir un diagnostic ? Comment restaurer ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre ? Quels sont les spécialistes à consulter ?
En fonction des participants, une remise à niveau sur les connaissances des matériaux métalliques et de leurs altérations sera envisagée.
Le programme comprendra :
Une approche historico-technique
- des métaux employés pour ces structures (fonte, fer puddlé, acier),
- de l’évolution de la mise en œuvre de ces métaux et des premières applications architecturales
- du développement simultané des traitements anticorrosion.
Une description
- des problématiques (dégradation, déformation…),
- des méthodologies d’investigation in situ et en laboratoire permettra de faire ressortir leurs apports pour un chantier de restauration et de définir les limites de ces techniques.
Les moyens d’interventions pour les campagnes de conservation-restauration seront décrits et commentés au travers d’exemples concrets.
Coordonnateurs : Annick Texier, responsable du pôle scientifique métal honoraire, Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) ; Jean-Bernard Memet, vice-président du Pôle culture et patrimoines, directeur de la Société A-Corros, chercheur en conservation-restauration des biens culturels, Arles
Infos pratiques
Public concerné
Architectes, ingénieurs du patrimoine, conservateurs du patrimoine, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, restaurateurs, responsables de collections patrimoniales et de monuments, chercheurs de l’inventaire, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé dont les fonctions sont en rapport avec la formation
Dates : 26, 27 et 28 novembre 2019
Durée : 3 jours
Lieu : Arles, Archeomed
Prix : 795 euros (voir les conditions d’inscription)
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Muriel Marcellesi (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 52
Télécharger le bulletin d'inscription (PDF)
* Initié en 2007 par l’Etat, la Ville d’Arles, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des entreprises locales, le Pôle Industries Culturelles et Patrimoines (http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/) regroupe les acteurs économiques et industriels de la recherche et de l’enseignement impliqués dans les domaines d’activité liés aux loisirs culturels et à la gestion du patrimoine. Le Pôle est un outil fédérateur et de développement pour les acteurs intervenants dans toutes les phases successives de la valorisation d’un territoire, de ses patrimoines et de ses cultures. En 2007, le Pôle a été labellisé Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et lauréat en 2010 de la sélection nationale Grappes d'Entreprises. Le Pôle constitue à ce titre l’unique cluster européen (regroupement d'entreprises) centré sur les thématiques de conservation, de restauration et de diffusion des patrimoines.
Le Pôle est un réseau unique et dynamique d’acteurs fortement ancrés localement et mobilise aujourd’hui une centaine d’adhérents : entreprises, associations, laboratoires de recherche, établissements d’enseignement supérieur (Université d’Avignon, Université d’Aix-Marseille, école d’Avignon, etc.) et établissements patrimoniaux (Musée départemental Arles antique, Muséon Arlaten, etc.). Ses membres sont spécialisés dans la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission des patrimoines bâtis, culturels, naturels et immatériels.
Communication publique et média-training
Dans un environnement ouvert au sein duquel les nouvelles technologies de l’information ont pris une place croissante, la communication est devenue pour le service public une fonction stratégique qui doit permettre tout à la fois de répondre aux obligations d’information du citoyen et à la nécessité de faire connaître et de promouvoir les institutions et leurs missions, d’entretenir des relations professionnelles avec les médias, d’accompagner le processus de réforme et de modernisation de l’administration par le dialogue constant avec les agents.
Cette formation innovante a pour objectif de préparer les cadres de la fonction publique culturelle, qui ont ou auront la charge de gérer des services ou des établissements publics patrimoniaux, à assumer dans tous les aspects de la communication publique le niveau de responsabilité auquel ils se trouvent placés, de les former aux enjeux et techniques de la communication publique et de les doter des outils nécessaires à une prise de parole publique maîtrisée et efficiente.
Objectifs de formation :
- maîtriser les contextes de la communication publique ;
- organiser et piloter la stratégie de communication publique en vue d’améliorer la performance publique ;
- maîtriser les techniques pour communiquer avec aisance et conviction ;
- optimiser sa prise de parole en public ;
- entretenir des relations professionnelles avec les médias ;
- s’approprier les règles de l’interview.
Contenu de la formation :
- communication publique et déontologie ;
- les enjeux de la communication interne : faire connaître, faire comprendre, faire interagir ;
- les enjeux de la communication institutionnelle : faire savoir, rendre compte, faire valoir ;
- la communication de crise : informer et rétablir la confiance ;
- trouver son style et gagner en naturel ;
- identifier les points forts et faibles de son image ;
- gagner en aisance et en assurance ;
- convaincre et susciter l’adhésion de ses interlocuteurs ;
- comprendre le fonctionnement des médias, leurs attentes et leurs contraintes ;
- s’adapter aux différents types de médias ;
- connaitre les règles et les pièges de l’interview ;
- préparer son intervention et construire un message clair et impactant.
La formation privilégiera la pédagogie active reposant sur des exercices pratiques, des jeux de rôles et des mises en situation face caméra adaptés au contexte d’exercice des professionnels du secteur patrimonial et culturel.
Coordonnatrices : Cabinet OBEA ; Agathe Jagerschmidt, conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur des études du département des conservateurs, chargée de la formation continue, Inp
Infos pratiques
Public concerné
Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, chargés d’études documentaires, attachés de conservation, assistants de conservation, régisseurs d’œuvres d’art, restaurateurs, responsables de collections patrimoniales, professionnels du patrimoine d’Etat, des Collectivités territoriales et du secteur privé
Dates : 3, 4 et 5 décembre 2019
Durée : 3 jours
Lieu : Paris, Inp
Prix : 690 euros (voir les conditions d’inscription). Le régime d’exonération en vigueur pour les formations inscrites au catalogue de formation de l’Institut national du patrimoine ne sera pas appliqué pour cette formation spécifique.
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Sandrine Erard (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 51
Le nettoyage des peintures modernes à l’huile et à l’acrylique
Ce stage de trois jours concerne la conservation-restauration des peintures modernes, plus précisément les peintures à l’huile et à l’acrylique, leurs spécificités et les solutions de nettoyage.
Les journées se composent d’une matinée théorique suivie d’un après-midi consacré à la pratique. La première journée commencera par un aperçu historique sur les utilisations et les propriétés des peintures modernes ; la deuxième journée présentera les recherches actuelles sur les peintures acryliques à émulsion et les peintures modernes à l’huile. Enfin, la troisième journée résumera les résultats des recherches et exposera les différentes options de nettoyage qui s’offrent à nous.
Les sessions pratiques se concentreront sur les méthodes d’enlèvement de la crasse et des salissures sur ces couches picturales sensibles en utilisant un grand nombre de solutions, notamment les méthodes aqueuses, les solvants, les microémulsions et les gels.
Ainsi ce stage présentera les méthodologies et les pratiques actuelles émanant des dernières recherches menées au niveau international dans ce domaine et permettra de mettre au point une approche méthodologique et rigoureuse devant ces cas souvent très complexes et difficiles.
Formation bilingue anglais-français
Coordonnatrice : Nathalie Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation continue, Inp.
Intervenantes : Dr Bronwyn Ormsby, responsable scientifique à la Tate ; Dr Judith Lee, scientifique à la Tate, UK (Tate, Grande-Bretagne).
Traduction : un service de traduction simultanée sera proposé
Infos pratiques
Public concerné
Restaurateurs de polychromies intervenant sur des peintures modernes
Date : 4, 5 et 6 décembre
Durée : 3 jours
Lieu : Inp, Aubervilliers
Prix : 795 euros (voir les conditions d’inscription)
Inscriptions
Bulletin d’inscription à envoyer à Céline Jabin (formation.permanente.restaurateurs@inp.fr) - Institut national du patrimoine département des restaurateurs – 124, rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers. Renseignements au 01 49 46 57 16/92

