
Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Les musées en transition : vers une co-création des contenus et des outils
Première École internationale d’été sur les musées en transition à Toulon
Projet de formation :
La transition socio-écologique concerne désormais tous les aspects du fonctionnement des musées. Elle implique une certaine refondation du système muséal de façon à faire face de manière pertinente aux défis posés par l’urgence environnementale, ainsi qu’à ses corolaires sociaux, économiques, technologiques et éthiques.
Depuis le site de conservation des collections jusqu’aux espaces d’exposition et de travail du musée, la transition socio-écologique implique le déploiement d’un ensemble de pratiques et d’actions qui créent ou interrogent, parfois de manière contradictoire, les habitudes des employés, des visiteurs, des fournisseurs et des autres parties prenantes. Ce nouveau paradigme donne lieu à de nouvelles pratiques, de nouveaux discours et de nouvelles règles lors de sa mise en œuvre des contenus des expositions, des parcours muséographiques, mais aussi dans la manière de les produire. Les processus de conservation des collections, la gestion environnementale des bâtiments, ou encore les modalités de participation citoyenne et d’éducation à la citoyenneté sont également concernés. Quels que soient leur domaine et leur statut (art, société, sciences, histoire), les musées doivent désormais intégrer plusieurs axes incontournables : non seulement, l’éco-design, l’éco-responsabilité et l’économie circulaire doivent désormais guider leurs pratiques.
Mais en termes de contenus également, la catastrophe écologique vient reconfigurer une pluralité de sujets et de récits portés par ces institutions culturelles : les actions liées l’équité, à la diversité et à l’inclusion nous semblent centrales dans ce processus de transformation. Comme en écho aux mutations des pratiques durables, de profondes transformations traversent les musées, la culture et la muséologie. Comment les pratiques muséales peuvent-elles être relues à travers ces différentes perspectives ? Quels outils d’aide à la transition permettraient d’opérationnaliser ces nouvelles méthodes ?
Rencontre inédite entre la formation universitaire et la formation professionnelle en muséologie, cet événement mobilisera des consultants et des chercheurs de divers horizons du Québec, de la France et d’ailleurs, des étudiants du 2e et 3e cycle universitaire ainsi que des responsables, des professionnels de musée et des représentants d’autres secteurs culturels déjà conscientisés à la transition socio-écologique autour des objectifs suivants :
- Identifier et comprendre les approches récentes en transition socio-écologique et économique et se familiariser avec les nouvelles pratiques muséologiques.
- Se confronter et réfléchir aux notions liées à la transition socio-écologique dans les musées à travers un dialogue entre les disciplines scientifiques, les secteurs culturels et les pratiques muséologiques.
- Jouer et évaluer la rencontre entre la théorie et la pratique par un travail de création de contenus et d’outils.
Niveau minimum requis : master. Modalités : envoi d’une lettre de motivation et d’un CV pour le
05/03/2024 ; notification des candidatures retenues le 11/03/2024 ; frais d’admission à régler pour le
12/04 : 600 € pour les professionnels et 150 € pour les étudiants.
Plus de détails dans le programme ci-contre
Rencontres Professionnelles 2024 de la FEMS
La FEMS (Fédération des écomusées et des musées de société) annonce ses prochaines "Rencontres Professionnelles 2024".
Cette 20ème édition aura lieu du mercredi 13 au samedi 16 mars 2024 à l'Écomusée de l'Avesnois.
Le thème de cette rencontre est :" Récit et relations aux habitant·es"
Les écomusées et musées de société sont depuis leur origine pleinement engagés dans les défis écologiques et sociaux non seulement par leur rapport aux territoires et à leurs habitant·es, leur implication dans l’économie sociale et solidaire, mais aussi par la démarche patrimoniale qui par définition place les musées au centre des enjeux de transmission et de résilience. Ces défis ont acquis une importance inédite au cours des dernières années, nécessitant une réévaluation essentielle du positionnement de nos institutions.
En cette première année d'un programme, se déclinant sur trois ans, dédié à l'ambition écologique et sociale, nous avons choisi de focaliser notre réflexion sur les nouveaux récits et les relations avec les habitant·es.
En quoi les enjeux écologiques et les questions sociales qu’ils soulèvent incitent-ils à remettre en question les fondamentaux du musée et constituent une opportunité pour repenser les liens de nos institutions au territoire et aux habitant·es ? Comment porter un regard critique sur les collections issues d’une histoire dont on connaît les conséquences sur le climat et l'environnement aujourd'hui ? Comment énoncer un nouveau récit pour mieux comprendre notre époque ? Comment préparer l'avenir compte tenu des héritages encore présents dans la réalité sociologique et face aux enjeux économico-politiques ?
Placer les questions sociales et environnementales, intimement liées, au cœur de notre réflexion permet d’élaborer de nouveaux paradigmes dans lesquels la politique culturelle retrouve sa place dans la Cité. Comment réinventer notre relation avec les habitant·es ? Comment tisser de nouvelles relations où l'empathie remplace la parole autorisée, où la créativité se diffuse dans tous les interstices des relations sociales ?
Ces Rencontres Professionnelles de la FEMS ne prétendent pas répondre à toutes ces questions, mais elles chercheront à partager les désirs, les aspirations et les rêves qui nous permettront d'imaginer de nouveaux possibles.
Programme et informations pratiques

Représenter/ Exposer
SÉANCE 3 : Représenter/ Exposer
L’Académie des Traces a pour ambition de mieux comprendre le défi sociétal majeur que représentent les collections coloniales conservées par les musées en Occident, indissociablement liées à une pluralité de mémoires toujours sensibles et souvent douloureuses.
L’Académie des Traces se propose de discuter les différents domaines du travail muséal en lien avec les collections coloniale: la recherche de provenance, les questions de restitution, d'exposition, de création artistique et de médiation, ainsi que de la politique de genèse des collections et des archives. Il s'agit de comprendre le fonctionnement mais aussi d’interroger, voire de remettre en question le traitement complexe et multidimensionnel des collections coloniales opéré par les musées et, grâce aux connaissances acquises, de développer de nouvelles formes de traitement et donc de contribuer à les changer pour construire les pratiques de demain.
Orchestré par une équipe internationale et interdisciplinaire, ce séminaire est ouvert à tous et à toutes (sur inscription uniquement), aussi n’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous. Les séances se dérouleront en anglais et en français grâce à une traduction simultanée.
Restituer/ Rapatrier
SÉANCE 2 : Restituer/ Rapatrier
L’Académie des Traces a pour ambition de mieux comprendre le défi sociétal majeur que représentent les collections coloniales conservées par les musées en Occident, indissociablement liées à une pluralité de mémoires toujours sensibles et souvent douloureuses.
L’Académie des Traces se propose de discuter les différents domaines du travail muséal en lien avec les collections coloniale: la recherche de provenance, les questions de restitution, d'exposition, de création artistique et de médiation, ainsi que de la politique de genèse des collections et des archives. Il s'agit de comprendre le fonctionnement mais aussi d’interroger, voire de remettre en question le traitement complexe et multidimensionnel des collections coloniales opéré par les musées et, grâce aux connaissances acquises, de développer de nouvelles formes de traitement et donc de contribuer à les changer pour construire les pratiques de demain.
Orchestré par une équipe internationale et interdisciplinaire, ce séminaire est ouvert à tous et à toutes (sur inscription uniquement), aussi n’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous. Les séances se dérouleront en anglais et en français grâce à une traduction simultanée.
Imaginer/ Performer
SÉANCE 4 : Imaginer/ Performer
L’Académie des Traces a pour ambition de mieux comprendre le défi sociétal majeur que représentent les collections coloniales conservées par les musées en Occident, indissociablement liées à une pluralité de mémoires toujours sensibles et souvent douloureuses.
L’Académie des Traces se propose de discuter les différents domaines du travail muséal en lien avec les collections coloniale: la recherche de provenance, les questions de restitution, d'exposition, de création artistique et de médiation, ainsi que de la politique de genèse des collections et des archives. Il s'agit de comprendre le fonctionnement mais aussi d’interroger, voire de remettre en question le traitement complexe et multidimensionnel des collections coloniales opéré par les musées et, grâce aux connaissances acquises, de développer de nouvelles formes de traitement et donc de contribuer à les changer pour construire les pratiques de demain.
Orchestré par une équipe internationale et interdisciplinaire, ce séminaire est ouvert à tous et à toutes (sur inscription uniquement), aussi n’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous. Les séances se dérouleront en anglais et en français grâce à une traduction simultanée.
L'important, c'est de participer !

L'important, c'est de participer ! Pratiques participatives et responsabilité des professionnels de musée
Quelle place donner à l’expression de voix autres au sein du musée ? Comment assurer un vrai rôle de modérateur ? Comment former les professionnels de musée à ces exercices spécifiques et difficiles ? Face à une société civile toujours plus désireuse d’être entendue et de participer à la vie des institutions, les initiatives inclusives fleurissent depuis quelques années dans les musées.
Trouver une juste place à ces pratiques, réussir à les encadrer sans les censurer et chercher les moyens pour bien les évaluer sont les questions qui ont été discutées lors de notre soirée-débat de déontologie du mardi 28 mars 2023.
Retrouvez ci-dessous les interventions de Luisa de Peña Díaz, membre d'ETHCOM - comité pour la déontologie de l'ICOM - et directrice fondatrice du musée mémorial de la résistance dominicaine ; Laurella Rinçon, directrice générale du MACte - Mémorial de l'esclavage - Guadeloupe ; Xavier de la Selle, président de la FEMS - fédération des écomusées et musées de société - et directeur des musées Gadagne (musée d'histoire de Lyon/musée des arts de la marionnette) ; Emilie Sitzia, muséologue, professeure à l'université d'Amsterdam et professeure associée à l'université de Maastricht ; Lina G. Tahan, présidente d'ICOM Ethics - comité international sur les questions éthiques - et chercheuse affiliée au département d'archéologie, Université de Cambridge, Royaume-Uni et Annabelle Ténèze, directrice du musée des Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse. Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directeur de l'Institut national du patrimoine), Emilie Girard (présidente d'ICOM France) et Emma Nardi (présidente de l'ICOM). Conclusion par Séverine Blenner-Michel (directrice des études et du département des conservateurs, Inp).
Modération : Marie-Laure Estignard (directrice du musée des Arts et Métiers)
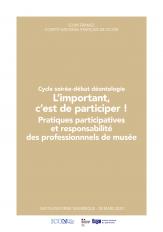
Les musées et l'open content - Session 1
Les musées et l'open content
Xavier Cailleau, de Wikimédia France, interviendra sur la promotion de l’ouverture des contenus culturels en numérisant œuvres et documents, afin les rendre librement accessibles. Cette démarche dessine une transformation profonde de nos stratégies et philosophies de travail.
Le Label Culture libre récompense et valide ces initiatives dédiées à l’open content et aux projets collaboratifs en musées...
Qui est Xavier Cailleau ?
Ayant intégré l'équipe de Wikimédia France en 2016 et travaillant depuis 2018 sur la question du rôle des projets Wikimedia dans les institutions culturelles, Xavier Cailleau accompagne de façon pédagogique les institutions ou réseaux qui souhaitent se lancer dans l'aventure.
Son rôle intègre un aspect pédagogique relatif à l'environnement Wikimedia et aux licences libres.

ID de réunion: 865 8027 7276
Code secret: 906367

Acquérir/ Approprier
SÉANCE 1 : Acquérir/ Approprier
L’Académie des Traces a pour ambition de mieux comprendre le défi sociétal majeur que représentent les collections coloniales conservées par les musées en Occident, indissociablement liées à une pluralité de mémoires toujours sensibles et souvent douloureuses.
L’Académie des Traces se propose de discuter les différents domaines du travail muséal en lien avec les collections coloniale: la recherche de provenance, les questions de restitution, d'exposition, de création artistique et de médiation, ainsi que de la politique de genèse des collections et des archives. Il s'agit de comprendre le fonctionnement mais aussi d’interroger, voire de remettre en question le traitement complexe et multidimensionnel des collections coloniales opéré par les musées et, grâce aux connaissances acquises, de développer de nouvelles formes de traitement et donc de contribuer à les changer pour construire les pratiques de demain.
Orchestré par une équipe internationale et interdisciplinaire, ce séminaire est ouvert à tous et à toutes (sur inscription uniquement), aussi n’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous. Les séances se dérouleront en anglais et en français grâce à une traduction simultanée.
La création contemporaine dans les écomusées et musées de société

Commençons par tordre le coup à quelques idées reçues ou véhiculées dans les médias, qui ont pu émettre l’hypothèse que les écomusées et musées de société, dans un contexte de crise existentielle, se tourneraient vers la création par conviction, effet de mode ou opportunisme.
Eh bien non, la rencontre entre les écomusées et musées de société et la création contemporaine n’est pas récente, qu’il s’agisse des arts
visuels, scéniques ou de l’écriture.
Sans remonter aux sources des musées d’ethnographie, où la main de l’artiste pouvait être déjà bien présente, rappelons l’appétence de la figure tutélaire de Georges Henri Rivière pour les artistes de son temps. L’exposition Voir, c’est comprendre, présentée au Mucem en 2018-19 montrait les connivences et les amitiés, les inspirations du muséologue, également musicien, mais aussi fin observateur de la société : il portait l’idée d’un musée inscrit dans son temps, avec tout ce qu’apportent les années folles, de l’art moderne au jazz et à la mode, de la photographie et du cinéma au music-hall, et comment cela peut rejaillir dans le musée ¹.
Aussi, le choix de faire du lien entre création contemporaine et musée de société s’est naturellement imposé comme légitime pour conclure ce cycle de rencontres consacré à la muséographie, après les deux éditions précédentes portant sur l’engagement et les héritages.
Cette rencontre, si elle s’inscrit dans la durée, dans le projet du musée, est riche de sens. À la différence d’un musée d’art où la création actuelle constitue généralement l’aboutissement naturel d’un propos, cette rencontre revêt, par la confrontation avec des objets relevant d’autres domaines, une autre valeur, discursive. Qu’attendons-nous donc de celle-ci ? S’agit-il de prolonger l’utopie de l’approche pluri ou transdisciplinaire des écomusées, de mettre en perspective nos collections ou de tisser des liens entre les objets et savoir-faire d’hier et ceux d’aujourd’hui ?
L’enquête lancée courant 2022 auprès du réseau sur le sujet, à laquelle un quart des adhérents a répondu, nous montre que les motivations varient selon les musées. Elles sont intimement liées à leur projet scientifique et culturel, leur territoire, et des formes d’actions spécifiques à chacun en découlent. Toutefois, quelques indicateurs nous montrent des tendances de fond : plus des trois quarts des répondants affirment réaliser des acquisitions dans le champ de la création, par don, achat, commandes ou résidences. Les formes artistiques couvrent un large champ, de la photographie à des œuvres monumentales qui prennent part à la scénographie. La mobilisation du corpus de collection est aussi souvent citée comme source d’inspiration pour les artistes : n’est-ce donc pas aussi un héritage de notre famille muséale à mieux assumer voire revendiquer, car au moment de leur création, de nombreux musées d’art et traditions populaires avaient été pensés comme des répertoires formels à même d’inspirer la création, voire d’en raviver le souffle.
En miroir de notre propre démarche, de nombreux artistes défendent le lien qu’ils souhaitent nouer avec un territoire, son histoire, ses habitants. Leurs créations se veulent souvent des révélateurs et leur démarche témoigne d’un engagement, rejoignant, par certains aspects, celui que nous défendons au sein du réseau.
Les textes rassemblés ici prolongent les échanges fructueux noués à l’occasion des Rencontres Professionnelles de la FEMS 2023 dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Que tous les auteurs et autrices, ainsi que le comité éditorial soient chaleureusement remerciés de leur contribution.
Céline Chanas
Directrice du Musée de Bretagne
Vice-Présidente de la FEMS

L’ICOM lance un appel à candidatures pour le poste de directeur général (F/M/X)
Le Conseil international des musées (ICOM) a le plaisir d’annoncer le lancement de l’appel à candidatures pour le poste de directeur.trice général.e.
La décision de lancer un appel à candidatures pour le poste de directeur général est une initiative qui permet à notre organisation de renouer avec son engagement en matière de transparence, de légitimité et de diversité. Elle marque une étape décisive dans la promotion d’une nouvelle ère de gouvernance et de responsabilité au sein de l’organisation.
Figure clé du prochain chapitre de l’ICOM, le directeur.trice général.e sera chargé de superviser les opérations quotidiennes, de maintenir une communication efficace entre le secrétariat et les organes de gouvernance, et de favoriser les relations de collaboration avec les différentes parties prenantes.
Nous encourageons les personnes qualifiées et passionnées à postuler et à contribuer au dynamisme de l’ICOM et de la communauté muséale mondiale. L’ICOM s’engage à respecter l’égalité des chances et la diversité dans son processus de recrutement.
Date limite de candidature : 17 mars 2024

