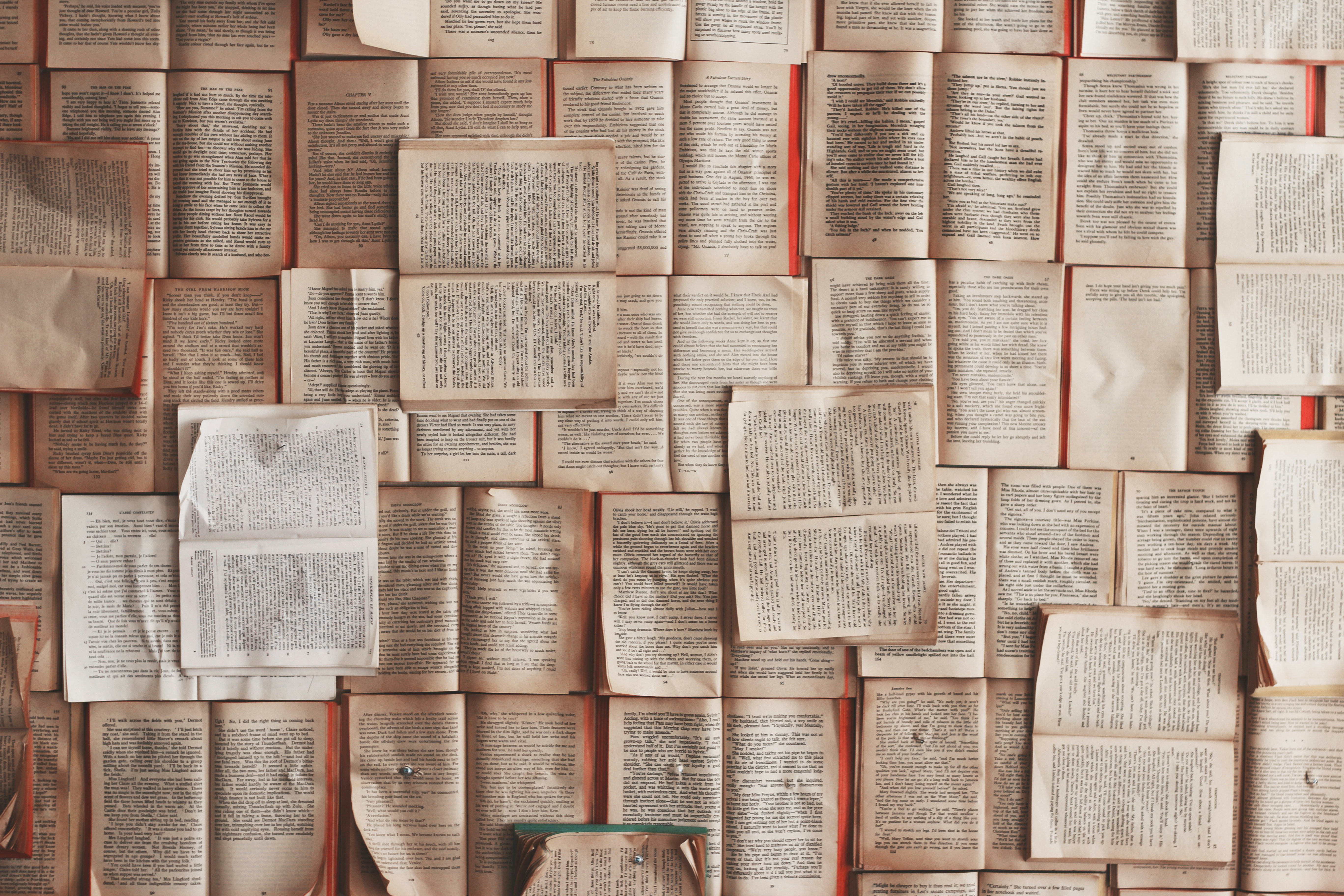Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Les musées et l'open content - Session 1
Les musées et l'open content
Xavier Cailleau, de Wikimédia France, interviendra sur la promotion de l’ouverture des contenus culturels en numérisant œuvres et documents, afin les rendre librement accessibles. Cette démarche dessine une transformation profonde de nos stratégies et philosophies de travail.
Le Label Culture libre récompense et valide ces initiatives dédiées à l’open content et aux projets collaboratifs en musées...
Qui est Xavier Cailleau ?
Ayant intégré l'équipe de Wikimédia France en 2016 et travaillant depuis 2018 sur la question du rôle des projets Wikimedia dans les institutions culturelles, Xavier Cailleau accompagne de façon pédagogique les institutions ou réseaux qui souhaitent se lancer dans l'aventure.
Son rôle intègre un aspect pédagogique relatif à l'environnement Wikimedia et aux licences libres.


Appel d'offres : référentiel carbone des musées en France
Contexte
La nouvelle définition des musées, adoptée lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Conseil international des musées (ICOM) à Prague, le 24 août 2022, comporte une ambition écologique : « Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. (…) »
Parallèlement, ICOM-France a fait des questions de durabilité et de transition écologique un des axes forts de la mandature actuelle.
De son côté, le ministère de la Culture a présenté en décembre 2023 ses orientations pour la transition écologique du secteur culturel en France, qui transcrit les engagements du Gouvernement pour les domaines d’activité relevant de ses compétences. Il s’agit d’appuyer les filières culturelles pour leur permettre de faire face aux trois défis du changement climatique, de la crise de la biodiversité et de la crise des ressources et de la pollution. En matière notamment de décarbonation, le ministère préconise et soutient des stratégies par filière d’institutions culturelles, pour qu’elles s’entendent sur les enjeux, les priorités et les actions à mener. Des « référentiels carbone » sont ainsi en train d’être mis en place pour les scènes labellisées ou encore les écoles de la création.
Présentation du projet
ICOM-France souhaite accompagner et faciliter la transition écologique des musées en France.
La mise en place d'un référentiel carbone à destination des petits et moyens musées de son réseau figure parmi les projets menés en 2024.
Ce projet réunira une quinzaine de musées qui seront invités à effectuer leur bilan carbone selon une méthodologie agréée par l'Etat (ADEME) et adaptée au secteur. Son objectif est de concevoir un outil de mesure d'empreinte carbone réplicable pour l'ensemble des petits et moyens musées pour lesquels le bilan carbone n'est pas encore obligatoire.
Retrouvez en pièce jointe l'appel d'offres destiné à choisir le prestataire de ce projet.
Contact pour obtenir plus d'informations : musees.icomfrance@gmail.com / Anne-Claude Morice - déléguée générale

Journée Wikimedia France 2024
La 5e édition de la Journée Wikimedia France 2024, Culture et Numérique se tiendra le mercredi 10 avril à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Paris 2e, avec le soutien du Club Innovation & Culture CLIC France et des Archives nationales.
L’édition 2024 reviendra sur le projet de contribution à Wikipédia par des étudiants de l'École du Louvre en partenariat avec des musées.
Ces musées ont pour certains obtenu en 2023 le Label Culture Libre. Une façon d'introduire la cérémonie de présentation des labellisés 2024 dont certains projets open content seront présentés à l'assemblée.
Wikimédia France sera heureuse de proposer aux premiers inscrits un atelier autour d'OpenRefine, pour découvrir l'outil d'alignement des données qui permet également de verser des images sur Wikimédia Commons.
En parallèle, la salle Vasari permettra aux participants de découvrir le rôle et la place des institutions culturelles au sein des projets Wikimedia par l'appréhension du fonctionnement de la communauté de contributeurs et la découverte de bonnes pratiques.
Depuis 2019, ces journées ont pour vocation de réunir les institutions culturelles sensibilisées au rôle des projets Wikimedia dans leurs stratégies numériques. Des rencontres qui les invitent à briser les préjugés et à entamer des démarches de contribution collaborative.
ICOM voices
Pour encourager l'échange d'expériences et d'expertises entre professionnels des musées, l'ICOM a créé en 2020 un espace éditorial sur son site Internet, appelé ICOM Voices
Tous les membres et comités de l'ICOM sont invités à soumettre des articles en anglais, français ou espagnol qui sont ensuite traduits et publiés en libre accès sur le site de l'ICOM.
Les articles peuvent être des études de cas, des rapports de terrain, des critiques de livres, des critiques d'expositions ou de conférences ; des articles d'opinion, etc. Ils peuvent aussi être le fruit d'une solidarité ou de projets particuliers, si vous souhaitez partager une expérience.
L'ICOM publie actuellement 2 articles par mois, l'appel à communications est donc constamment ouvert aux propositions, sans date limite ni limite de sujets. Veuillez noter qu'une équipe éditoriale est présente pour vous soutenir et vous accompagner.
L'appel à communications actuel accueille des articles liés, sans toutefois s'y limiter : aux droits de l'homme, aux questions sociales et à l'éthique.
Vous trouverez toutes les informations concernant cet appel ici :
Les membres
Ammonite, azurite, rhyolite… Enjeux de la conservation-restauration des collections de sciences de la Terre
Les collections d’histoire naturelle sont hébergées dans des établissements très divers : muséums, musées territoriaux, universités. Elles ont généralement été collectées à des fins scientifiques, et la nécessité de les patrimonialiser correspond à une orientation assez récente, qui influence fortement leur gestion et leur conservation.
Un premier tour d’horizon de la conservation des collections d’histoire naturelle a été mené au cours de la journée d’études « Poils, plumes et écailles » organisée en novembre 2022. Il s’agit ici de poursuivre les échanges et réflexions avec une nouvelle journée, intitulée « Ammonite, azurite, rhyolite… », qui propose d’aborder plus spécifiquement la conservation matérielle des collections des sciences de la Terre.
Un questionnaire adressé à la communauté en charge de ces collections (via le réseau Geocollections) a permis de définir des thèmes de préoccupation dans un domaine où la bibliographie dédiée manque. À travers cette journée organisée en partenariat entre l’Institut national du patrimoine, le Muséum national d’histoire naturelle, le réseau Geocollections et la Conférence permanente des muséums de France, il est proposé de croiser ces questions avec les expériences d’autres champs patrimoniaux confrontés à des matériaux relativement similaires, et donc à des problématiques proches, pour envisager des modèles inspirants.
Comité d’organisation
Marie-Béatrice Forel, maître de conférences (HDR), responsable scientifique des collections de paléontologie, Muséum national d’histoire naturelle ; Véronique Rouchon, professeure, Muséum national d’histoire naturelle, membre du Centre de Recherche sur la Conservation (CRC, UAR 3224), coordinatrice scientifique du département des restaurateurs de l'Institut national du patrimoine (Inp), membre du conseil d’administration de la Fondation des sciences du patrimoine (FSP) ; Damien Gendry, assistant de collections, musée de Géologie de l’université de Rennes (laboratoire Géosciences-Rennes, UMR 6118) ; François Dusoulier, conservateur en chef du patrimoine, en charge du Réseau national des collections naturalistes, Muséum national d’histoire naturelle ; Anne Médard, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du Muséum d’histoire naturelle de Marseille ; Jacques Cuisin, délégué à la conservation-restauration, Muséum national d’histoire naturelle ; Amélie Méthivier, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs de l’Inp ; Nathalie Le Dantec, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs de l’Inp, responsable de la formation continue ; Sandie Le Conte, responsable du laboratoire de recherches de l’Inp ; Émilie Maume, responsable de la programmation et des publications scientifiques de l’Inp.
Informations pratiques
Entrée libre sur inscription.
La journée d'études aura lieu à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein - 2 rue Vivienne - 75002 Paris
La nature du patrimoine : Inventer une relation de connivence entre nature et culture
Pour la sixième année consécutive, les élèves conservateurs de l'Institut national du patrimoine (INP) organisent conjointement avec les doctorants de l'Institut des Sciences sociales du Politique (ISP – UMR 7220) une journée d'études portant sur des problématiques communes au droit et au patrimoine.
Ce colloque investira, en quatre séquences, les voies selon lesquelles le droit et les doctrines de conservation du patrimoine ainsi que les pratiques juridiques et patrimoniales qui en découlent, font obstacle ou peuvent déborder la dialectique nature-culture et, dans ces dépassements, susciter de nouvelles formes de patrimonialisation, concentrées sur les émotions, les hybridations et les relations de connivences de la nature et de la culture.

Un musée dans un Monument historique : regards croisés pour une ambition commune
Fort de son expérience d’installation de musées dans des Monuments historiques, le Département de l’Isère propose la tenue de journées d’étude nationales en partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et l’Institut National du Patrimoine
À travers le partage d’expériences en plénière (interventions et tables rondes) et lors de visites commentées des musées, de nombreux spécialistes aborderont les enjeux et les étapes de ces projets spécifiques et complexes en s’arrêtant sur des cas concrets touchant aux différentes phases du projet : programmation, choix de l’équipe de maitrise d’œuvre, synergie avec les services de l’État, conduite de l’opération...
Programme
Jeudi 16 mai
Hémicycle de l’Hôtel du Département
9h15 | Accueil du public
9h45 | Mot d’accueil et introduction
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère
Modératrice : Sophie Onimus-Carrias, conseillère pour les musées - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
9h55 | Présentation des musées et des projets du Département de l’Isère
Aymeric Perroy, Directeur - Direction de la culture, du patrimoine et de la coopération internationale - Département de l’Isère
10h20 | Rappels historiques sur 70 ans de projets et réalisations
Jean-Marc Zuretti, Directeur de l'Ecole de Chaillot
10h45 | Valorisation patrimoniale d’un monument par le projet contemporain du musée : situations pédagogiques
François Tran, Architecte et Maître de conférences émérite des Ecoles Nationales Supérieure d’Architecture
11h10 | Table ronde "Le point de vue du musée : un musée dans un monument historique, opportunités ou contraintes pour le gestionnaire ?"
Richard Dagorne (Directeur du palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain et du département « Musées, arts visuels et valorisation du patrimoine » de la Ville de Nancy), Sandrine Champion (Conservatrice en chef, Musées de la Ville de Dijon) et Aurélie Samson (Directrice du Museon Arlaten, conservatrice en chef)
12h | Questions du public
Visites des musées
Musée Hébert avec Fabienne Pluchart (directrice du musée) et Asja Bajbutovic (consultant, AB PROGRAMMATION) | 15h
Maison Bergès avec Sophie Mouton (directrice du musée), Jacques Scrittori (architecte) et Patrick Charra (architecte) | 16h30
Musée Savoisien avec Marie-Anne Guérin (directrice du Musée Savoisien, DPAM), Sébastien Gosselin (directeur-adjoint du Musée Savoisien, DPAM), Ludovic Maîtrehanche (chargé d’opération, DBMG) et Marc Jorcin (Directeur adjoint constructions et performance énergétique, DBMG) | 15h30
18h30 | Cocktail au Musée dauphinois, Grenoble
Vendredi 17 mai
Hémicycle de l’Hôtel du Département
9h | Accueil
Modératrice : Caroline Dugand, Directrice du Musée Champollion à Vif
9h30 | Du chantier au musée. Conservation et sauvegarde par l’étude du patrimoine archéologique : enjeux et procédures
Emma Bouvard-Mor, Conservatrice du patrimoine, DRAC – service régional de l’archéologie Auvergne-Rhône-Alpes, site de Lyon
9h50 | Musées et monuments historiques, rôle et fonction ? Les exemples dans les Hauts-de-France
Franck Sénant, directeur régional adjoint délégué en charge des patrimoines, DRAC Hauts-de-France
10h15 | Du soin des corps aux soins des choses : de l’ancien hôpital au musée de demain – itinéraire de l’Hospice Comtesse, musée d’art et d’histoire de Lille
Florence Raymond, Cheffe de la conservation et de la médiation au Musée Hospice Comtesse Lille
10h35 | Questions
10h45 | Pause
11h | Table ronde sur les différentes phases du projet : de la définition du programme à la conduite du projet côté maîtrise d’ouvrage et équipe de maitrise d’œuvre
Asja Bajbutovic (consultant, AB PROGRAMMATION), Marine Guitton (Architecte, associée de l’atelier Novembre), Nathalie Crinière (Scénographe - Agence NC) et Jean-Baptiste Rezvoy (ingénieur et chef de Projet de musée d’Autun)
12h10 | Questions
12h20 | Conclusions
Patrick Curtaud, Vice-président à la culture, au patrimoine et à la coopération internationale
Marc Drouet, Directeur régional DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Visites des musées
Musée Hébert avec Fabienne Pluchart (directrice du musée) et Asja Bajbutovic (consultant, AB PROGRAMMATION) | 15h
Maison Bergès avec Sophie Mouton (directrice du musée), Jacques Scrittori (architecte) et Patrick Charra (architecte) | 16h30
Musée Savoisien avec Marie-Anne Guérin (directrice du Musée Savoisien, DPAM), Sébastien Gosselin (directeur-adjoint du Musée Savoisien, DPAM), Ludovic Maîtrehanche (chargé d’opération, DBMG) et Marc Jorcin (Directeur adjoint constructions et performance énergétique, DBMG) | 15h30
Gratuit - Inscription obligatoire (places limitées)
Assises des restaurations après inondation au musée Girodet
Sept ans après l’inondation de la réserve temporaire du musée Girodet, le 31 mai 2016, et le sinistre de 86 % de la collection, une journée d’échanges est consacrée aux interventions de conservation-restauration réalisées depuis sur 180 peintures, 1 232 feuilles d’art graphiques, 380 sculptures, 2 cercueils égyptiens et une momie.
Organisées en partenariat avec l’Institut national du patrimoine – département des restaurateurs, avec des interventions de professionnels de la conservation-restauration ayant participé au sauvetage et aux interventions, ces assises ouvertes à tous seront l’occasion d’échanger sur les questions soulevées par des dommages inédits comme sur les pratiques de la restauration.
Le 31 mai 2016 la ville de Montargis connaissait une inondation exceptionnelle suite à la rupture du canal de Briare en amont de la ville sous la pression de la crue des cours d’eau du bassin du Loing. Les œuvres du musée Girodet conservées dans une réserve en second sous-sols pendant les travaux de rénovation du bâtiment furent immergées trois jours durant. Dès que le pompage de l’eau eut permis un accès à la réserve, la chaîne d’extraction et de mesures d’urgence pût se mettre en place.
Comment répond-on à cette urgence, comment organise-t-on les équipes en suivant quelles étapes ? Comment choisit-on telle ou telle mesure dans un contexte de dégradation extrême, comment gère-t-on le séchage puis la surveillance ? Enfin quel retour sur l’état de conservation des œuvres lorsqu’elles sont prises en charge par les conservateurs-restaurateurs, quel retour sur les choix faits dans l’urgence ?
Ce sont toutes ces questions que cette journée d’étude se propose d’aborder au travers des témoignages des conservateurs-restaurateurs, sur place dès après le sinistre ou lors du traitement en vue de la ré-exposition des œuvres.
Comité scientifique
Amélie Méthivier, adjointe au directeur des études, département des restaurateurs, Inp, Eléonore Kissel, responsable du pôle conservation, musée du Quai-Branly - Jacques Chirac et Sidonie Lemeux-Fraitot, directrice du musée Girodet.
Informations pratiques et inscription
La journée d'études se tiendra au musée Girodet, 2 rue du Faubourg de la Chaussée à Montargis et sera retransmise sur la chaîne Youtube de l’Agglomération Montargoise.
Entrée libre sur inscription par téléphone au 33 (0) 2 38 98 07 81 ou par courriez électronique à : reservations@musee-girodet.fr
Les actes de colloque français/anglais de la manifestation seront publiés prochainement.
Déclaration condamnant la violence à l’encontre des personnes et de leur patrimoine culturel
Depuis la première déclaration concernant Israël et la Palestine publiée le 25 octobre 2023, l’ICOM continue de constater avec beaucoup de tristesse et d’inquiétude la poursuite et l’expansion de la violence et déplore le nombre toujours croissant de personnes ayant perdu la vie. L’ICOM s’oppose fermement à toute action mettant en danger les civils et exprime sa plus profonde solidarité envers ceux qui souffrent.
C’est donc dans cet esprit de respect pour la vie et l’expérience humaine que l’ICOM évoque, une fois de plus, la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé – à laquelle Israël et la Palestine sont parties – et l’obligation qui incombe à toutes les parties de protéger et de respecter les civils et les biens civils, y compris leur patrimoine culturel. En outre, l’ICOM rappelle à toutes les parties l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui dispose que la protection et la promotion de la culture est un impératif des droits de l’homme.
L’ICOM considère donc que les dommages et les frappes ciblées contre les musées et les sites culturels sont inacceptables et constituent une violation manifeste du droit international humanitaire et, de fait, de l’humanité dans son ensemble. À ce titre, l’ICOM appelle une fois de plus à la cessation immédiate de toute action mettant les civils en danger et exposant leur patrimoine culturel à des risques de dommages, de destruction, de vol, de pillage ou de trafic illicite.
Dans ce contexte, l’ICOM souhaite également exprimer sa solidarité envers tous les peuples de la région et attirer l’attention du public sur les nombreuses autres personnes en danger et victimes de violence. L’ICOM continue de soutenir les efforts de la communauté internationale visant à protéger les personnes et leur patrimoine dans de telles situations et, en collaboration avec les ONG et les OIG partenaires, poursuit le développement et la diffusion de ressources et de programmes, notamment en matière de préparation et de réponse aux situations d’urgence. Ces programmes et ressources visent à aider les professionnels des musées à protéger les institutions muséales ainsi que le patrimoine culturel en général, et l’ICOM espère que ces éléments contribueront à la reconstruction de la paix.