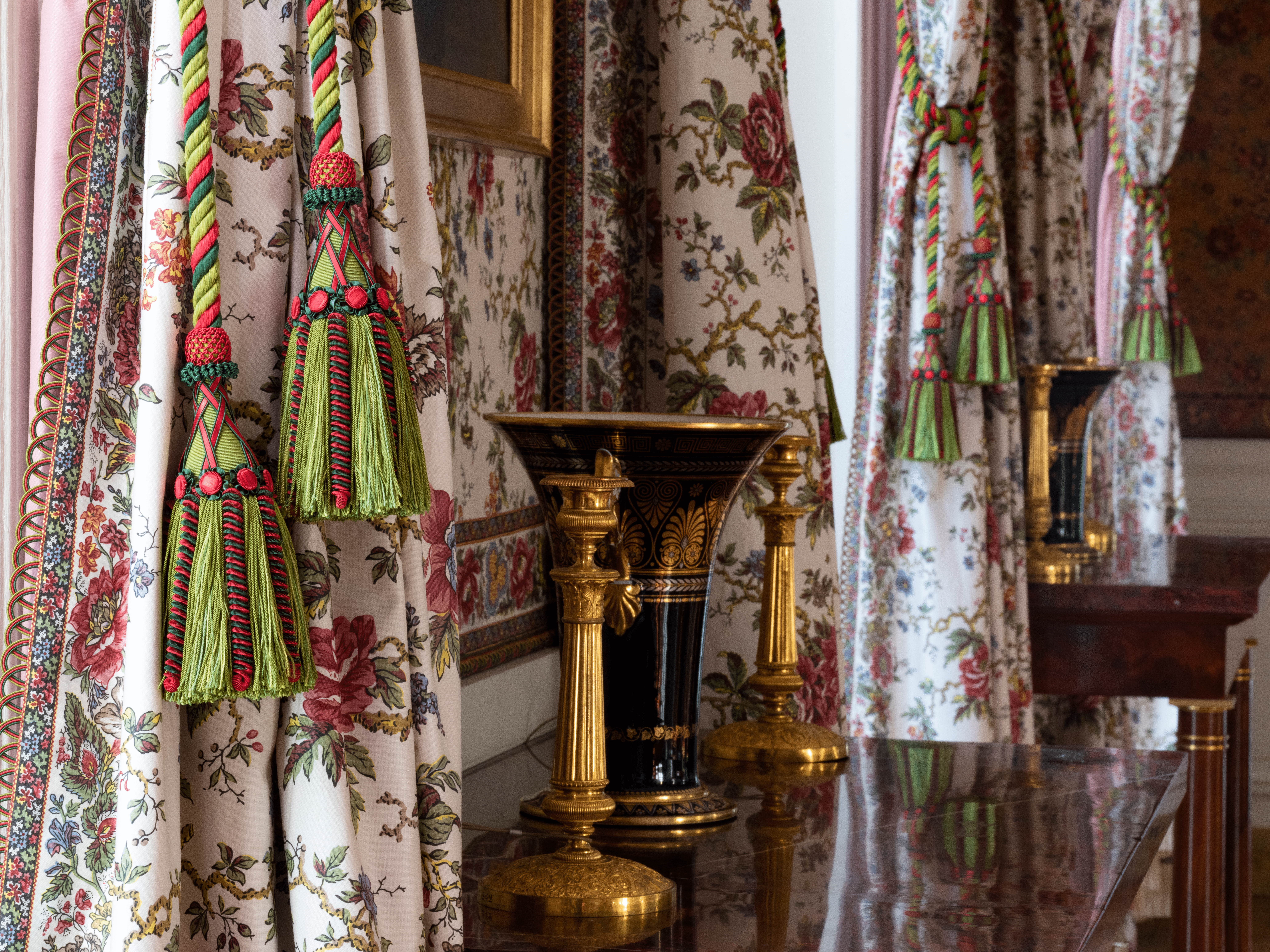Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Conférence générale du comité CIPEG - 2024
La Conférence générale annuelle du CIPEG - Comité international pour l'égyptologie de l'ICOM - se tiendra cette année en Espagne à Madrid sur le thème : Faire du neuf avec de l'ancien : réaménager les espaces muséaux des collections égyptiennes
Les communications relatives au thème de la conférence sont désormais attendues. Les communications doivent traiter de la manière dont les espaces d'exposition existants peuvent être, ou ont été, modifiés et améliorés par des modifications architecturales, des changements dans les vitrines, l'étiquetage, les panneaux de texte, les interactifs, l'éclairage, les graphiques et les schémas de couleurs. Nos nombreux membres, qui représentent à la fois de grandes et de petites institutions, partageront leurs expériences en matière d'actualisation et de modification des espaces de leurs galeries. Une partie de la conférence sera également consacrée à d'éventuelles communications sur d'autres sujets liés aux collections égyptiennes et soudanaises.
Si vous souhaitez présenter une communication lors de la réunion annuelle du CIPEG 2024, veuillez envoyer le titre et un résumé de 300 mots maximum (en anglais) à la présidente, Tine Bagh : tiba@glyptoteket.dk et à la secrétaire, Daniela Picchi : daniela.picchi@comune.bologna.it
Les communications dureront 15 minutes et seront suivies d'une discussion de 5 minutes.
Les résumés doivent être soumis sous forme de fichiers Word avec le formulaire d'inscription (voir ci-contre). Veuillez indiquer votre nom, votre titre, votre affiliation institutionnelle (le cas échéant) et vos coordonnées complètes.
La date limite de soumission des résumés est fixée au 15 juin 2024 !
Conférence générale du comité CIPEG - 2024
La Conférence générale annuelle du CIPEG - Comité international pour l'égyptologie de l'ICOM - se tiendra cette année en Espagne à Madrid sur le thème : Faire du neuf avec de l'ancien : réaménager les espaces muséaux des collections égyptiennes
Les communications traiteront de la manière dont les espaces d'exposition existants peuvent être, ou ont été, modifiés et améliorés par des modifications architecturales, des changements dans les vitrines, l'étiquetage, les panneaux de texte, les interactifs, l'éclairage, les graphiques et les schémas de couleurs.
Nos nombreux membres, qui représentent à la fois de grandes et de petites institutions, partageront leurs expériences en matière d'actualisation et de modification des espaces de leurs galeries. Une partie de la conférence sera également consacrée à d'éventuelles communications sur d'autres sujets liés aux collections égyptiennes et soudanaises.
Informations complémentaires à venir...
Annonce de la conférence, programme et inscription ci-contre
Conférence générale du comité CIPEG - 2024
La Conférence générale annuelle du CIPEG - Comité international pour l'égyptologie de l'ICOM - se tiendra cette année en Espagne à Madrid sur le thème : Faire du neuf avec de l'ancien : réaménager les espaces muséaux des collections égyptiennes
Les communications traiteront de la manière dont les espaces d'exposition existants peuvent être, ou ont été, modifiés et améliorés par des modifications architecturales, des changements dans les vitrines, l'étiquetage, les panneaux de texte, les interactifs, l'éclairage, les graphiques et les schémas de couleurs.
Nos nombreux membres, qui représentent à la fois de grandes et de petites institutions, partageront leurs expériences en matière d'actualisation et de modification des espaces de leurs galeries. Une partie de la conférence sera également consacrée à d'éventuelles communications sur d'autres sujets liés aux collections égyptiennes et soudanaises.
Informations complémentaires à venir...
Annonce de la conférence, programme et inscription ci-contre
Paris-musées & la durabilité : nouveaux outils au service des expositions
Paris musées & la durabilité : nouveaux outils au service des expositions
Julie Bertrand, directrice des expositions et des publications de Paris musées ainsi que Clémence Raunet, responsable développement durable / RSO de Paris musées, interviendront dans notre session des 52 minutes d'ICOM France du 25 avril prochain.
Depuis la création de l’établissement public Paris Musées en 2013, les scénographies ou les éléments scénographiques des expositions temporaires sont pensés en vue de leur réutilisation. Depuis 2020, cette politique s’est renforcée et une véritable logique d’économie circulaire s’est mise en place. Les expositions sont anticipées et programmées en amont pour permettre de concevoir le projet en y intégrant les enjeux de développement durable aux différentes phases des réflexions et innovations.
Dans le cadre des « 52 minutes d’ICOM France », Paris Musées présentera ses outils de pilotage pour diminuer son impact environnemental
Ces deux outils, encore en phase de test, ont été réalisés avec la société d’ingénierie culturelle ATEMIA
- Le premier, finalisé au premier semestre 2022, permet de mesurer l’impact environnemental des expositions
- Le deuxième outil Eco-expo© est un outil d’auto-évaluation utilisé dès la phase de conception des programmes des expositions en mode « équipe projet »
Ces dispositifs sont pensés pour avoir une meilleure connaissance des impacts environnementaux et être mieux guidé dans les choix jalonnant la réalisation d’un projet.
La séance sera modérée par Laure Ménétrier, secrétaire d'ICOM France et directrice du musée de vin de Champagne et d'archéologie d'Epernay
ID de réunion: 899 9395 4331
Code secret: 707594
Qui est Julie Bertrand ?
Directrice des expositions et des publications de Paris musées, Julie Bertrand est titulaire d'un double master des Sciences de Gestion (Paris IX, Dauphine PSL) et d’Histoire de l’Art (Paris X, Nanterre) et d'un master 2 « Pouvoirs et représentations dans le monde contemporain » (Paris X, Nanterre). Elle a commencé sa carrière en 2000 à la production des expositions temporaires des musées de la Ville. Elle a ensuite participé à la mise en place de l’établissement public Paris Musées. Depuis la création de cet établissement, elle a assuré la coordination du service des expositions de 2013 à 2017, a été directrice adjointe de 2018 à 2020 et est, depuis juin 2020, directrice des expositions et des publications.

CR photo : A. Lepoutre
Qui est Clémence Raunet ?
Depuis 2022, Clémence Raunet est en charge du service développement durable à Paris Musées, établissement public qui gère les 14 musées et sites patrimoniaux de la Ville de Paris.
Diplômée en histoire et en communication de l’Université de Paris I et Paris II, Clémence Raunet travaille depuis dix ans à Paris Musées. Elle a d’abord été responsable communication avant de rejoindre le service des marchés publics. Elle était jusqu’à fin 2022 adjointe au chef des services achat et logistique où elle suivait une politique d’achat visant à réduire l’impact environnemental, social et économique de Paris Musées.

Qu'est ce que Paris musées ?
L'établissement public Paris musées rassemble les 14 musées et sites patrimoniaux de la Ville de Paris :
- Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
- Maison de Balzac
- Musée Bourdelle
- Musée Carnavalet - Histoire de Paris
- Les Catacombes de Paris
- Crypte archéologique de l'île de la Cité
- Musée Cernuschi - Musée des Arts asiatiques de la Ville de Paris
- Musée Zadkine
- Musée de la Vie romantique
- Musée Cognacq-Jay
- Palais Galliera, musée de la mode
- Musée du général Leclerc, de la Libération - musée Jean Moulin
- Petit Palais
- Maison de Victor Hugo Paris/Guernesey
En savoir plus sur Paris musées

Paris musées & la durabilité : nouveaux outils au service des expositions
Paris musées & la durabilité : nouveaux outils au service des expositions
Julie Bertrand, directrice des expositions et des publications de Paris musées ainsi que Clémence Raunet, responsable développement durable / RSO de Paris musées, sont intervenues dans notre session des 52 minutes d'ICOM France du 25 avril 2024.
Depuis la création de l’établissement public Paris Musées en 2013, les scénographies ou les éléments scénographiques des expositions temporaires sont pensés en vue de leur réutilisation. Depuis 2020, cette politique s’est renforcée et une véritable logique d’économie circulaire s’est mise en place. Les expositions sont anticipées et programmées en amont pour permettre de concevoir le projet en y intégrant les enjeux de développement durable aux différentes phases des réflexions et innovations.
Dans le cadre des « 52 minutes d’ICOM France », Paris Musées a présenté ses outils de pilotage pour diminuer son impact environnemental
La séance a été modérée par Laure Ménétrier, secrétaire d'ICOM France et directrice du musée de vin de Champagne et d'Archéologie régionale à Epernay
Journée de visites professionnelles - Château de Versailles
Compte-rendu de Journée internationale d’échanges professionnels organisée par ICOM France & ICOM COSTUME au Château de Versailles le mardi 14 mai 2024
La présidente du comité international de l’ICOM pour les musées et collections de Costume, Mode et Textiles, Corinne Thépaut-Cabasset, a invité les membres d’ICOM France à une journée de visites et d’échanges professionnels au domaine national des châteaux de Versailles et de Trianon, mardi 14 mai 2024
Orientées sur la thématique du textile et des toiles imprimées, ces visites ont mis à l’honneur trois secteurs du château habituellement fermés au public ainsi que la nouvelle exposition au Grand Trianon : « Soieries Impériales ». Trente membres d’ICOM France ont ainsi pu profiter de cette journée professionnelle.
-
Visites du matin
Accompagnés de Noémie Wansart, collaboratrice scientifique, nous avons pu visiter le château du Grand Trianon et la chambre-cabinet du roi Louis-Philippe, dont le décor originel en toile fleurie a été récemment rénové par la Maison Edmond Petit, grâce aux découvertes au Mobilier national et dans les réserves de Trianon, d’éléments de ces textiles d’origine.

Chambre-cabinet du roi Louis-Philippe au Grand Trianon. Visite du 14 mai.
La suite de la visite nous a conduit au sein de l’exposition « Soieries impériales pour Versailles, collection du Mobilier National », dont Noémie Wansart en est la co-commissaire. Présentée jusqu’au 23 juin 2024, cette exposition revient sur l’exceptionnelle commande de Napoléon 1er auprès de manufactures lyonnaises d’ensemble de soieries destinées à remeubler le château de Versailles.

Ensemble en soie du cabinet de repos du petit appartement de l’impératrice Marie-Louise. Jean-François Bony, 1811-1812.

Élément de tenture pour le troisième salon du grand appartement de l'Empereur, Grand Frères, 1811 – 1813.
-
Visites de l’après-midi
Hélène Delalex, conservateur du patrimoine et Bertrand Rondot, conservateur en chef du patrimoine nous ont guidés dans les petits cabinets intérieurs de la Reine Marie-Antoinette, qui se déploient au 1er et au 2ème étage du château. Cet ensemble de pièces aux dimensions modestes commence à être réaménagé par la reine Marie-Antoinette à partir de 1774.

Cabinet du Billard, appartements intérieurs de Marie-Antoinette, second étage. Soierie de 1787.

La salle à manger, appartements intérieurs de Marie-Antoinette, second étage. Réimpression des toiles d'après un motif original, dit de « l’ananas », conservé au Musée de la Toile de Jouy (maison Pierre Frey).
La journée de visites professionnelles s’est achevée au rez-de-chaussée du château, dans les appartements du Dauphin et de la Dauphine ainsi que dans la dernière section de salles réhabilitées par Marie-Antoinette en 1788.
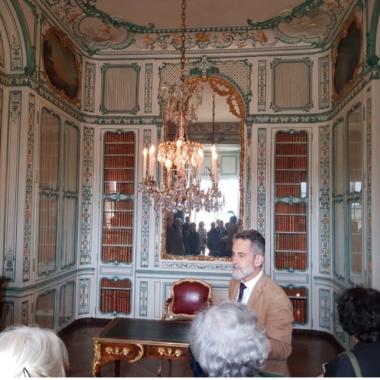
Bibliothèque de l’appartement du Dauphin et de la Dauphine, 1755-1756.

Détail des boiseries de la bibliothèque, 1755-1756.

Pièce des bains de Marie-Antoinette, 1788

Le groupe dans la cour de marbre.
Cette initiative du comité international Costume s’inscrit dans une volonté de faire connaître les nombreuses activités de ce comité ainsi que ses membres.
Bibliographie complémentaire :
- Article de N. Wansart et V. Bastien : http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2021/10/des-gouts-et-des-couleurs/
- Article de H. Delalex : http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2024/02/la-douceur-dune-vie-privee/
- Le Château de Versailles raconte le Mobilier national, sous la direction de Jean-Jacques Gautier et Bertrand Rondot aux éditions Skira / Flammarion Paris, 2011.
Vidéo youtube de la chaîne ICOM Costume sur la chambre-cabinet du roi Louis-Philippe :
Michel Laclotte (1929-2021)
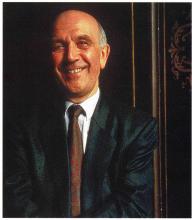
Homme de musées, Michel Laclotte a porté les grands projets qui façonnent toujours, aujourd’hui, le paysage muséal français, la mise en œuvre et l’accomplissement du grand Louvre, la création du musée d’Orsay, dédié à l’art de la seconde moitié du XIXe siècle, sous toutes ses facettes, dans une vision interdisciplinaire d’une grande modernité, la fondation de l’Institut national d’histoire de l’art, associant musées et universités, recherche et diffusion, dont sont célébrés cette année les 20 ans. Ce visionnaire, ce meneur d’équipes, était modeste. Il disait volontiers de lui-même qu’il avait eu beaucoup de chance. Sans doute, l’époque était riche d’opportunités. Mais il a eu surtout le talent de les saisir et de les transformer, avec une intelligence qui alliait à la fois un grand esprit et un grand cœur, un sens aigu des projets et une attention remarquable à tous et à chacun.
Cet homme capable de conduire les grandes institutions de son temps – il devint en décembre 1992 le premier Président-directeur de l’Etablissement public du musée du Louvre – était avant tout un historien d’art exceptionnel ; Michel Laclotte sut, malgré l’importance et les contraintes de ses charges, le demeurer. Né le 27 octobre 1929 à Saint Malo, il devint très tôt un grand spécialiste de la peinture italienne des XIVe et XVe siècles et des primitifs français. Il associait la sensibilité du goût à la rigueur de l’érudition ; ses travaux furent déterminants pour le développement de la connaissance dans ce domaine.
Les nombreuses expositions dont il fut le commissaire constituèrent des moments riches pour la pensée et la découverte. Qu’il soit permis d’en citer quelques-unes. Il présida ainsi à la première exposition dédiée à Georges de la Tour, en 1972, au musée de l’Orangerie. L’audace et l’intelligence de l’exposition Polyptiques, au Louvre en 1990, associant art ancien et création contemporaine, ont influencé bien des projets ultérieurs, jusqu’à la célébration fin 2019 du centenaire du peintre Pierre Soulages, au sein du Salon Carré du Louvre. En 1993, au Grand Palais, Le Siècle de Titien fut sa dernière grande exposition comme directeur du Louvre. Ce fut un rassemblement éblouissant de chefs-d’œuvre, célébrant le sens de la lumière et de la couleur des maîtres vénitiens.
Dès 1953, l’inventaire – et le rassemblement en un seul lieu – de la collection Campana, acquise sous Napoléon III, lui avait été confié. Ce projet consistait à remplacer les tableaux de la collection envoyés dans les musées de région par des dépôts du Louvre, venant compléter leurs collections. Cela représentait environ trois cents tableaux. Suite à l’exposition De Giotto à Bellini en 1956, la décision fut prise de créer un nouveau musée où serait exposée la collection Campana. En 1976, ouvrait ainsi le musée du Petit Palais en Avignon. La récente exposition Campana au Louvre permit de rappeler et de retracer ce beau projet. Bien que lié aux collections nationales et ayant fait toute sa carrière à Paris, Michel Laclotte demeura attentif au développement et aux rénovations des musées de région, fidèle à l’esprit collégial de l’inspection des Musées à laquelle il avait appartenu. Il fut ainsi, au fil des années, généreux de ses avis et de ses conseils pour celles et ceux, directeurs de musées, qui le sollicitaient.
La célébration des trente ans de la pyramide du Louvre, en 2019, avait permis de le retrouver et de rappeler à celui qui ne le faisait pas volontiers lui-même l’importance essentielle de son rôle. Toujours souriant et chaleureux, Michel Laclotte était un homme déterminé. C’est ce qui lui permit d’être présent au cœur des échanges entre le président de la République, François Mitterrand, et l’architecte, mondialement célébré, Ieoh Ming Pei. Présent sans outrances et sans exagérations mais avec fermeté et sagesse, apportant sa connaissance insigne du musée, de ses collections et de ses équipes. Cet homme discret était un meneur d’hommes. Sans brutalité ni autoritarisme. Il leur préférait le sens de l’écoute – sa porte était toujours ouverte, même aux plus jeunes et aux moins expérimentés -, et celui d’une distance bienveillante teintée d’humour qui lui permettait de trouver pour chaque difficulté sa solution et de ramener chacune et chacun à son juste rôle, pour le succès des projets, et la joie de celles et ceux venus le solliciter.
Ces qualités qui le distinguaient le désignaient et le désignent toujours en modèle du dirigeant de musée, hier comme aujourd’hui. C’est avec une grande émotion que nous lui rendons hommage.
Dominique de Font-Réaulx,
Conservateur général - Directrice de la Médiation et de la Programmation culturelle
Musée du Louvre
Image : (c) Musée du Louvre
Les musées d'histoire de ville
La Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur du CNFPT et l'association Musées Méditerranée, en collaboration avec le Musée d’Histoire de Marseille (Ville de Marseille), s'associent pour vous proposer un événement autour des musées d'histoire de ville.
Le terme "histoire de ville" recèle une grande diversité de lieux aux identités et aux collections riches et variées, où se raconte l'histoire urbaine : mémoriaux, centres d'interprétation, musées de site, hors les murs, etc. L'un des enjeux de ces établissements est d’inscrire leurs projets scientifiques et culturels au cœur des évolutions sociales, sociétales, économiques, environnementales des villes d'aujourd'hui. De musées parfois considérés du passé, ils deviennent plus que jamais musées du présent et du futur.
Ces deux journées d'étude seront l'occasion de témoignages, d'inspirations, de perspectives et d'échanges grâce à la présence de conférenciers issus du monde patrimonial.
Programme et informations complémentaires ci-contre
Réalités nouvelles, galerie Charpentier, Paris, 1939 : heurs et malheurs de l’abstraction
Réalités nouvelles (galerie Charpentier, été 1939) est vraisemblablement la plus complète exposition d’art abstrait organisée en France à cette date, in extremis, dans les bruits de bottes et à la veille de la dispersion générale.
En pensant les trajectoires d’œuvres et de personnes, les circulations d’idées, le devenir des artistes ici rassemblés, nous chercherons à comprendre l’exposition dans le contexte parisien et international qui lui est propre. Nous penserons Réalités nouvelles comme un rhizome, un réseau, comme une géographie méconnue et un faisceau de microhistoires concourant, ensemble, à un portrait de l’avant-garde aux abords de et pendant la Seconde Guerre mondiale.
À l’occasion des ateliers de recherche, l’INHA et la Bibliothèque Kandinsky invitent les plus éminents spécialistes des artistes inclus dans Réalités nouvelles, et/ou des collectionneurs et critiques impliqués dans l’exposition, pour reconstituer une page oubliée de l’histoire des avant-gardes à la veille de et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’un moment collaboratif d’échange et de partage, de discussion, de mise en commun des savoirs. L’atelier de recherche est ouvert au public.
En partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky, MNAM/Centre Georges-Pompidou
Responsables scientifiques
Cécile Bargues (INHA), Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky)
Parmi les intervenants et les intervenantes
Vincent Baby (INHA), Laura Braverman (Fondation Giacometti), Jean-François Chevrier (chercheur et commissaire d’exposition), Wietse Coeppes (RKD, Hollande), Hugo Daniel (Fondation Giacometti), Waleria Dorogowa (Bard Graduate Center, New York), Nathalie Ernoult (MNAM / Centre Georges-Pompidou), Isabelle Ewig (Sorbonne Université), IrinaGenova (Nouvelle Université bulgare, Sofia), Nina Gioria (École du Louvre), Patrick de Haas (chercheur), Nicolas Liucci-Goutnikov (Bibliothèque Kandinsky), Anne Montfort-Tanguy (MNAM / Centre Georges-Pompidou), Camille Morando (MNAM / Centre Georges-Pompidou), Domitille d’Orgeval (chercheuse et commissaire d’exposition), Arnauld Pierre (Sorbonne Université), Élia Pijollet (chercheuse et commissaire d’exposition), Christine Scharf (université d’Heidelberg), Didier Schulmann (conservateur à la retraite et enseignant à l’École duLouvre), Merse Pál Szeredi (musée Lajos Kassák, Budapest), Julie Verlaine (université de Tours)
Faut-il prendre d’assaut les musées pour les rendre écologiques ?
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage L’écologie des musées. Un après-midi au Louvre aux Éditions Macula, l’auteur présentera son enquête dans les archives et la documentation du musée afin de rendre visible toutes les entités non-humaines qui ont été bloquées à l’intérieur et invisibilisées lorsque l’idée de musée a été inventée.
Avec l’auteur, Grégory Quenet, historien de l’environnement, professeur en histoire moderne à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines, Françoise Mardrus, directrice des études muséales et de l’appui à la recherche et Donatien Grau, conseiller de la Présidente-directrice pour les programmes contemporains, musée du Louvre.
Adresse :
Le Centre Dominique-Vivant Denon
Musée du Louvre,
75058 Paris Cedex 01