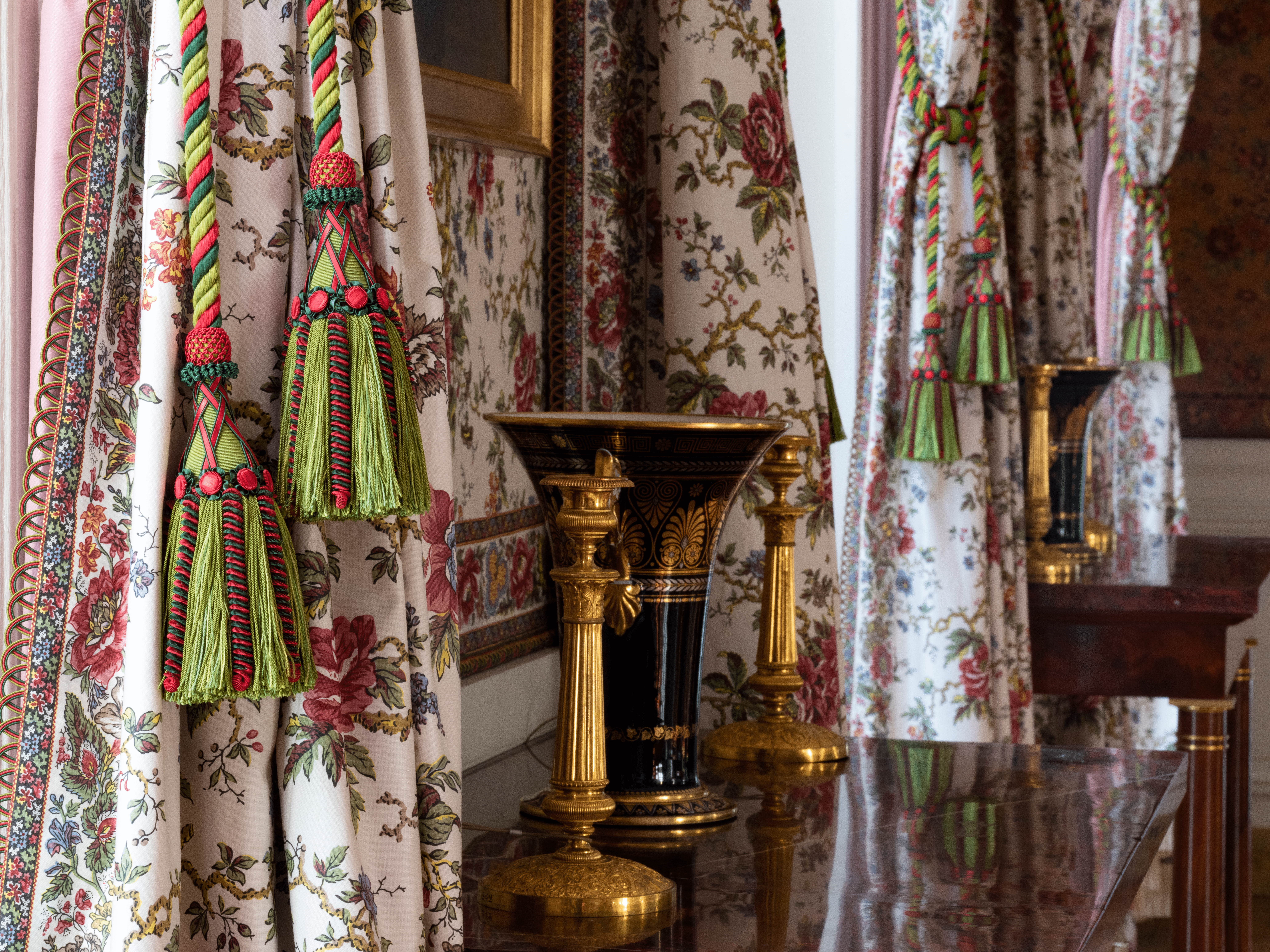Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Chantier de longue durée ou complexe : la gestion de projet en conservation-restauration
Du 4 au 5 novembre 2024, cette formation abordera dans un premier temps les principes clés et la méthodologie de la gestion de projet avant de proposer des ateliers en groupe mis en place sur des exemples de marchés
Prendre le mandat d‘un chantier impliquant une équipe nombreuse, un matériel ou des installations spécifiques ou sur une longue période nécessite une organisation particulière qui peut décourager au préalable ou bien entrainer un investissement et une charge mentale lourds pour un entrepreneur individuel ou le gérant d’une petite entreprise.
Les compétences déployées dans d’autres domaines pour la gestion de projet peuvent donner des outils et un cadre pour envisager un projet complexe de conservation-restauration.
Cette formation abordera les principes clés et la méthodologie de la gestion de projet, avant de proposer des ateliers en groupe mis en place sur des exemples de marchés qui seront choisis en fonction des spécialités des participants.
Les ateliers seront accompagnés et animés par une restauratrice ayant suivi une formation de 3 jours sur la gestion de projet et adapté certains des outils proposés à des cas de chantiers en sculpture monumentale notamment. La 2ème partie de la formation fera l’objet d’une restitution des ateliers et d’échanges avec les encadrants avant de se conclure par un rappel et un retour au cadre général pour les acquis.
Public concerné
Professionnels de la conservation-restauration.
Coordination
Amélie Méthivier, adjointe au directeur des études, chargée de la formation initiale département des restaurateurs, Inp
Intervenantes
Mathilde Toyon, directrice de projets dans le domaine digital (sous réserve) ; Fanny Grué conservatrice-restauratrice de sculptures.
Modalités d'inscription
Lire les conditions d'inscription
Lorsque votre bulletin est complété et signé, il doit impérativement être adressé par courrier électronique à :
Céline Jabin, service de la formation continue des restaurateurs du patrimoine
Tél. : 01 49 46 57 16
celine.jabin@inp.fr
L’INP reviendra ensuite vers vous pour vous indiquer la suite donnée à votre demande.
- 18 places
- 640 euros
Développement durable : les nouveaux matériaux de conditionnement, les découvrir et les tester
Du 4 au 5 décembre 2024, ce stage, théorique et pratique, propose tout d’abord d’éclaircir les critères qui permettent de parler ou non de matériaux écologiques et ceux qui nous permettraient de les utiliser dans le domaine de la conservation en fonction des collections concernées et des contextes.
Les plastiques constituent à ce jour une part très importante de nos matériaux de conditionnement. De leur production à leur destruction, ils ont malheureusement un impact environnemental et toxicologique que l’on ne peut plus négliger et qu’il faut prendre en compte dans nos pratiques.
Si nous pouvons essayer de réemployer au maximum les matériaux existants, nous devons également songer à les remplacer.
Aujourd’hui de nouveaux matériaux biosourcés et biodégradables sont proposés et arrivent sur le marché, mais ils n’ont pas encore fait leurs preuves dans le domaine de la conservation-restauration.
Ce stage, théorique et pratique, propose tout d’abord d’éclaircir les critères qui permettent de parler ou non de matériaux écologiques et ceux qui nous permettraient de les utiliser dans le domaine de la conservation en fonction des collections concernées et des contextes.
Au regard de ces premiers critères de sélection, nous mettrons en place des tests simples qui permettront de faire avancer la connaissance dans le domaine, notamment de comprendre certaines des caractéristiques physico-chimiques des matériaux proposés. Ainsi, pourront être mis en œuvre des tests, à l’échelle de l’atelier ou de l’institution, qui permettent d’évaluer leur pH, leur solubilité ou leur porosité, et vérifier leur innocuité chimique pour les matériaux constitutifs des biens culturels.
Public concerné
Professionnels de la conservation-restauration
Coordination
Nathalie Palmade-Le Dantec, Maroussia Duranton
Intervenantes (à confirmer)
Maroussia Duranton, ingénieure d’études au département de la conservation préventive, C2RMF ; Kim Kraczon, conservatrice-restauratrice spécialisée en matériaux modernes et contemporains et en développement durable, directrice du secteur matériaux chez Ki Culture, en collaboration avec Gallery Climate Coalition ; Nathalie Palmade-Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation continue, Inp ; Sylvie Ramel-Rouzet, conservatrice-restauratrice de matériaux contemporains, consultante en conservation préventive ; Anaïs Perrichon, assistante de la réagie des œuvres, Louis Vuitton ; Elena Joulin, restauratrice de peinture.
Modalités d'inscription
Lire les conditions d'inscription
Lorsque votre bulletin est complété et signé, il doit impérativement être adressé par courrier électronique à :
Céline Jabin, service de la formation continue des restaurateurs du patrimoine
Tél. : 01 49 46 57 16
celine.jabin@inp.fr
L’INP reviendra ensuite vers vous pour vous indiquer la suite donnée à votre demande.
- 14 places
- 780 euros
Le soclage des oeuvres : entre conservation et présentation
Du 23 au 25 octobre 2024, l’objectif de cette formation est de comprendre les enjeux inhérents au soclage par une approche théorique dans un premier temps, des séquences pratiques d’études de cas et la mise en application par la conception et la réalisation d’un ou deux socles par les participants
Le cours apportera des connaissances et des réponses adaptées aux typologies concernées, aux matériaux constitutifs et à l’état de conservation des collections. Les propositions envisagées devront également s’adapter aux contraintes, comme par exemple l’adaptation à des vitrines existantes, et également au contexte dans lequel le soclage doit être réalisé (exposition temporaire ou permanente, muséographie particulière, soutien pour une mise en réserve…).
Les objectifs de cette formation sont :
- Comprendre les enjeux inhérents au soclage par une approche théorique suivie de séquences pratiques.
- Comprendre les risques liés au soclage.
- Connaître les matériaux à privilégier selon les natures de pièces à socler.
- Adapter le soclage aux conditions d’exposition ou de rangement.
- Connaître les termes spécifiques, les techniques et les matériaux pour s’adresser à des socleurs et commander un soclage adapté.
Public concerné
Professionnels de la conservation-restauration, professionnels du patrimoine d'Etat et des collectivités territoriales
Coordonnatrice pédagogique
Nathalie Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation continue, Inp
Intervenants
Yves Morel, socleur, designer produits et metteur en scène d’objets ; Lucile Gaydon, restauratrice d’objets 3D (à confirmer)
Modalités d'inscription
Lire les conditions d'inscription
Lorsque votre bulletin est complété et signé, il doit impérativement être adressé par courrier électronique à Aurélie Tanaqui, service de la formation continue des restaurateurs du patrimoine
aurelie.tanaqui@inp.fr
Tél. : 01 49 46 57 92
L’INP reviendra ensuite vers vous pour vous indiquer la suite donnée à votre demande.
- 14 places
- 960 euros
Le musée est dans le pré - Musée et "ruralité"
Propos de la rencontre
A la suite du plan « France ruralités » présenté à l’été dernier par le Gouvernement, la Ministre de la Culture, Rachida Dati, a appelé à la mobilisation des acteurs culturels autour de la question de la « ruralité ». Le « Printemps de la ruralité », concertation nationale portant sur l’offre culturelle dans les territoires ruraux, est alors lancée en janvier dernier.
Ce concept de « ruralité », apparu à la fin des années 1990 et réactivé périodiquement depuis une bonne dizaine d’années par différents plans d’actions, trouve aujourd’hui une nouvelle actualité. Mais comment le définir au juste? Le monde rural recouvre des réalités hétérogènes, en fonction de la géographie ou de l’histoire qui a façonné ces territoires. Le terme revêt aujourd’hui une acception anthropologique, caractérisant un mode de vie spécifique, voire une dimension politique, largement relayée par les médias. Comment objectiver cette notion ? Selon l’INSEE, les territoires ruraux sont définis par la faible densité de population. Jusqu’en 2020, l’organisme définissait le rural comme l’ensemble des communes n’appartenant pas à une unité urbaine, définie par le regroupement de plus de 2 000 habitants. Depuis 2021, la définition a évolué pour rompre avec cette approche centrée sur la ville. La ruralité désigne désormais l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses d’après la grille communale de densité. Ces territoires réunissent l’immense majorité des communes françaises (88 % des communes en 2017) et un tiers de la population, soit 22 millions de personnes.
Le « Printemps de la ruralité » s’appuie sur un postulat : les opportunités culturelles sont plus limitées dans les territoires ruraux que pour le reste de la population, les communes rurales accueillent 16% des équipements culturels à l’échelle nationale selon l’INSEE.
Qu’en est-il de nos musées ? La question de l’accessibilité du plus grand nombre irrigue la réflexion des professionnels de musées depuis longtemps. L’implantation du musée au cœur des territoires est par exemple l’un des piliers de l’écomuséologie, pensée dans les années 1960. Si la question de la répartition des institutions culturelles sur le territoire et de leur accessibilité est toujours un sujet de questionnement, c’est sans doute qu’elle témoigne aussi des tensions qui irriguent aujourd’hui nos sociétés.
Quel rôle les musées ont-ils à jouer pour répondre à un objectif d’équité territoriale et de démocratisation culturelle, et comment peuvent-ils contribuer à « faire société », au plus près de chacun ? Les projets scientifiques élaborés, les actions culturelles menées, dans et hors les murs, les projets itinérants, la mise en réseau des établissements, les partenariats faisant travailler ensemble musées et acteurs associatifs ou structures éducatives, la mise en place de résidences sont autant de pistes de travail pour faire du musée un lieu de vitalisation des liens sociaux qui répond aux grandes missions fixées dans la définition du musée. Dans la période de crises contemporaines que nous traversons, comment réaffirmer cet engagement des professionnels de musée?
Emilie Girard, présidente d'ICOM France
La session sera modérée par Annabelle Ténèze, directrice du musée du Louvre-Lens
Modalités
Session sur plate-forme numérique
ID : 828 4164 7999 // Code : 595698
Rencontre simultanément traduite en anglais, espagnol et français avec le soutien du ministère de la Culture
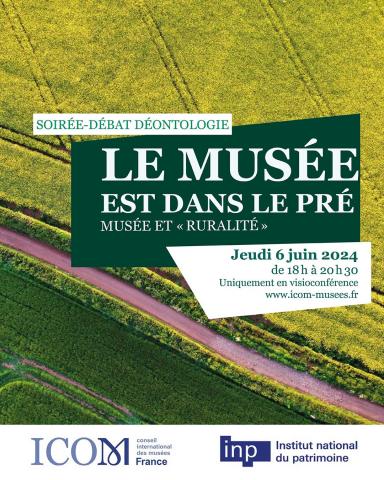
Le plan d'urgence en cas de sinistre
Du 12 au 14 juin 2024, cette formation théorique et pratique a pour objectif d’aider les institutions à rédiger et mettre en place leur plan d’urgence
Une introduction générale permettra de présenter les actions et les réalisations menées par deux instances de référence dans ce domaine. Elles encadreront les participants tout au long du stage lors des développements théoriques, des ateliers et de la mise en place d’exercices.
Les différentes étapes permettant l’élaboration d’un plan d’urgence seront détaillées et appuyées de fiches techniques et de recommandations ayant fait leurs preuves sur le terrain.
Des exercices pratiques permettront de mettre en œuvre les préconisations de manipulations et d’interventions appropriées (traitement d’objets / documents sinistrés ; cellule de crise).
Public concerné
Professionnels de la conservation-restauration, professionnels du patrimoine d'Etat et des collectivités territoriales
Coordination pédagogique
Nathalie Palmade-Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation continue, Inp
Intervenantes
Nelly Cauliez, conseillère pour la conservation du patrimoine, Direction du département de la culture et de la transition numérique, Genève ; Emilie Vaudant, attachée de direction, chargée de projet, Bibliothèque de Genève ; Mylène Florentin, consultante en conservation préventive, spécialisée dans les plans de sauvegarde des biens culturels BBF.
Modalités d'inscription
Lire les conditions d'inscription
Lorsque votre bulletin est complété et signé, il doit impérativement être adressé par courrier électronique à Aurélie Tanaqui, service de la formation continue des restaurateurs du patrimoine
aurelie.tanaqui@inp.fr
Tél. : 01 49 46 57 92
L’INP reviendra ensuite vers vous pour vous indiquer la suite donnée à votre demande.
- 15 places
- 960 euros
Peut-on tout exposer ? Les musées au cœur du débat contemporain
Publication ICOM France
Comment exposer des œuvres, objets, thématiques ou artistes dont on connait (ou suppose) la capacité à déranger, à choquer ?
Si nous, professionnels de musée, sommes convaincus de devoir tout exposer, la question du "comment" est au cœur de nos interrogations. Comment faire face au risque de l’autocensure ? Quel appareil discursif les musées doivent-ils mettre à disposition des publics pour mieux contextualiser, mieux expliquer et répondre aux contradictions ?
Retrouvez notre publication en format numérique :
Journée de visites professionnelles - Château de Versailles
Compte-rendu de Journée internationale d’échanges professionnels organisée par ICOM France & ICOM COSTUME au Château de Versailles le mardi 14 mai 2024
La présidente du comité international de l’ICOM pour les musées et collections de Costume, Mode et Textiles, Corinne Thépaut-Cabasset, a invité les membres d’ICOM France à une journée de visites et d’échanges professionnels au domaine national des châteaux de Versailles et de Trianon, mardi 14 mai 2024
Orientées sur la thématique du textile et des toiles imprimées, ces visites ont mis à l’honneur trois secteurs du château habituellement fermés au public ainsi que la nouvelle exposition au Grand Trianon : « Soieries Impériales ». Trente membres d’ICOM France ont ainsi pu profiter de cette journée professionnelle.
-
Visites du matin
Accompagnés de Noémie Wansart, collaboratrice scientifique, nous avons pu visiter le château du Grand Trianon et la chambre-cabinet du roi Louis-Philippe, dont le décor originel en toile fleurie a été récemment rénové par la Maison Edmond Petit, grâce aux découvertes au Mobilier national et dans les réserves de Trianon, d’éléments de ces textiles d’origine.

Chambre-cabinet du roi Louis-Philippe au Grand Trianon. Visite du 14 mai.
La suite de la visite nous a conduit au sein de l’exposition « Soieries impériales pour Versailles, collection du Mobilier National », dont Noémie Wansart en est la co-commissaire. Présentée jusqu’au 23 juin 2024, cette exposition revient sur l’exceptionnelle commande de Napoléon 1er auprès de manufactures lyonnaises d’ensemble de soieries destinées à remeubler le château de Versailles.

Ensemble en soie du cabinet de repos du petit appartement de l’impératrice Marie-Louise. Jean-François Bony, 1811-1812.

Élément de tenture pour le troisième salon du grand appartement de l'Empereur, Grand Frères, 1811 – 1813.
-
Visites de l’après-midi
Hélène Delalex, conservateur du patrimoine et Bertrand Rondot, conservateur en chef du patrimoine nous ont guidés dans les petits cabinets intérieurs de la Reine Marie-Antoinette, qui se déploient au 1er et au 2ème étage du château. Cet ensemble de pièces aux dimensions modestes commence à être réaménagé par la reine Marie-Antoinette à partir de 1774.

Cabinet du Billard, appartements intérieurs de Marie-Antoinette, second étage. Soierie de 1787.

La salle à manger, appartements intérieurs de Marie-Antoinette, second étage. Réimpression des toiles d'après un motif original, dit de « l’ananas », conservé au Musée de la Toile de Jouy (maison Pierre Frey).
La journée de visites professionnelles s’est achevée au rez-de-chaussée du château, dans les appartements du Dauphin et de la Dauphine ainsi que dans la dernière section de salles réhabilitées par Marie-Antoinette en 1788.
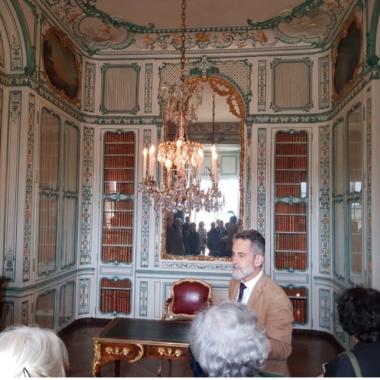
Bibliothèque de l’appartement du Dauphin et de la Dauphine, 1755-1756.

Détail des boiseries de la bibliothèque, 1755-1756.

Pièce des bains de Marie-Antoinette, 1788

Le groupe dans la cour de marbre.
Cette initiative du comité international Costume s’inscrit dans une volonté de faire connaître les nombreuses activités de ce comité ainsi que ses membres.
Bibliographie complémentaire :
- Article de N. Wansart et V. Bastien : http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2021/10/des-gouts-et-des-couleurs/
- Article de H. Delalex : http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2024/02/la-douceur-dune-vie-privee/
- Le Château de Versailles raconte le Mobilier national, sous la direction de Jean-Jacques Gautier et Bertrand Rondot aux éditions Skira / Flammarion Paris, 2011.
Vidéo youtube de la chaîne ICOM Costume sur la chambre-cabinet du roi Louis-Philippe :
Intervenir en temps de crise ! De la théorie à la pratique
Le Bouclier bleu France a le plaisir de vous convier à sa journée d'étude Intervenir en temps de crise ! De la théorie à la pratique.
Cette journée d'étude est ouverte à tous.
Programme ci-contre

Conférence générale des comités ICTOP et ICETHICS - Yerevan, Armenie
ICTOP et ICETHICS sont heureux d'annoncer une conférence conjointe en coopération avec ICOM Arménie, le Musée d'Histoire d'Arménie et le Ministère de l'Education, de la Science, de la Culture et des Sports d'Arménie, dédiée au 105ème anniversaire du Musée d'Histoire d'Arménie et au 160ème anniversaire de son directeur fondateur Yervand Lalayan.
Nous vivons dans un monde complexe où des questions globales telles que le changement climatique, les pandémies, la décolonisation, la guerre, la polarisation et l'inégalité affectent nos vies. Ces crises mondiales affectent inévitablement les musées et la manière dont ils contribuent à la société. La nouvelle définition du musée, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de l'ICOM à Prague le 24 août 2022, reflète l'évolution des perspectives sur le rôle des musées : "Un musée est une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui recherche, collecte, conserve, interprète et expose le patrimoine matériel et immatériel. Ouverts au public, accessibles et inclusifs, les musées favorisent la diversité et la durabilité. Ils fonctionnent et communiquent de manière éthique, professionnelle et avec la participation des communautés, offrant des expériences variées pour l'éducation, le plaisir, la réflexion et le partage des connaissances".
Sujet de la conférence : Le professionnalisme et l'éthique des musées à une époque difficile
Lors de cette conférence, nous souhaitons approfondir les termes « éthique » et « professionnel » en relation avec les crises mondiales. Que signifie agir de manière professionnelle ? Quels sont les dilemmes éthiques auxquels nous sommes confrontés dans ce contexte ? Comment pouvons-nous préparer au mieux les professionnels des musées à ces défis complexes ?
Les changements dans la société obligent les professionnels des musées à adopter une nouvelle attitude vis-à-vis de leurs publics. Le professionnel de musée est en constante évolution pour répondre aux besoins et aux attentes changeants du 21e siècle. Il est essentiel de comprendre comment le rôle d'un professionnel de musée façonne notre pratique quotidienne pour favoriser la responsabilisation au sein du secteur muséal et défendre l'importance d'un professionnalisme éthique. Par conséquent, l'éducation et la déontologie jouent un rôle essentiel pour garantir la pertinence et l'impact du musée dans ce monde en mutation. Elles fournissent les connaissances fondamentales, les compétences pratiques, les bases éthiques et la perspective critique nécessaires pour contribuer à la mission des musées en servant les communautés et en préservant le patrimoine culturel dans les temps difficiles d'aujourd'hui et de demain.
Nous invitons les professionnels des musées, les professeurs/conférenciers en muséologie et disciplines connexes, les étudiants en études muséales et les autres professionnels du patrimoine (membres ou non de l'ICOM) à partager leurs expériences, études de cas, pratiques, réflexions, recherches et idées pour trouver des réponses à ces questions :
- Comment les évolutions actuelles de la société affectent-elles votre institution ?
- Comment pouvons-nous préparer les professionnels des musées aux dilemmes éthiques dans les situations de crise ?
- Quels types de compétences sont utiles au 21e siècle ou spécifiques aux situations de crise ?
- De quelle manière notre professionnalisme est-il menacé en temps de crise ?
- Quels sont les dilemmes éthiques auxquels vous êtes confrontés ?
Nous acceptons des résumés sur le soin des collections, le public, la (re)présentation et la collecte qui aident à trouver de nouvelles voies et approches pour le développement professionnel et éthique futur dans le domaine des musées. Votre contribution peut prendre la forme :
- d'une présentation ou d'un article (15-20 minutes)
- d'un atelier (1 heure)
- d'un poster (dans le cadre d'une session de posters)
Veuillez noter que les articles sélectionnés seront publiés dans un volume spécial de la revue du Musée d'histoire de l'Arménie.
Veuillez soumettre votre résumé (250 à 350 mots maximum) et une courte biographie (150 mots maximum) avant le 1er juillet 2024. Les propositions approuvées seront annoncées le 1er août 2024.
Les informations suivantes doivent figurer dans le résumé :
- Nom de l'auteur ou de l'animateur de l'atelier
- Affiliation(s) et adresse(s) complète(s)
- Titre de l'article soumis et type de présentation
- Résumé en anglais (250 à 350 mots maximum)
- Matériel de soutien nécessaire (le cas échéant)
- Brève biographie/CV du/des présentateur(s) (150 mots maximum)
- Veuillez indiquer votre nom de famille et ICTOP2024 dans les noms de fichiers.
- Police de caractères : Arial Unicode.
Les résumés doivent être envoyés avant le 1er juillet 2024 sous forme de fichier joint MS Word ou PDF au comité de programme d'ICOM-ICTOP et d'ICOM ETHICS Yerevan 2024 :
Veuillez joindre au courrier en CC les courriels suivants :
Conférence générale du comité ICOM Exhibitions (ICEE)
Les musées sont le lien entre le passé et l'avenir. Nous vous invitons à nous rejoindre à Tartu, en Estonie, pour la conférence annuelle du Comité international d'échange d'expositions (ICOM Exhibitions), Momentum : Expositions et mémoire, qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2024.
Co-sponsorisé par ICOM Exhibitions, ICOM Estonia et la Coalition internationale des sites de conscience et accueilli par le Musée national estonien, Momentum : Expositions et mémoire offrira un espace pour de grandes conversations, de vastes questions et de nouvelles idées. Chaque journée aura un thème directeur et commencera par une conversation modérée entre deux orateurs principaux internationaux, suivie de sessions et d'ateliers simultanés. La journée se terminera par des visites de musées locaux où les participants auront l'occasion d'explorer, d'apprendre et de discuter de la manière dont les musées d'Estonie servent leur communauté de façon nouvelle et différente.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- Expositions, mémoire et avenir
- Comment les expositions peuvent-elles amener le public à comprendre la mémoire et le passé afin de créer un avenir plus juste ?
- Le croisement de la mémoire, de l'innovation et des expositions
- Les expositions sur la mémoire peuvent-elles être innovantes ? Que gagnons-nous ou perdons-nous en utilisant de nouvelles technologies et approches pour explorer la mémoire ?
- Comment les expositions façonnent-elles la mémoire ?
- En période de conflit, les expositions peuvent jouer un rôle clé dans la manière dont les communautés perçoivent le présent. Quelle est notre responsabilité éthique et comment pouvons-nous rassembler les communautés ?
Momentum proposera également le très populaire Marché des expositions itinérantes, ainsi qu'une série d'ateliers et de sessions consacrés aux expositions itinérantes.
Vous souhaitez faire une présentation à Momentum ? Soumettez votre proposition !
Trois formats de présentation sont disponibles : Mini présentations de 15 minutes, présentations en panel de 45 minutes, ateliers de 90 minutes et présentations de 3 minutes sur le marché des expositions
N'oubliez pas :
- Toutes les sessions seront présentées en personne ; il n'y a pas d'options hybrides pour l'instant.
- Les présentations doivent être faites en anglais.
- La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er juin 2024.
- L'inscription à la conférence est obligatoire pour tous les présentateurs.
- Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter : icee.icom@gmail.com