
Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Conférence générale des comités ICTOP et ICETHICS
La Conférence générale annuelle des comités ICTOP et ICETHICS - Comités internationaux de l'ICOM - se tiendra cette année en Arménie sur le thème : Le professionnalisme et l'éthique des musées à une époque difficile
Lors de cette conférence, nous souhaitons approfondir les termes « éthique » et « professionnel » en relation avec les crises mondiales. Que signifie agir de manière professionnelle ? Quels sont les dilemmes éthiques auxquels nous sommes confrontés dans ce contexte ? Comment pouvons-nous préparer au mieux les professionnels des musées à ces défis complexes ?
Les changements dans la société obligent les professionnels des musées à adopter une nouvelle attitude vis-à-vis de leurs publics. Le professionnel de musée est en constante évolution pour répondre aux besoins et aux attentes changeants du 21e siècle. Il est essentiel de comprendre comment le rôle d'un professionnel de musée façonne notre pratique quotidienne pour favoriser la responsabilisation au sein du secteur muséal et défendre l'importance d'un professionnalisme éthique. Par conséquent, l'éducation et la déontologie jouent un rôle essentiel pour garantir la pertinence et l'impact du musée dans ce monde en mutation. Elles fournissent les connaissances fondamentales, les compétences pratiques, les bases éthiques et la perspective critique nécessaires pour contribuer à la mission des musées en servant les communautés et en préservant le patrimoine culturel dans les temps difficiles d'aujourd'hui et de demain.
Voici les sujets qui seront abordés lors de cette conférence :
- Comment les évolutions actuelles de la société affectent-elles votre institution ?
- Comment pouvons-nous préparer les professionnels des musées aux dilemmes éthiques dans les situations de crise ?
- Quels types de compétences sont utiles au 21e siècle ou spécifiques aux situations de crise ?
- De quelle manière notre professionnalisme est-il menacé en temps de crise ?
- Quels sont les dilemmes éthiques auxquels vous êtes confrontés ?
Informations complémentaires à suivre...
Conférence générale des comités ICR / INTERCOM / NATHIST - 2024
Cette année, trois comités internationaux se regroupent pour l'organisation de leur conférence générale : ICR, INTERCOM et NATHIST. La conférence se tiendra en Zambie - Afrique sur le thème : La direction des musées au 21e siècle : Défis régionaux et impacts mondiaux
ICR - Comité international pour les musées régionaux de l'ICOM
INTERCOM - Comité international pour la gestion des musées
NATHIST - Comité international pour les musées et collections de sciences naturelles
L'évènement se construit en collaboration avec ICOM ZAMBIE, ICOM AFRIQUE et le ministère de la Culture de Zambie.
La conférence se tiendra du 1er au 5 novembre 2024 au musée de Liversonte, en Zambie.
L'appel à contribution est joint à ce message. La date limite de soumission des résumés est le 15 juin 2024.
Le musée est dans le pré - Musée et "ruralité"
Propos de la rencontre
A la suite du plan « France ruralités » présenté à l’été dernier par le Gouvernement, la Ministre de la Culture, Rachida Dati, a appelé à la mobilisation des acteurs culturels autour de la question de la « ruralité ». Le « Printemps de la ruralité », concertation nationale portant sur l’offre culturelle dans les territoires ruraux, est alors lancée en janvier dernier.
Ce concept de « ruralité », apparu à la fin des années 1990 et réactivé périodiquement depuis une bonne dizaine d’années par différents plans d’actions, trouve aujourd’hui une nouvelle actualité. Mais comment le définir au juste? Le monde rural recouvre des réalités hétérogènes, en fonction de la géographie ou de l’histoire qui a façonné ces territoires. Le terme revêt aujourd’hui une acception anthropologique, caractérisant un mode de vie spécifique, voire une dimension politique, largement relayée par les médias. Comment objectiver cette notion ? Selon l’INSEE, les territoires ruraux sont définis par la faible densité de population. Jusqu’en 2020, l’organisme définissait le rural comme l’ensemble des communes n’appartenant pas à une unité urbaine, définie par le regroupement de plus de 2 000 habitants. Depuis 2021, la définition a évolué pour rompre avec cette approche centrée sur la ville. La ruralité désigne désormais l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses d’après la grille communale de densité. Ces territoires réunissent l’immense majorité des communes françaises (88 % des communes en 2017) et un tiers de la population, soit 22 millions de personnes.
Le « Printemps de la ruralité » s’appuie sur un postulat : les opportunités culturelles sont plus limitées dans les territoires ruraux que pour le reste de la population, les communes rurales accueillent 16% des équipements culturels à l’échelle nationale selon l’INSEE.
Qu’en est-il de nos musées ? La question de l’accessibilité du plus grand nombre irrigue la réflexion des professionnels de musées depuis longtemps. L’implantation du musée au cœur des territoires est par exemple l’un des piliers de l’écomuséologie, pensée dans les années 1960. Si la question de la répartition des institutions culturelles sur le territoire et de leur accessibilité est toujours un sujet de questionnement, c’est sans doute qu’elle témoigne aussi des tensions qui irriguent aujourd’hui nos sociétés.
Quel rôle les musées ont-ils à jouer pour répondre à un objectif d’équité territoriale et de démocratisation culturelle, et comment peuvent-ils contribuer à « faire société », au plus près de chacun ? Les projets scientifiques élaborés, les actions culturelles menées, dans et hors les murs, les projets itinérants, la mise en réseau des établissements, les partenariats faisant travailler ensemble musées et acteurs associatifs ou structures éducatives, la mise en place de résidences sont autant de pistes de travail pour faire du musée un lieu de vitalisation des liens sociaux qui répond aux grandes missions fixées dans la définition du musée. Dans la période de crises contemporaines que nous traversons, comment réaffirmer cet engagement des professionnels de musée?
Emilie Girard, présidente d'ICOM France
Programme
Ouvertures officielles
Charles Personnaz, Directeur de l'Institut national du patrimoine
Émilie Girard, Présidente d'ICOM France
Intervenants
- Claire Delfosse, professeur de géographie à l’université Lyon 2
- Laurent Sébastien Fournier, anthropologue et président du Conseil Scientifique de Salagon - Musées et Jardins, Alpes de Haute Provence
- Marie Lecasseur, responsable du service conservation et valorisation du patrimoine du département de la Meuse
- Elie Senguedéé Ngalang, président d’ICOM Tchad
- Selma Toprak-Denis, cheffe du service médiation culture du centre Pompidou pour le projet MuMO
Modération : Annabelle Ténèze, directrice du musée du Louvre-Lens
Modalités
Session sur plate-forme numérique
ID : 828 4164 7999 // Code : 595698
Rencontre simultanément traduite en anglais, espagnol et français avec le soutien du ministère de la Culture
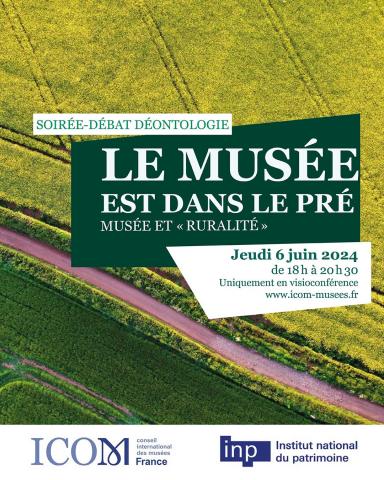
Régulation de l'humidité relative dans les vitrines et sobriété énergétique : le Projet SILICAGEL
À l’heure du plan de sobriété énergétique, les institutions conservant des biens culturels sont de plus en plus enjointes à réduire leur consommation d’énergie. La gestion du climat reste néanmoins impérative pour conserver les biens culturels. Comment maintenir des conditions de conservation acceptables en consommant moins d’énergie ?
À travers le Projet SILICAGEL, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), le Centre de Recherche pour la Conservation (CRC) et le Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge, soutenus par la Fondation des Sciences du Patrimoine (FSP), œuvrent ensemble pour tenter de répondre à cette question de façon pratique. Notre objectif est de faciliter l’accès des institutions muséales à une méthode de régulation passive de l’humidité relative : l’emploi de gel de silice (silica gel). Contrairement aux systèmes actifs nécessitant une alimentation continue en énergie, les systèmes passifs exploitent les propriétés naturelles des matériaux pour réguler l’humidité.
Afin de vous proposer des solutions techniques adaptées, nous souhaitons établir un état des lieux de vos pratiques concernant la gestion du climat dans vos vitrines, ainsi que de vos moyens et connaissances dans ce domaine. Pour ce faire, nous sollicitons votre contribution à ce formulaire en ligne qui ne prendra pas plus de 10 minutes.
Ce sondage vous est proposé au format anonyme tout en vous laissant libre d'inscrire vos coordonnées si vous souhaitez être tenu·e informé·e des résultats. Si vous le souhaitez vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : projetsilicagel@gmail.com.
Connecter / décloisonner. Pour des approches transversales des collections
Le ministère de la Culture et la fédération des écomusées et des musées de société organisent une journée webinaire autour de la question de la transversalité à destination des professionnels des musées
Aboutissement d’un groupe de travail animé par le Service des musées de France, ce webinaire sera l’occasion d'aborder, ensemble, les enjeux d’ouverture des collections à de nouveaux champs et de croisements de collections qui étaient auparavant souvent séparées. Le décloisonnement et la transversalité sont en effet au cœur de nombreux projets de refonte de parcours permanents en France et à l’étranger, que ce soit entre les domaines de collections (arts décoratifs, beaux-arts, arts populaires), entre différentes temporalités (archéologie, art ancien, moderne, contemporain) ou secteurs géographiques (intégration d'œuvres et d'objets non occidentaux).
Une co-organisation avec la FEMS
La FEMS est le réseau national des écomusées et musées de société. Née en 1989 à l'initiative de 28 écomusées fondateurs, l’association de la fédération des écomusées et des musées de société représente aujourd’hui près de 190 établissements patrimoniaux innovants et à but non lucratif. Le réseau fédère des structures qui, par-delà leurs différences, placent l’humain et le territoire au cœur de leur projet et de leur démarche.
Quatre thématiques
La journée prendra la forme de panels ou de tables-rondes, de 9h30 à 17h30, et sera structurée autour de plusieurs thématiques :
- le retour sur quelques figures pionnières de la transversalité au sein des collections ;
- l’interdisciplinarité et la question des indexations ;
- le réagencement transversal de parcours permanents ;
- la question de la réception et des publics confrontés à la transversalité.
Un programme finalisé sera publié au mois de mai.
Informations pratiques
Le séminaire aura lieu le 5 juillet 2024. Le programme sera à retrouver sur cette page dans les prochains jours.
Vous recevrez un courriel automatique de confirmation d’inscription.
Un lien de connexion à l’outil de visioconférence vous sera envoyé une dizaine de jours avant l’événement.
Peut-on tout exposer ? Les musées au cœur du débat contemporain
Propos de la rencontre
La polémique née de la présentation de l’œuvre de Miriam Cahn, Fuck Abstraction, au Palais de Tokyo l’année dernière n’était pas une première dans l’histoire des expositions. Si elle peut apparaitre comme un nouvel épisode d’une série de réactions vives du public face à des œuvres perçues comme provocantes ou choquantes, sa très forte médiatisation témoigne de l’évolution de nos sociétés contemporaines. Dans un monde post #MeToo profondément transformé, la parole s’est heureusement et légitimement libérée, et les émotions sont exprimées avec plus de force.
Plus largement et sur des sujets variés, les musées sont, aujourd’hui plus qu’hier, attendus et interpelés sur les œuvres et les artistes qu’ils exposent et sont invités à prendre position. Certes, ils ne sont pas les seuls dans le monde culturel. Littérature, théâtre ou cinéma sont également au cœur du débat. Mais ce qui fait la spécificité des musées dans cette discussion, c’est sans doute le fait que ceux-ci sont encore majoritairement perçus comme des lieux d’autorité, des institutions crédibles. Ils sont également des lieux de rassemblement, d’échanges, susceptibles de favoriser les débats.
Les sensibilités nouvelles et plurielles qui s’expriment obligent ainsi les professionnels à s’interroger sur leur rôle dans ce débat de société. Comment exposer des œuvres, objets, thématiques ou artistes dont on connait (ou suppose) la capacité à déranger, à choquer ? Comment faire face au risque de l’autocensure ? Quel appareil discursif les musées doivent-ils mettre à disposition des publics pour mieux contextualiser, mieux expliquer et répondre aux contradictions ?
La question de la légitimité de la prise de parole, du point de vue, de la place à faire à des voix autres au sein de l’institution muséale est également posée.
Aux Etats-Unis, une nouvelle réglementation fédérale, entrée en vigueur en janvier dernier, impose aux musées américains d’obtenir l’autorisation des populations autochtones avant d’exposer restes humains et artefacts. Les réactions et les réponses prises pour faire face aux attentes des publics, éminemment culturelles, témoignent de la diversité des prises de positions possibles. Comment les professionnels de musées doivent-ils se positionner dans ce contexte, face à une forme de polarisation ?
La nouvelle définition du musée réaffirme que nos institutions sont au service de la société : les musées ont en effet un rôle fondamental à jouer dans ce débat public toujours plus vif et moins nuancé. Tandis que des œuvres sont aujourd’hui jugées par certains « inconvenantes », « offensantes » ou « immorales », il est plus que jamais nécessaire de rappeler que les musées ont la responsabilité de s’extraire du seul registre émotionnel pour apporter des éléments de compréhension du monde et de mise en perspective.
Programme
Ouvertures officielles
- Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine
- Emilie Girard, présidente d'ICOM France
Intervenants
- Camille Faucourt, Conservatrice au Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, co-commissaire de l’exposition « Une autre histoire du monde »
- Cécile Debray, Présidente du Musée national Picasso - Paris
- Lynda Knowles, Procureure adjointe du comté du Colorado, USA
- Emmanuelle Lallement, Anthropologue, professeur à l'Institut d'études européennes, Université Paris 8
- El Hadji Malik Ndiaye, Docteur en histoire de l'art et conservateur du Musée Théodore Monod d'art africain, Dakar
Dominique de Font-Réaulx, Chargée de mission auprès de la présidente du musée du Louvre, assurera la modération de la soirée
Informations pratiques
Cette séance aura lieu simultanément :
- en présentiel dans l’auditorium Jacqueline Lichtenstein de l’institut national du patrimoine (INHA, 2 rue Vivienne – 750012 Paris). Accueil du public à partir de 17h40.
- en distanciel sur plateforme numérique :
Codes :
ID = 882 8090 6375
Code = 220522
Elle se tiendra simultanément en français, en anglais et en espagnol.
Événement ouvert à tous, sur inscription obligatoire

Questionnaire "patrimoines contestés"
Les divergences sur ce qui « fait patrimoine » ne sont pas propres à notre époque. Au cours des dernières années, des formes renouvelées de contestation ou controverse sont apparues portant sur tous types de patrimoine (monuments dans l’espace public, documents ou fonds d’archives, objets de musée…). Ces mouvements interrogent la légitimité de certains éléments ayant un statut patrimonial à l’aune de revendications liées au pouvoir, à la religion, au respect de la dignité humaine ou encore à la lutte contre les discriminations, parmi d’autres. Ils réclament aussi la reconnaissance de nouveaux patrimoines et de nouveaux modes de gestion des héritages culturels et des mémoires qu’ils portent, voire questionnent, plus largement, les fondements des politiques publiques en la matière (acquisitions et collecte, conservation, accès et valorisation).
Dans le cadre du « comité de prospective et d’innovation » (CPI) de la direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, un groupe de travail associant les métiers et des experts extérieurs a été créé pour établir un diagnostic et pour proposer des recommandations pratiques afin de répondre à ces mises en question. Le réseau des professionnels des monuments historiques et de l’architecture y est étroitement associé.
Afin de disposer de données d’analyse concrètes, quantitatives et qualitatives, sur des situations réelles en France, un questionnaire en ligne est lancé :
Il vise à obtenir une cartographie la plus complète possible des situations de contestation mettant en cause un élément patrimonialisé, quelle que soit sa typologie, dans sa matérialité, sa signification ou sa valeur, voire plus largement les politiques d’enrichissement et de constitution du patrimoine (exemple : statues commémoratives, pièce du répertoire théâtral, manière de gérer ou décrire une œuvre ou des documents patrimoniaux, œuvre d’un artiste au comportement non conforme aux lois ou valeurs de la société...). L’enquête doit aussi permettre d’identifier les dynamiques à l’œuvre dans chaque situation particulière, leurs convergences et leurs divergences, ainsi que les modalités concrètes de traitement des contestations.
Ce questionnaire est destiné principalement au réseau des acteurs institutionnels ou associatifs engagés dans le secteur du patrimoine. Il ne nécessite pas plus de 12 à 15 minutes par réponse.
Il restera ouvert jusqu’au 7 mai 2024.
Et demain ? Intelligence artificielle et musées

Toutes les sphères de la société sont aujourd’hui secouées par un questionnement commun : comment l’intelligence artificielle peut-elle ou va-t-elle transformer nos modes de vies ?
Et nos musées ?
Ils sont évidemment concernés par cette révolution, et, reflets de la société, bien différemment lancés dans une réflexion sur le sujet, voire une intégration de ce que l’IA peut apporter à nos missions.
Comment faire de l’intelligence artificielle un outil au service des musées et de leurs responsabilités ?
Retrouvez les interventions de : Agnès Abastado, cheffe du Service du développement numérique des musées d’Orsay et de l’Orangerie ; Marion Carré, fondatrice et présidente de la société Ask Mona ; Pierre-Yves Lochon, directeur associé de Sinapses Conseils et administrateur de Clic France ; Marie-Hélène Raymond, coordonnatrice de la stratégie numérique du Musée national des beaux-arts du Québec et Thomas Sagory, chef du développement numérique au sein du musée d’Archéologie nationale et responsable de la production de la collection Grands Sites Archéologiques pour le ministère de la Culture.
Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directeur de l'Institut national du patrimoine), Emilie Girard (présidente d'ICOM France). Conclusion par Séverine Blenner-Michel (directrice des études du département des conservateurs, Inp).
Modération : Marion Carré, fondatrice et présidente de la société Ask Mona
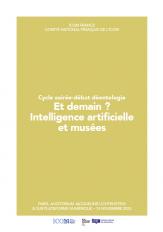
George Sans et le féminisme
Journée d’étude proposée par le Musée George Sand et de la Vallée Noire Au Théâtre Maurice Sand - La Châtre Samedi 22 juin 2024
Suite à l’exposition « George Sand, écolo ? », présentée en 2023, le musée continue l’exploration de l’image de la romancière, confrontée aux thématiques modernes à travers une nouvelle exposition de poche intitulée « George Sand, féministe ? ». L'exposition questionne l'idée-reçue selon laquelle George SAND (1804-1876) est considérée comme une grande figure du féminisme. Femme indépendante, par son travail et par ses mœurs, elle brave les interdits dans un siècle bourgeois et misogyne, en portant le pantalon malgré l'interdiction ou en vivant séparée de son mari. L'exposition explore son engagement pour améliorer sa propre condition, celle de ses congénères, son rôle dans le débat sur le droit de vote des femmes et la confronte avec d’autres personnalités féminines de son époque, aux idées parfois plus progressistes.
LA QUESTION EST POSÉE : George Sand est-elle une féministe comme nous l’entendons aujourd’hui ? Peut-on la qualifier d’icône féministe ?
La journée d’étude propose d’approfondir la question avec des intervenantes (universitaires, professionnelles de musée, membres de collectifs féministes et autrice de bande-dessinées et romans graphiques).
Seront abordés :
- L’émancipation exceptionnelle de George Sand replacée dans le contexte du XIXe siècle, particulièrement hostile aux femmes
- L’entrée en littérature de George Sand
- La figure publique qu’a incarné George Sand à son époque
- Les combats politiques menés par George Sand et sa confrontation avec des militantes pour les droits des femmes
- L’œuvre littéraire de George Sand
- L’image de George Sand, de son époque à aujourd’hui
Interventions de Michelle PERROT (historienne renommée de l’histoire des femmes, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot), Martine REID (biographe de George Sand, professeure émérite de littérature à l’université de Lille), Florence ROCHEFORT (historienne spécialiste de l’histoire des féminismes, chargée de recherches au CNRS), Carole Rivière (doctorante en histoire, université de Limoges), Gaëlle RIO (Directrice du Musée de la Vie romantique, Paris), Julie VERLAINE (co-présidente de l’association pour un musée des féminismes), le collectif HF, le collectif Georgette Sand, Séverine VIDAL (autrice de George Sand, fille du siècle, 2021).
Gratuit // Réservation obligatoire pour déjeuner : 12 € (02 54 30 17 60 ou musee@mairie-lachatre.fr) // Rdv au théâtre Maurice Sand (Place de l’Hôtel de Ville)

George Sand (esquisse) par Eugène Delacroix en 1838. Collection Ordrupgaard museum de Copenhague.
Les réserves muséales à travers le monde

Le Groupe de travail de l’ICOM sur les collections en réserve publie les résultats d’une enquête internationale sur la situation des réserves à travers le monde.
Ce rapport, qui synthétise les réponses données par plus d’un millier d’établissements répartis dans près d’une centaine de pays, s’inscrit à la suite des actions mises en place par l’ICOM afin d’approfondir la réflexion sur l’état des collections en réserve à travers le monde et la manière dont celles-ci pourraient évoluer dans les prochaines années.
Globalement, la situation des réserves est évaluée de manière assez défavorable par la majorité des musées interrogés, notamment pour ce qui concerne le manque de place et le manque de matériel.
Les problèmes évoqués dans ce rapport apparaissent partagés – même si l’on peut percevoir des différences – par tous les types de musées, quelles que soient leurs collections et leur importance, et dans toutes les régions du monde. L’objectif des professionnelles et professionnels qui en ont la charge demeure d’abord centré sur la préservation du patrimoine, une notion toujours présente dans la nouvelle définition du musée de l’ICOM, et c’est dans cette perspective que ces derniers envisagent l’évolution du musée, certes influencée par la transition écologique, mais toujours centrée sur les collections muséales.
Nous espérons que ce rapport permettra de mieux appréhender la situation des réserves muséales à travers le monde d’aujourd’hui.
Le groupe de travail organise à Paris, du 29 au 31 octobre 2024, une conférence internationale autour de la question des réserves muséales. Plus de renseignements seront bientôt disponibles.




