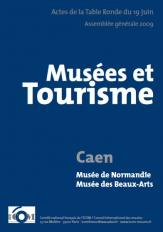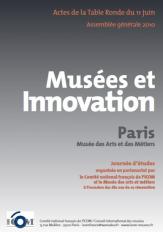Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Lettre de l'Icom France n°33
Lettre de l'Icom France n°34
Lettre de l'Icom France n°35

Editorial
Ce début d’année 2012 a été marqué par un geste solennel : la restitution le 23 janvier à la Nouvelle Zélande, à destination du peuple maori, de vingt Toi Moko, ces têtes tatouées rapportées depuis la fin du XVIIIe siècle en Europe par les navigateurs et les explorateurs du Pacifique. Dix-neuf avaient été identifiées dans les collections de musées français, une vingtième dans le conservatoire d’anatomie d’une Université. Pour en arriver là, il avait fallu plus de quatre ans de débat et le vote d’une loi (Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 « visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections »).
Faut-il rappeler qu’à l’origine de cette démarche il y eut l’engagement du directeur du Muséum d’Histoire naturelle de Rouen, Sébastien Minchin, qui, peu après sa nomination en 2006, découvrant cette pièce de collection, cet objet de science, ce reste de corps humain, s’était posé des questions à la fois scientifiques et éthiques : Peut-on l’exposer ? Où et comment le conserver ? Que doit-on répondre aux demandes formulées depuis 1992 par les Néo-Zélandais soucieux de rapatrier les restes humains dispersés dans les musées d’Europe, d’Amérique et d’Océanie afin de leur donner une sépulture conforme à la tradition culturelle maorie ? Pour les élus municipaux de Rouen, cette restitution s’imposait. Ils furent suivis dans cette voie par les parlementaires, à l’initiative de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, ancienne adjointe de la culture au maire de Rouen. Et la restitution le 9 mai 2011 de la tête conservée depuis 1875 dans les collections rouennaises permit enfin à la France de rejoindre les pays (Suisse, Grande-Bretagne, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Argentine, Australie,…) qui avaient pris le parti du respect de la demande néo-zélandaise et par-delà, de la culture maorie.
Il y a dix ans, en 2002, c’est déjà une loi spéciale qui avait autorisée la restitution à l’Afrique du Sud de la dépouille de Saartje Baartman, la « Vénus hottentote » passé, à sa mort en 1815, du statut d’objet d’exhibition et de prostitution à celui d’objet de science et de musée. A dix ans d’intervalle, le débat portant sur le principe d’inaliénabilité des collections publiques a occulté le questionnement éthique sur le statut même de certains restes humains conservés dans nos musées.
Nous héritons parfois de collections lourdes de sens, qu’il nous faut considérer à la lumière des débats de société contemporains. D’autres restes humains posant de graves questions se cachent encore dans les réserves de certains de nos établissements, sans évoquer les questions de pièces paléontologiques, ethnographiques ou archéologiques importées parfois frauduleusement.
Au croisement du droit et de la morale, des réglementations officielles et de l’autorégulation professionnel, une réflexion sur notre déontologie professionnelle s’impose à nous. C’est pourquoi, un quart de siècle après la publication du premier code de déontologie par l’ICOM en 1986, le comité national français a souhaité faire des questions de déontologie le cœur de sa réflexion collective. Nous avons travaillé depuis un an à l’élaboration d’une journée d’étude, organisée le 21 mars prochain avec le Service des musées de France de la Direction générale des patrimoines du Ministère de la Culture. Ce premier temps de notre réflexion, destinée à mettre en perspective historiques les codes de déontologie qui se sont multipliés ces dernières années dans le champ des professions des musées et du patrimoine, fera une large place au retour d’expériences. Nous espérons prolonger ce débat dans les mois à venir, et déjà à l’occasion de notre prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le 11 mai à Bruxelles. Nous attendons votre participation !
Denis-Michel Boëll,
Président du Comité français de l’ICOM
Membre du Comité pour la déontologie (ETHICOM)

Les actes d'ICOM France n°36

Editorial
Vingt-cinq ans après la première publication du Code de déontologie de l’ICOM –Conseil international des musées, en 1986, le Comité national français et le Service des musées de France ont organisé en 2012 une première journée d’étude sur la déontologie dans les musées de France, et plus largement sur l’éthique des professionnels des patrimoines et du marché de l’art.
En effet, le début des années 2000 a vu se multiplier les codes de déontologie professionnels (conservateurs du patrimoine, conservateurs-restaurateurs, médiateurs, etc.) au moment où des changements profonds sont intervenus dans la gestion patrimoniale : externalisation des services, multiplication des partenariats, judiciarisation des pratiques. Qules sont les enjeux et les limites de ces codes de déontologie ?
Cette première journée d’étude s’est déroulée le 21 mars 2012 à l’Institut national d’histoire de l’art, à Paris, et a rassemblé des intervenant du ministère de la Culture, des juristes, des professionnels indépendants et des acteurs du marché de l’art. La matinée s’est efforcée de rappeler ce qu’est un code de déontologie, quelle est l’histoire de la notion et comment la déontologie muséale peut s’imposer aux partenaires des musées. L’après-midi a été consacré à une table-ronde sur les pratiques professionnelles.
Une deuxième rencontre se déroulera le 25 et 26 novembre 2013 à l’auditorium de l’Institut national d’histoire de l’art, sur le thème : « Déontologie des collections publiques : intérêt général et acteurs privés ». Chacune des trois demi- journées sera consacrée à un thème spécifique : la traçabilité des collections, les acteurs de la chaîne opératoire des collections et l’utilisation des collections publiques.
Denis-Michel Boëll,
Président du Comité français de l’ICOM
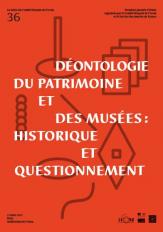
Les actes d'ICOM France n°37

Editorial
Au croisement du droit et de la morale, des réglementations officielles et de l’autorégulation professionnelle, une réflexion sur notre déontologie s’impose à nous. C’est pourquoi plus d’un quart de siècle après la publication du premier Code de déontologie par l’ICOM en 1986, le Comité national français a souhaité faire des questions de déontologie le cœur de sa réflexion collective depuis plusieurs années.
C’est dans cette perspective que se sont placées les deux tables-rondes organisées à l’occasion de nos Assemblées générales 2012 et 2013 : « Musées et acteurs privés : de nouvelles formes de partenariats ? », le 11 mai 2012, au Musée des Instruments et de la Musique à Bruxelles ; « Territoires en mutations : quels musées pour quels publics ? », le 31 mai 2013 au Musée du Louvre-Lens.
Vous trouverez dans le numéro 37 de la Lettre du Comité français de l’ICOM les actes de ces deux tables-rondes. Les différentes interventions orales ont été retranscrites par nos soins et un comité de relecture, composé de membres de notre Conseil d’administration, a ensuite mis en forme écrite les présentations orales. Nous espérons avoir restitué le plus fidèlement possible les paroles de chaque intervenant.
Denis-Michel Boëll,
Président du Comité français de l’ICOM

Les actes d'ICOM France n°39

Editorial
Un défi au temps : la conservation et la circulation des collections
Pour répondre au défi de la préservation ad vitam aeternam du patrimoine que nous avons la mission de transmettre aux générations futures, les musées ont réalisé depuis quelques décennies de gigantesques progrès dans le domaine de la conservation préventive, de la sécurité des biens, de la qualité des réserves, du contrôle de la lumière ou de l’hygrométrie, des techniques d’emballages et de transport, autant d’avancées qui ont renchéri le coût de la conservation des collections. Simultanément, une meilleure prise en compte de la mission éducative de nos institutions, le souci de l’élargissement des publics et celui d’une accessibilité accrue des œuvres ont conduit à une circulation de plus en plus intensive de celles-ci et partant, à une plus grande exposition… aux risques.
« Circulation des collections : risquer pour coexister ? » : avec ce titre paradoxal, nous avons voulu mettre l’accent sur les nouvelles conditions de vie et de survie des biens culturels dans ce contexte de mouvement accéléré, que les causes en soient d’ailleurs la finalité éducative, la recherche de ressources propres contribuant à une meilleure gestion, ou encore des injonctions politiques ou des nécessités diplomatiques. Comme lors de nos précédentes journées d’étude sur a déontologie organisée en 2012 et 2013 en partenariat avec le Service des musées de France/ Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication., nous avons conjugué réflexions sur les principes et retours d’expériences concrètes, au fil des trois tables-rondes dont vous trouverez ici la description.
Il y aura trente ans cette année que le code déontologie de l’ICOM a été adopté à l’occasion de la Conférence générale de Buenos-Aires, en 1986. Il a été ensuite révisé et amélioré à deux reprises, en 2001, puis 2004. Il le sera à nouveau prochainement, afin de prendre ne compte les évolutions récentes du monde muséal, mais il reste un irremplaçable outil dans notre vie professionnelle. Il rappelle que nous conservons les collections dans l’intérêt de la société et de son développement, qu’elles servent à constituer et approfondir les connaissances du plus grand nombre, qu’elles constituent des outils précieux de compréhension et de gestion de notre héritage culturel et naturel et que nous devrons œuvrer, de façon professionnelle et dans la légalité, au service des communautés qui nous ont légué ces témoignages comme au service de celles qui les détiennent aujourd’hui.
Après avoir élu à la présidence du comité français, j’ai succédé en 2011 à Jean-Yves Marin et Michel Van Praët au sein du comité de déontologie de l’ICOM (ETHCOM), présidé par notre collègue suisse Martin Schaerer. Ce comité s’est donné entre autres objectifs celui d’approfondi au sein des comités nationaux les questions traitées par notre code de déontologie, soulignant à quel point ce document fondamental est pertinent –même si son actualisation reste un chantier permanent- dans notre pratique quotidienne des métiers du musée. Nous avons organisé en France au fil de ces dernières années cinq rencontres autour de ces questions. Avec les numéros 36 à 39 de la Lettre du Comité français, qui en ont publié les actes, nous disposons d’un corpus de textes qui, je l’espère, constitueront des références utiles pour tous dans l’exercice de nos responsabilités à l’égard des collections et du patrimoine dont nous avons la charge, comme à l’égard des publics, des communautés, et plus largement de la société, au service desquels nous œuvrons.
Denis-Michel Boëll,
Conservateur général du patrimoine,
Président du Comité français de l’ICOM
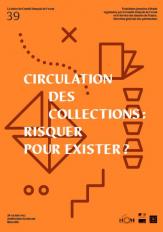
Les actes d'ICOM France n°38

Editorial
Service public, acteurs privés et déontologie dans les musées
A cinq reprises au cours de ces trois dernières années, le Comité français de l’ICOM a mis en perspective et en débat les principes de notre code de déontologie, publié pour la première fois en 1986. En mars 2012, lors de la première journée d’étude qui s’est tenue à l’Institut national d’histoire de l’art à Paris, il s’agissait de s’interroger sur les origines, l’histoire et les implications de la déontologie du patrimoine, tant au plan international que dans le cadre de la France, où la majeure partie des institutions relève de la fonction publique. Prenant en compte les profondes mutations intervenues ces dernières années dans la gestion du patrimoine culturel (externalisation des services, privatisation des espaces, multiplication des partenariats, judiciarisation des pratiques), nous nous sommes penchés, en mai 2012 à Bruxelles, sur l’éthique du mécénat et des partenariats privés, puis, en avril 2013 à Lens, sur la prise en compte des publics dans les politiques culturelles de territoires. En juin 2014, notre table-ronde de Monaco a mis en lumière une éthique de la responsabilité face aux collections et aux sujets d’exposition « sensibles ».
Entre-temps, les deuxièmes journées d’étude organisées en novembre 2013, à nouveau à l’INHA et en partenariat avec le Service des musées de France, Direction générale des patrimoines, ont permis d’approfondir la réflexion sur la pertinence de nos principes déontologiques à plusieurs moments de la vie des objets de nos collections : de leur présentation sur le marché à leur acquisition, de leur conservation préventive à leur restauration, passant entre les mains d’acteurs, publics et privés, très divers. Sans tabou et sans corporatisme, nous nous sommes efforcés d’échanger sur ces sujets avec des professionnels d’horizons variés, acteurs du marché de l’art, restaurateurs, assureurs et responsables des collections de toutes nature, de l’archéologie aux beaux-arts, de l’histoire à la création contemporaine. Ces échanges constituent la matière de ce numéro 38 de la Lettre du comité français, que vous avez entre les mains. Je remercie celles et ceux qui ont œuvré à sa publication, chacune et chacun des intervenants et des modérateurs des débats, et tout particulièrement Jacques Sallots, président de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art, et président de la Commission scientifique nationale des collections, qui a accepté d’animer une table-ronde finale sur l’utilisation des collections publiques, dont nous avions à peine esquissés les problématiques qui couvrent un très large champ. Grâce à la qualité de cet échange, ont pu être mieux posées les questions relatives à la circulation des collections qui feront l’objet de nos troisièmes journées d’étude, intitulées « Circulation des collections : risquer pour exister ? », auxquelles nous vous invitons à participer les 28 et 29 mai 2015 au MUCEM à Marseille.
Denis-Michel Boëll,
Conservateur général du patrimoine,
Président du Comité français de l’ICOM
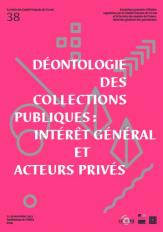
Les actes d'ICOM France n°40

Editorial
L’année 2016 a été en France une année de débats publics et politiques sur les enjeux culturels, avec la discussion et le vote de la loi « Liberté de la création, architecture et patrimoine ». Peu de temps auparavant, la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République avait produit d’importante transformations dans la répartition des compétences en matière de culture entre l’Etat et les régions, aboutissant notamment) renforcer les compétences des régions et le poids des élus territoriaux. Tenir la journée professionnelle annuelle d’ICOM France dans l’enceinte du Sénat était symbolique. Il s’agissait de sensibiliser les élus aux problématiques des musées, particulièrement bien sûr celles de musées en région et de mieux appréhender les attentes des élus à l’égard des musées.
Nos vifs remerciements vont tout d’abord à Françoise Carton, vice-présidente du Sénat, sénatrice de la Gironde, membre de la commission Culture, Education et Communication, qui nous a accueillis dans les salons de la Présidence du Palais du Luxembourg. Son engagement aux côtés des musées et sa conviction que les professionnels des musées ont un rôle social éminent à jouer notamment dans le milieu éducatif et jusque dans les zones rurales a pesé fortement pour la réussite de cette journée. Remercions également chaleureusement Jean-Claude Luche, sénateur de l’Aveyron et président de son conseil départemental. Sa riche expérience d’élu local le convainc qu’aujourd’hui un musée doit tisser des liens et s’intégrer pleinement dans un territoire car la culture c’est toujours un choix pour les collectivités territoriales.
Nos tables-rondes abordait précisément le sujet des changements intervenus dans le monde muséal : Daniel Jacobi a souligné la diversité des institutions, leur accroissement et le « paradigme de l’exposition » qui transforme le musée. Jean-Pierre Saez a livré une analyse de la place de la culture dans la loi NOTRe, plus que jamais liée à l’ambition de chaque collectivité. Il n’y a de « compétence culturelle obligatoire » -que l’auteur aurait souhaité- le patrimoine reste l’objet le plus sensible dans les relations entre les collectivités et l’Etat mais le texte introduit clairement l’idée de droit culturel, notamment grâce à l’insistance des sénateurs. Sylvie Pfliergler a mis en avant l’extrême hétérogénéité des situations -1% des musées concentrent 50% des entrées- et a posé la question de la soutenabilité future des musées de France.
La deuxième table-ronde était celle de professionnels des musées venant d’établissements ou d’associations en région, invités à témoigner de leur expérience, de leurs espérances et de leur ancrage dans le territoire. Jean Guibal a avancé l’idée que le musée du patrimoine devait être la maison mère de tous les patrimoines. Christophe Vital témoigne d’une démarche participative, en Vendée, d’un projet de musée qui associe la population à sa définition. Géraldine Balissat a relaté l’expérience de gestion en réseau coopératif des musées scientifiques et techniques francs-comtois, du rapport de cette association avec les élus, les propriétaires de site et en a exposé les enseignements institutionnels. Nicolas Dupont a mis en perspective l’engagement conjoint des politiques et des professionnels qui a fait du projet du musée des Confluences l’une des plus vastes réhabilitations urbaines en Europe.
Après ces très fortes interventions, Jean-Michel Tobelem dans sa conclusion, est revenu sur la notion de « paysage culturel », en soulignant le paradoxe d’une responsabilité accrue des musées à l’égard de leur territoire dans une période où ils ont eu du mal à faire face à leurs missions existantes. De manière prospective, il a interrogé leur rôle à venir dans le sens de l’intérêt public et de la cohésion sociale, en invitant à un décloisonnement et à une ouverture à la mutualisation, aux partenariats et à la coopération.
Le tempo de cette réunion était aussi fixé par des enjeux internationaux : elle précédait la 24e Conférence générale triennale d’ICOM international, qui s’est tenue à Milan en juillet 2016. Les acteurs culturels italiens avaient retenu la thématique « Musées et paysages culturels » et rassemblé des préconisations dans une charte, dite Charte de Sienne, qui a inspiré nos réflexions et suscité, à l’international, une position coordonnée de la délégation française sous le pilotage de Louis-Jean Gachet, membre du Bureau d’ICOM France.
La journée d’ICOM France au Sénat s’inscrivait donc dans une double actualité : française avec le contexte de la décentralisation et de la loi Création ; mondiale à Milan.
Cette séance de travail des professionnels de musée a aussi été porteuse d’une annonce : celle du lancement de la mission « Musées du XXIe siècle » par Marie-Christine Labourdette, directrice du Service des musées de France au Ministère de la Culture. Orientée principalement sur la question des publics, la mission visant prioritairement à conforter les politiques de démocratisation des musées et d’accueil de tous, notamment de ceux qui en sont le plus éloignés. On trouvera, en fin de ce volume, la contribution d’ICOM France à cette mission d’envergure.
Pour tous les intervenants et dans le débat avec les professionnels présents, l’actualité des musées reste complexe. D’un côté, la fréquentation des « grands » musées, même si elle a connu un ralentissement sous l’effet des évènements terroristes, reste très élevée. D’un autre côté, un territoire, les situations sont très inégales voire disparates. Les ressources sont plus rares et la part de l’activité consacrée à les rechercher et à les gérer s’accroît mécaniquement.
Les métiers changent. Nous avons lancé un cycle de soirées-débats : qu’est-ce qu’être aujourd’hui un professionnel de musée, quelles compétences et quelles qualifications sont requises, quelles formations sont dispensées pour que tous ceux qui œuvrent au sein d’une institution muséale aient une déontologie commune ? Y a-t-il toujours un « modèle français », tel celui qui avait permis il y a 70ans la création à Paris de l’ICOM aujourd’hui présente dans 136 pays et de son code de déontologie traduit dans 36 langues et qui fait loi dans de nombreux pays qui n’en disposent pas ?
A nos 4700 membres, invités chaque année à se rassembler en assemblée générale et à débattre de questions vives (en 2017, le « Récit dans l’exposition », au musée des Confluences), nous voulons donner davantage la parole, notamment à travers un site renouvelé qui permettra de partager expérience et bonnes pratiques.
Juliette Raoul-Duval
Présidente d’ICOM France
Denis-Michel Boëll
Ancien président d’ICOM France
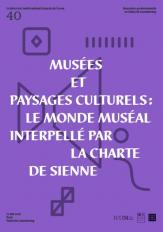
Comment gérer un musée

Comment gérer un musée : manuel pratique
Chaque chapitre du Manuel apporte des orientations pratiques et des thèmes de discussion. Le texte principal de chaque chapitre est accompagné d’informations complémentaires comme des données techniques et des normes, ainsi que des suggestions d’exercices pratiques et des sujets de discussion à usage interne. C’est un outil fonctionnel, constructif et convivial à la fois pour un professionnel individuel, un groupe d’études, des participants aux programmes ou exercices de formation du personnel, et pour l’ensemble du personnel d’un musée.
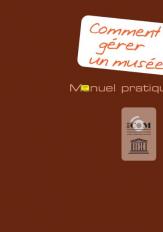
Concepts clés de muséologie

Concepts clés de muséologie
Avant-goût de la version intégrale du Dictionnaire de muséologie, cet ouvrage est le fruit de nombreuses années de recherche, d'analyse et de révision de la part du Comité international de l'ICOM pour la muséologie, ICOFOM. Les musées, et par conséquent l'ensemble des professions muséales, ont connu des bouleversements sans précédent ces dernières années, ayant donné lieu à la nécessité d'utiliser un langage commun, accessible à tous les professionnels de musée de toute discipline et de toute culture. Publication à part entière, cette brochure, première du genre, est éditée en quatre langues et énumère les 21 concepts muséologiques fondamentaux à travers une série d'articles décrivant leur origine, leur évolution au fil du temps ainsi que les enjeux qu'ils engendrent actuellement dans le domaine de la muséologie.
La publication des Concepts clés de muséologie coïncide avec la Conférence générale de l'ICOM, organisée du 7 au 12 novembre 2012 à Shanghaï (Chine). Cet événement triennal historique constitue la toile de fond idéale pour le lancement d'une nouvelle série de normes destinées aussi bien à l'organisation qu'aux professionnels de musées.