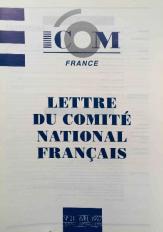Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Lettre de l'Icom France n°12

Editorial
PRO MUSEIS (II)
Dans l’éditorial de la dernière Lettre du Comité français de l’ICOM, nous ne pouvions, à l’époque de la guerre du Golfe, qu’attirer l’attention des belligérants sur les conventions internationales qui devraient, qui doivent protéger le patrimoine et appeler nos collègues à une grande collaboration internationale. Si le citoyen français que nous sommes formait des vœux pour le succès des armées alliées, le responsable de l’ICOM était en devoir de s’inquiéter pour le devenir des collections muséales et des musées des deux principaux pays sur le sol desquels se déroulaient le conflit.
Une autre guerre met actuellement en péril très grave le patrimoine de nombreuses villes et villages de Yougoslavie auquel nous savons, tant de sources étrangères qu’à travers les messages tragiques de nos collègues, que, d’ores et déjà, des dommages irréparables ont été apportés. Nous pensons à Dubrovnik mais aussi à de nombreuses autres localités dans le passé archéologique, architectural, artistique, ethnographiques et muséal ne fait l’objet d’aucun traitement spécial de sauvegarde dans une guerre impitoyable. Cette guerre à laquelle l’Europe institutionnelle se révèle incapable de mettre fin est une tragédie pour les populations impliquées. Elle l’est également pour le patrimoine européen. Nous demandons solennellement que tous les moyens soient recherchés pour y mettre un terme, qu’à tout le moins son déroulement même prenne en compte un patrimoine exceptionnel qui est aussi le nôtre.
Patrimoine en péril également en Afrique, menacé également par les trafics illicites et par les problèmes de conservation. C’est dire que nous sommes heureux du grand succès de la conférence organisée sur le terrain par l’ICOM. « Quels musées pour l’Afrique » est bien la vraie question à résoudre et de manière urgente. Nous saluons ici ceux qui ont pris l’initiative de cette réflexion. L’intérêt de la France marquée par la présence d’une délégation conduite par Monsieur Jacques Sallois, directeur des Musées de France nous réjouit également. Pour sa part, le comité français était représenté par son vice-président, Jean-Yves Marin, dont le compte-rendu est publié plus loin.
Dernière question, celle-là posée à Marseille par le comité français. Quelles publications, avec qui, avec quels moyens, pour quels publics ? Questions fondamentales pour nos musées, pour leur activité scientifique, leur avenir et leur rayonnement.
L’ICOM se place délibérément au cœur des préoccupations muséales. Mais il ne peut le faire qu’à travers les institutions qui en font partie, à travers chacun d’entre vous qui en êtes membres.
En cette fin d’année, je voudrais me tourner vers vous en vous offrant mes vœux de Nouvel An.
Que 1992 soit pour vous-même une excellente année. Que celle-ci soit également pour votre activité professionnelle, pour les musées au profit desquels vous l’exercez une année dynamique et fructueuse. Que, pour l’ICOM, la Conférence générale de Québec soit un témoignage de vitalité et un ferment d’avenir. Que celle-ci soient aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux comités nationaux créés dans les pays qui viennent d’entre aux Nations Unies. Nous pensons notamment à nos collègues des pays baltes. Tels sont les vœux que je forme au seuil de l’année 1992.
Jacques Perot
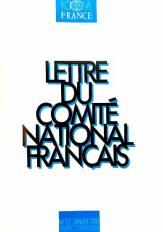
Lettre de l'Icom France n°13

Editorial
Comme une mécanique bien réglée, la XVIe Conférence Générale de l’ICOM s’est déroulée dans des conditions plutôt satisfaisantes. Cependant, avec le recul, nous mesurons sans doute combien elle aura manqué une tournant dans l’histoire de notre Organisation. L’émergence des lignes de forces issues de la nouvelle donne politique mondiale s’est affirmée par la présence des représentants de nouveaux Etats : slovènes, croates, baltes, mais aussi amérindiens, montrant ainsi l’attrait qu’exerce l’ICOM dans un monde où la recherche d’identité occupe dorénavant une position centrale.
Au sein même des organes dirigeants de l’ICOM, bien des changements se sont produits : depuis le départ d’Alpha Oumar Konaré, appelé par son peuple à la redoutable fonction de président du Mali, jusqu’au départ, après tant d’année de dévouement, de Brian Arthur.
L’élection de Saroj Ghose à la tête de l’organisation et de celle de notre ami Jacques Perot à la présidence du Comité Consultatif sont –de par le travail déjà accompli par l’un et par l’autre- un gage de bonne santé des années à venir. On ne saurait oublier que la continuité de l’action et son renforcement sont assurés par l’excellent travail de la Secrétaire générale et de son équipe.
Le bureau de notre Comité a aussi connu des changements ; de nouvelles sensibilités y sont représentées, ces membres y sont issus des grands secteurs du monde muséal français et c’est, je crois, sa principale force.
Véritable « noyau dur » du bureau, la Secrétaire générale, Catherine Arminjon, et le Trésorier, Charles Penel, ont accepté de continuer leur action ce dont je me réjouis pour avoir vu au quotidien avec quel dévouement ils se sont consacrés à leurs tâches respectives au cours des trois années passées. C’est durant cette période que nous avons eu la chance d’avoir le renfort de Florence Hollande dont vous pouvez mesurer l’inusable efficacité jamais dénuée d’humour et de gentillesse.
Forts d’une telle équipe, nous nous sommes aussitôt mis au travail pour prolonger mais également diversifier et renforcer –selon les besoins de l’heure- une politique mise en place par nos prédécesseurs. Certains problèmes inhérents au système associatif –difficulté budgétaire, passivité d’un trop grand nombre de membres- peuvent connaître des améliorations mais c’est dans trois directions précises que nous entendons orienter le Comité national français :
- Accueille de collègues étrangers. Quels que soient nos problèmes budgétaires, n’oublions pas que nous sommes infiniment mieux pourvus que la plupart de nos collègues étrangers et que nous disposons de sources de financement possibles –pas toujours utilisées- pour développer nos relations avec eux. Un effort important sera fait dans ce sens, en intensifiant nos rapports avec l’Est de l’Europe, en mettant en place un programme avec l’Afrique de l’Ouest et peut-être demain avec la péninsule indochinoise. Cela me paraît des plus urgents si nous voulons participer véritablement à la défense d’une francophonie bien mal en point.
- Soutien des programmes de l’ICOM. L’autonomie du Comité national français ne trouve son sens que s’il œuvre à un renforcement de notre organisation. Pour ce faire, nous devons répondre positivement aux actions impulsées par le Conseil Exécutif qu’elles soient ponctuelles telle la « Journée Internationale des musées », conjoncturelles comme le développement du réseau ICOM au Moyen Orient, ou de longue haleine comme la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art dans le monde.
Enfin, la réussite de ce qui précède dépend largement de nos moyens de communication, c’est pourquoi nous souhaitons développer rapidement une politique éditoriale. Michel Van-Praët, entouré d’une équipe resserrée, va tenter d’améliorer la périodicité de la lettre ICOM-France, en apportant une somme d’informations nationales et internationales jusqu’ici éparses. La réalisation de documents de qualité sur nos activités paraissant à l’occasion de la Journée Internationale des Musées viendra compléter le dispositif.
Nous rappelons souvent avec une certaine fierté qu’avec près de 900 membres, notre Comité national est l’un des tout premiers, aussi devons-nous lutter, tous ensemble, pour mieux défendre ce Musée, que notre code de déontologie définit comme « une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d’études, d’éducation et de délectation ».
Jean-Yves Marin
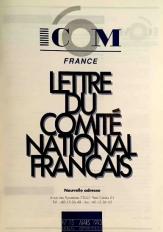
Lettre de l'Icom France n°14

Editorial
Le Musée : « Une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement… »
Le Code de déontologie de l’ICOM a été préparé par un groupe de travail composé de membres du Comité consultatif, après une étude approfondie des codes d’éthique professionnelle muséale existants, nationaux, spécialisés ou autres et une consultation de tous les comités nationaux et internationaux et de l’UNESCO. Il a ensuite été adopté à l’unanimité par la XVe Assemblée générale de l’ICOM, réunie à Buenos-Aires, Argentine, le 4 novembre 1986. Depuis, plusieurs modifications et compléments ont été apportés (La Haye, 1989) car le principe même de ce code veut qu’il soit en continuelle discussion. Ce texte de référence qui n’a aucun équivalent au monde a, depuis, fait l’objet d’une large diffusion parmi les membres de l’ICOM et dans tout le mouvement mondial des musées.
Le Comité National Français a souhaité contribuer à prolonger cette diffusion en réalisant une nouvelle édition du Code sous la forme d’une « Lettre spéciale ICOM-France » datée symboliquement du 22 mai 1993, Journée Internationale des Musées. Elle a été rendue possible grâce au soutien constant de la Direction des Musées de France.
Nous ne doutons pas que les membres de l’ICOM connaissent et se réfèrent à ce document professionnel. Ils recevront, bien sûr, cette nouvelle édition mais notre objectif, ici, est de faire connaître le Code aux membres de la communauté muséale française qui ne sont pas –ou pas encore- membre de l’ICOM ; car il faut le rappeler, l’ICOM est le seul lieu de rencontre commun, ouvert à tous les métiers du musée et dans une large mesure à leurs partenaires. Nous avons voulu également mettre ce document à la disposition des autorités de tutelle des différents musées français, au premier rang desquelles il convient de citer les parlementaires, maires, présidents de Conseils généraux et régionaux.
Par son caractère universel, le Code de déontologie est un outil fondamental dans toute tentative de réflexion sur l’avenir des musées. Il expose les principes éthiques qui doivent gouverner la conduite du personnel des musées dans tous les aspects de ses engagements professionnels. Il définit les devoirs de chacun, rappelle les dangers de dérive institutionnelle, montre la nécessité de l’indépendance intellectuelle des gestionnaires de collection.
Cette réédition nous apparaît particulièrement nécessaire aujourd’hui en France où les nouveaux musées et toutes les activités qui en découlent prolifèrent sans que leur réalisation soit toujours précédée d’une réflexion prenant en compte les multiples aspects garants de l’éthique d’un établissement.
L’action de l’ICOM à travers le monde nous apprend que, quel que soit le niveau de développement d’un pays, de graves dérives sont toujours possibles et que, face à ce danger, notre vigilance doit être constante. En ce temps où l’universalisme est fortement menacé, sachons plus que jamais défendre nos valeurs communes.
Jean-Yves Marin
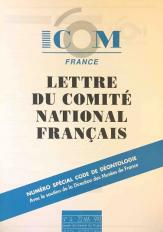
Lettre de l'Icom France n°15

Editorial
À bien des égards l'année qui vient de s'écouler fut importante dans la longue histoire des musées français, le magistral le 200e anniversaire du Musée du Louvre en constituant la partie la plus achevée et sans doute la plus emblématique. Cette affirmation du rôle de premier plan acquis par la France doit se poursuivre dans un domaine non moins important pour les professionnels, celui de la définition du Musée et de la protection des collections à travers un nouveau cadre législatif en cours d'élaboration. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'une affaire franco-française destinée à équilibrer les pouvoirs en période de décentralisation, mais d'un acte fondamental dont la portée internationale sera considérable dans les années à venir. Le développement sans précédent des musées en France, l'extension de leur champ d'activité, l'augmentation de leurs fréquentations, tout concourt à faire de la situation française un champ d'expérimentation suivi avec intérêt et curiosité par de nombreux pays aussi bien en Europe dans le tiers-monde.
Nul ne conteste, je crois, le bien-fondé d'une nouvelle loi dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 apparaît inadaptée. Le projet de loi actuellement en cours de concertation (l'est-il vraiment ?) comporte de nombreux aspects positifs qu'il ne s'agit pas d'ignorer.
Toutefois notre inquiétude provient surtout du Titre I (Dispositions relatives au musée) qui, s'il « verrouille » bien les collections, risque de laisser passer l'opportunité de réaffirmer la spécificité du musée à travers une définition forte. La crainte d'une marginalisation de l'institution muséale dans un monde de libéralisme a visiblement suscité une auto-censure de la part des auteurs de la loi. Or la situation ne peut être uniquement comparée aux pays voisins du Nord comme on affecte trop souvent de le penser. Le rayonnement culturel de la France dépend aussi de ses capacités à conjuguer ses lois et son souci d'universalisme.
Si l'ICOM a sans cesse cherché à améliorer une définition universelle du musée jusqu'à proposer un Code de déontologie, lui-même en constante évolution, ce n'est pas pour se substituer aux lois nationales mais bien au contraire pour affirmer des principes fondamentaux auxquelles nous sommes viscéralement attachés. Nous attendons des autorités de notre pays qu'ils les respectent.
On trouvera dans ce numéro une analyse de la composition des membres du Comité français. Ce travail, mené par Françoise Wasserman, conjointement à une réflexion sur les critères d'adhésion à notre comité, vient au moment où nous atteignons le cap des mille membres, soit plus du dixième de l'ensemble des membres de l'ICOM, dont nous sommes à ce jour le premier Comité National. C'est pourquoi, renouant avec une tradition ancienne, nous publierons chaque année la liste de nos nouveaux membres.
Une notable partie de ce numéro est consacré à l'Afrique. On y trouvera des renseignements sur l'engagement de l'ICOM à travers son programme AFRICOM mais aussi des informations sur des réalisations en cours. Enfin, deux muséologies africains donnent ici leur point de vue sur le type de collaboration qu'ils souhaitent voir se mettre en place avec la France. Ce petit dossier ne prétend pas à l'exhaustivité mais se veut une information sur une aire géographique peu connue des muséologues français. Les adresses des auteurs et institutions ayant participés à ce dossier vous permettront de poursuivre le dialogue si vous le souhaitez et peut-être d'élaborer des actions communes.
Bien des projets sont en gestation pour mieux faire connaître l'action de notre Organisation et tout particulièrement de ses membres francophones. Il en sera ainsi en 1994 du Congrès sur « Les musées des départements français d'Amérique » qui se tiendra en Martinique conjointement avec une réunion de l'Association des Musées de la Caraïbe (MAC) ou encore de la refonte de nos conventions d'échange avec les pays de l'Est de l'Europe où les demandes de collaborations ont beaucoup évolué. D'autres projets existent et pourront, je l'espère, être menés à bien avec le soutien et la collaboration de nos partenaires et en particulier la Direction des Musées de France.
Je saisis cette occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux pour une très heureuse et très fructueuse année 1994.
Jean-Yves Marin
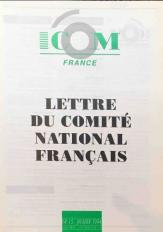
Lettre de l'Icom France n°16

Editorial
L'événement marquant de cette rentrée pour notre comité sera le congrès « les musées des départements français d'Amérique » qui se tiendra à Fort-de-France du 14 au 18 novembre prochain à l'occasion de notre première Assemblée Générale outre-mer. En faisant ce pari, nous ne mésestimions pas les problèmes économiques que poserait une telle réunion. Le bureau du comité français a malgré tout choisi de répondre favorablement à l'invitation de nos collègues de Martinique. Ceci pour deux raisons :
La politique muséale dans ces régions d'Amérique est en plein essor grâce aux efforts conjugués de l'État et des collectivités territoriales. La direction des musées de France et les collectivités territoriales de Martinique nous ont apporté un soutien significatif–dans une période particulièrement difficile–montrant l'importance qu'ils accordent au musée de ces pays.
À l'heure où la francophonie connait les difficultés que l'on sait -même au sein de notre Organisation comme en témoigne la lettre adressée au Président de l'ICOM par le bureau (voir p.7) –il nous a semblé opportun de réaliser un congrès français en Amérique. Cette initiative a d'ailleurs été saluée par de nombreux collègues d'Amérique… du Sud et d'Amérique centrale.
La XVIIe Conférence Générale de l'ICOM se tiendra en juillet prochain à Stavanger en Norvège. Là encore, il est important que les membres du comité français soient nombreux à ce rendez-vous où se mesurera notre véritable influence. Deux Français seront candidats au Conseil Exécutif qui sera élu à cette occasion. Vous trouverez dans cette lettre un texte de chacun expliquant le sens de son engagement. Je ne peux que vous inviter à les soutenir particulièrement dans les réunions des comités internationaux auxquelles vous participerez d'ici la Conférence Générale.
Pour mieux nous connaître, pour informer les nouveaux membres, nous publions dans ce numéro la liste des Français membres de bureaux de comités internationaux. N'hésitez pas à prendre contact avec eux afin qu'ils vous apportent une information la plus complète sur le comité qui vous intéresse. Dans cette esprit une réunion de bureau élargie à tous les élus français de l'Organisation se tiendra au cours de l'hiver pour préparer dans les meilleurs conditions la Conférence Générale. Plus vous serez nombreux à intervenir dans ce débat, plus nous serons à même de répondre à vos demandes. Nous y reviendrons plus longuement dans une prochaine lettre.
En étroite liaison avec le secrétariat général nous apportons notre contribution à la réussite du programme triennal de l'ICOM. Ceci en participant aux réunions internationales mais aussi par nos propres réalisations, affirmant ainsi notre spécialité.
Des contacts, des projets, des réalisations en cours aussi bien avec nos partenaires traditionnels (pays de l'Est de l'Europe, Afrique de l'Ouest) qu'avec des institutions dynamiques nous proposant un partenariat : Université francophone d'Alexandrie, Handicap International… L'ICOM ne vit que si l'on s'en sert, il appartient donc à chacun d'être inventif, d'imaginer de nouvelles approches pour ce qui est sans cesse notre mission, le rayonnement des musées dans le monde.
Jean-Yves Marin
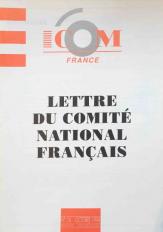
Lettre de l'Icom France n°17

Editorial
En ce début d’année deux tâches importantes nous mobilisent : la première, traditionnelle pais chaque année plus lourde pour notre secrétaire, est de vous envoyer dans les meilleurs délais votre vignette 1995 ; l’accroissement régulier du nombre de membres rend cette opération toujours plus longue, alors un tout petit peu de patience… La seconde, non moins traditionnelle, est de tenter de réunir un maximum de subventions pour venir en aide à ceux qui souhaitent se rendre à la Conférence générale et qui ne disposent pas du soutien financier de l’organisation.
A cet égard, il faut savoir que l’organisation d’une Conférence générale est devenue au fil des ans une entreprise lourde et financièrement périlleuse. Le choix de la ville de Stavanger, proposé par le Comité consultatif et confirmé par le Conseil exécutif, fut motivé à la fois par les qualités de prestations offertes par les organisateurs, mais aussi et surtout parce qu’il garantit la possibilité de découvrir les musées de Scandinavie qui, forts de leurs riches collections, sont devenus au cours de la dernière décennie un véritable pôle d’expérimentation des techniques muséales.
Certes nous n’ignorons pas que le coût du voyage sera prohibitif pour beaucoup et ce malgré nos efforts. Nous espérons cependant que, comme lors des précédentes Conférences, les Français seront nombreux et actifs. Rappelons que nous ne pourrons vous aider que si vous avez renvoyé le questionnaire d’intention diffusé en début d’année.
Il me faut revenir sur l’état des finances du Comité français pour rappeler que les cotisations des membres, qui sont habituellement une source de revenus non négligeable pour la plupart des associations professionnelles sont, pour le cas de l’ICOM et conformément aux statuts de l’Organisation, reversées aux neuf dixième au Secrétariat général comme participation au fonctionnement et à la réalisation des programmes triennaux. Cette situation est saine car elle est le garant de l’indépendance de l’ICOM. Chaque comité doit trouver des subventions et des financements exceptionnels par ses propres moyens. Or même si l’aide de la DMF reste importante, voire déterminante, elle n’a pas cessé de réduire au cours de ces dernières années. Cette baisse est d’environ 40% par rapport à la situation d’il y a cinq ans du fait des suppressions de nombreuses prestations en nature. Les contraintes de la gestion d’une association qui aujourd’hui approche les 1500 membres font que nous sommes arrivés à un seuil critique ; si de nouvelles baisses devaient intervenir, il ne serait plus possible d’assurer les services minimum que nous vous devons.
Fort heureusement et grâce à la diversité d’origine des membres, nous obtenons parfois des subventions exceptionnelles, comme c’est le cas pour cette Lettre publiée avec l’aide du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Direction de l’Information Scientifique et Technique et des Bibliothèques).
La place de la France dans l’ICOM dépend aussi du dynamisme de ses représentants. Vous trouverez plus loin une première information sur la réunion annuelle du Comité intenrational des Beaux-Arts (ICFA) qui, à l’initiative de Jacques Kuhnmunch et de Françoise Baligand, se tiendra cet automne dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Nous nous réjouissons qu’un important comité international se réunisse en France.
Notre fonction de réseau international ouvert à chacun ne doit pas nous faire oublier le rôle qui doit être le nôtre dans le débat national, que ce soit à propos de la nouvelle approche de la loi sur les musées de France ou sur les conséquences de la mise en application de la filière culturelle de la fonction publique territoriale. Nous serons présents dans la réflexion sur la protection des collections publiques qui semble s’amorcer, en rappelant qu’une fois de plus la ratification par la France de la Convention de 1970 sur le trafic illicite des biens culturels est reportée sine die ce qui ne garantit pas l’image de notre pays dans le monde. Souhaitons que la délégation française, qui en juin sera présente à Rome pour la Conférence chargée de l’élaboration d’une convention pour l’harmonisation des dispositions de droit privé (UNIDROIT), puisse confirmer l’appui de la France à ce projet concret.
Enfin, je voudrais revenir sur le colloque « créer, recréer le musée » organisé par Handicap International en juin prochain à Grenoble qui traitera de la place et du rôle des personnes handicapées dans les musées. De la notion d’accessibilité aux enjeux de l’accueil pour les équipes de musées en passant par le « syndrome de Stendhal » et le musée comme lieu d’apprentissage de créativité, ce colloque illustre parfaitement à mes yeux l’enjeu majeur de notre métier en cette fin de siècle : le musée doit-il rester au service de la société et de son développement ou s’inscrire définitivement dans une logique de marché pour le meilleur et pour le pire ?
Jean-Yves Marin
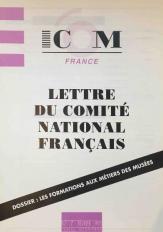
Lettre de l'Icom France n°18

Editorial
Les professionnels des musées respectant le rythme des saisons, l’automne est traditionnellement consacré à la préparation des budgets. Perspective peu enthousiasmante au sein même de nos établissements, et qui devient angoissante pour les responsables associatifs. La tentation est grande –quand les temps sont difficiles- de ne parer qu’au plus pressé, ce qui n’est déjà pas si simple. Tel n’est pas le choix retenu par le comité français, vigoureusement relayé par la Direction des Musées de France, qui tente avec opiniâtreté d’intéresser de nouveaux partenaires aux activités de l’ICOM.
La Conférence Générale de Stavanger s’est tenue la première semaine du mois de juillet. Au lendemain de ces « grandes messes » on se doit d’en tirer les enseignements et de tenter d’améliorer la qualité des tâches qui incombent à chacun. Pour ce faire, nous avons interrogé les participants en leur demandant dès leur retour de nous adresser leurs commentaires, critiques, suggestions, mais aussi de nous faire parvenir un compte rendu de leurs activités scientifiques sur place. Beaucoup ont répondu, souvent avec spontanéité. Ils nous ont fait part de leur vie quotidienne durant la Conférence Générale, soulevant des questions, proposant des solutions inattendues. Il n’est bien sûr pas possible de publier l’intégralité de ces courriers. Françoise Wasserman a accepté d’en tirer les principaux enseignements. Par ailleurs, nous avons informé le Secrétaire Général de l’ICOM de ces réactions.
Rappelons ici que la délégation française, forte de près d’une centaine de personnes, était l’une des plus importantes. Nombreux furent les auteurs de communications, de rapports, les présidents de séances, signifiant ainsi le dynamise des professionnels français. Malgré cela, il faut convenir que proportionnellement à sa place dans l’ICOM –tant par le nombre de ses membres que par sa participation financière- la France compte un assez faible nombre d’élus au sein des comités internationaux. Cela est inhérent à la timidité des Français (et plus généralement des francophones) à se présenter aux élections, phénomène lié à la forte prédominance de l’anglais dans les débats, particulièrement sensible à Stavanger. Répétons une fois de plus que nous ne saurions chercher querelle à nos collègues anglophones de cet état de fait, mais l’exigence d’une parité entre les deux langues officielles de l’Organisation doit être maintenue car nous risquons de sombrer dans un unilinguisme de fait, dommageable pour tous.
Concernant la représentativité de l’ICOM dans le monde, on doit noter la création de deux nouvelles organisations régionales :
-
L’Association des Musées de l’Ocean Indien (AMOI) où notre comité sera représenté par le collègue de la Réunion.
-
L’Organisation régionale des Pays Arabes, pour lequel nous entendons être un partenaire actif et fidèle.
La réorganisation du Groupe Europe en une organisation régionale comprenant pour l’instant les présidents des comités nationaux européens, permettra de mieux nous faire connaître auprès des instances de la Communauté Economique Européenne et d’aider à l’intégration des comités de l’Est de l’Europe en cours de réorganisation.
Enfin, la prochaine Conférence Générale se tiendra en octobre 1998 à Melbourne. Même si nous nous réjouissons qu’une importante réunion de l’ICOM se tienne pour la première fois dans cette région du monde, on ne saurait ignorer que le coût de séjour sera prohibitif pour la plupart d’entre nous, et qu’il appartiendra au bureau de préparer très en amont cet évènement.
Sur le plan juridique, l’adoption, le 24 juin 1995, à Rome, de la Convention d’UNIDROIT sur la restitution et le retour des biens culturels, immédiatement paraphée par la France, nous oblige à rappeler que contrairement à la majorité des grands pays importateurs de biens culturels (Etats-Unis, Australie…) la France n’a toujours pas ratifié la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels.
Le comité français de l’ICOM est intervenu à de nombreuses reprises en ce sens auprès du Ministère de la Culture. Des questions orales ont été posées au Sénat et à l’Assemblée Nationale. Récemment le Ministre de la Culture a demandé au Ministère des Affaires Etrangères de « mettre en œuvre la procédure de dépôt de l’instrument de ratification de cette convention ». Maintenant le Service juridique de ce ministère émet des réserves alors qu'il avait présenté et soutenu au Conseil des Ministres et au Parlement la loi qui autorise cette ratification…
Devant une telle inertie administrative, et forts de la volonté d’aboutir, nous multiplierons nos interventions les semaines à venir jusqu’à l’obtention de la ratification de la Convention de l’UNESCO, étape indispensable vers la ratification devenue plus importante de la Convention UNIDROIT.
L’accroissement sensible du nombre des membres encore cette année –dont on trouvera la liste dans cette Lettre- est la meilleure réponse à ceux qui s’inquiètent de l’utilité des organisations non-gouvernementales et de leur devenir. Au regard de cette liste on peut se réjouir de voir combien ICOM-France est représentatif du monde muséal dans sa diversité. Il n’en est pas de même auprès de nos collègues de la Direction du Patrimoine et dans les collectivités territoriales œuvrant sur le patrimoine mobilier conservé hors des musées. Un important effort a été fait dans leur direction au cours des dernières années, notre champ d’activité devant s’étendre presque aux limites de celui de l’ICOMOS dont l’action porte sur le patrimoine immobilier. Ce sera là une des tâches du prochain bureau afin de nous mettre en conformité avec les autres grands comités nationaux où cette dangereuse répartition administrative n’existe pas.
Dans quelques semaines une partie du bureau sera renouvelée, les candidatures sont nombreuses et de qualité. Les opérations électorales deviennent un peu plus difficiles à gérer à chaque nouvelle élection du fait de l’accroissement du nombre des membres. Je vous demande donc d’être particulièrement scrupuleux dans le respect des consignes de vote afin de simplifier la tâche du secrétariat et des scrutateurs lors du dépouillement.
La vie du comité ne peut se résumer en quelques lignes. ICOM-France fait chaque jour l’objet de sollicitations et de demandes de renseignements émanant de ses membres mais aussi d’horizons professionnels les plus divers. Demandes parfois sérieuses, voire graves, mais aussi interrogations surprenantes, cocasses, qui montrent combien il reste à faire. Si je puis formuler un souhait pour les trois années à venir, c’est que nous soyons encore plus nombreux à œuvrer dans l’esprit de l’ICOM afin d’élargir notre audience et de mieux défendre l’éthique d’une profession que nous avons choisie.
Jean-Yves Marin
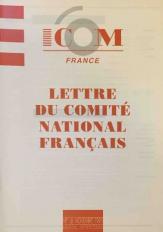
Lettre de l'Icom France n°19

Editorial
A l’orée de ce nouveau mandat, nous aurons appris que l’un des plus grands périls qui guettent les responsables d’une association nationale est l’organisation d’élections par correspondance… en période de grève postale. Malgré tout et grâce à votre infinie patience les choses sont rentrées dans l’ordre ; l’Assemblée générale a pu se tenir à la date prévue et après quelques péripéties, les élections eurent lieu sous le strict contrôle des scrutateurs. Si les dieux de la poste l’ont voulu ainsi et si vous êtes à jour de votre cotisation, vous devez même avoir reçu votre précieux timbre 96 vous garantissant en premier lieu gratuité et « coupe-file » dans la plupart des musées du monde.
Notons à propos de ce renouvellement partiel du bureau que la présence de 31 candidats pour 4 postes à pourvoir répond à l’évidence à ceux qui s’inquiètent encore de la légitimité du comité national. L’extrême diversité des origines professionnelle des candidats –dans le cadre des métiers du musée- est une source de bon fonctionnement qui confirme que la grande vague d’adhésion de ces trois dernières années (près de 500 nouveaux membres), entreprise conformément aux nouvelles directives du comité consultatif, a porté ses fruits.
Dans sa nouvelle composition le bureau sera privé de trois personnalités représentatives. Les trois sortants Catherine Arminjon, André Desvallées et Martine Jaoul ont joué, chacun à leur manière, un rôle de premier plan au sein du comité pendant de longues années, animant des groupes de travail, assurant l’accueil des collègues étrangers en France et occupant des responsabilités scientifiques dans leurs comités internationaux. Je souhaite vivement qu’au sein de ces comités où ils sont plus que jamais actifs, ils continuent d’œuvre en symbiose avec le comité national.
L’arrivée de nouveaux élus issus de prestigieuses institutions vient confirmer un engagement, nécessaires au rayonnement de la France, dans l’Organisation. Le rééquilibrage entre Paris et province s’effectue lentement au gré des nominations et de la création de nouvelles institutions muséales. C’est en effet une de nos satisfactions que de voir adhérer la quasi-totalité du personnel scientifique d’un nouveau musée dans les deux années qui suivent son ouverture au public.
A l’issue d’une première réunion du bureau, il a été convenu de répartir les tâches de la façon suivante :
Charles Penel ayant accepté de conserver la très astreignante fonction de trésorier –toujours secondé par Jean-Jacques Ezrati- c’est lui qui, en liaison avec Florence Hollande, continuera de gérer les cotisations et de suivre, avec la vigilance souriante et ferme qu’on lui connaît, l’ensemble des comptes de l’association.
Le secrétariat général sera désormais assuré par Françoise Wasserman qui, de ce fait, transmet à Françoise Baligand le suivi des dossiers de candidatures à l’ICOM. Ségolène Bergeon pour la conservation et Michel Van Praët pour l’histoire naturelle participeront comme par le passé à ce suivi. C’est là l’occasion de rappeler que, loin d’être une formalité, le fait d’adhérer à l’ICOM implique de répondre à des critères très stricts et fait l’objet d’une étude au cas par cas lors des réunions du bureau exécutif.
L’équipe de rédaction de la Lettre, dirigée par Michel Van Praët, comprend Viviane Huchard et Françoise Wasserman. Cette Lettre, qui a vocation d’être un bulletin de liaison entre les membres, vous est ouverte pour apporter de l’information sur l’activité internationale des musées français.
Hormis les activités traditionnelles, trois actions importantes pour l’avenir du comité devront être entreprises au cours de ce mandat :
- La préparation du 50e anniversaire de l’ICOM (18-23 novembre 1996) qui donnera lieu à de nombreuses manifestations dont une publication retraçant le rôle des Français dans la genèse et le développement de ces cinquante années d’ICOM. Irène Bizot, Charles Penel en liaison avec l’équipe de rédaction de la Lettre travaillent dès maintenant à regrouper l’information nécessaire.
- L’action menée en direction des musées du monde francophone particulièrement en Afrique, sera poursuivie avec nos partenaires habituels, eux-mêmes opérateurs de programmes à long terme, l’ICCROM et l’Université Francophone Senghor d’Alexandrie. Des actions spécifiques sont également en préparation avec Handicap International. Ceci dans un souci d’information réciproque avec Africom et les comités internationaux intéressés. Je continuerai de coordonner ce programme en souhaitant qu’un plus grand nombre de membres s’impliquent car l’enjeu est considérable pour la défense et la protection du patrimoine du Tiers-Monde.
- La réunion triennale du comité de conservation se tiendra en Ecosse cette année, nous espérons que la France sera retenue pour accueillir ce comité en 1999. La prise en charge de ce dossier complexe sera assurée par Jean-Pierre Mohen en collaboration avec Ségolène Bergeon et Jean-Jacques Ezrati.
Je sais que la question quotidienne d’une association professionnelle à vocation internationale peut apparaître lointaine aux membres peu familiers des organisations non-gouvernementales. Toutefois, nous n’oublions pas que nous sommes au service des membres ; aussi n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer plus activement à la vie de l’ICOM. Je terminerai en reprenant à mon compte cette phrase d’Elisabeth Des Portes, Secrétaire générale de l’ICOM, à l’occasion de la préparation du 50e anniversaire : « Nous pensons que notre Organisation a largement contribué aux réflexions et au travail qui ont permis aux musées de mieux répondre aux attentes de leurs publics et de connaître le succès qu’ils remportent en cette fin de siècle ». Le travail continue.
Jean-Yves Marin
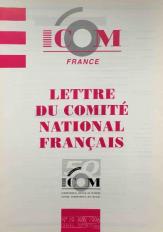
Lettre de l'Icom France n°20

Editorial
En cette rentrée plutôt avare en bonnes nouvelles, il faut toutefois signaler deux entreprises qui devraient avoir des retombées positives pour le monde des musées. La première, d’ordre international, concerne le renouveau d’intérêt des autorités françaises pour les conventions internationales, outils indispensable à l’assainissement du marché de l’art.
Après la signature de la convention UNIDROIT (juin 96), portant sur le retour des biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, qui a provoqué quelques violentes diatribes de marchands d’art en mal dans la presse spécialisée, on nous annonce la ratification par la France de la convention 1970 concernant les mesures à prendre pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels au cours de la réunion du Conseil exécutifs de l’UNESCO de ce mois. Il aura donc fallu 26 ans pour que la France ratifie un document sur lequel tous les partis concernés semblaient d’accord depuis 1982. On ne peut que se réjouir d’un Ministre de la Culture ait enfin pris le problème à bras le corps. De très longues dates les présidents qui se sont succédés à la tête du Comité français ont œuvré avec la même opiniâtreté pour atteindre cet objectif.
Le second point positif de cette rentrée est la mise en discussion d’un projet de loi relatif aux musées de France destinés à se substituer à l’ordonnance du 13 juillet 1945 portant sur l’organisation provisoire des musées des beaux-arts. Une nouvelle mouture nous est proposée, cette fois-ci simple, claire, prenant en compte la réalité actuelle des musées français dans leur diversité, expurgée des ingrédients d’un libéralisme révolu. Même si quelques artistes laissent présager des négociations difficiles, nous sommes enfin sur le bon chemin.
Revenons à la vie de notre Comité avec, en particulier, une politique coordonnée d’accueil des comités internationaux en France, afin de permettre à chacun de pouvoir y participer et de montrer nos réalisations aux collègues étrangers.
Après le succès remporté par le comité des Arts appliqués réuni au musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon sous la houlette de sa très efficace présidente Catherine Arminjon, nous accueilleront en 1997 le comité de Muséologie et le comité Costume. Vous trouverez dans cette Lettre les premières informations sur ces réunions auxquelles nous espérons une large représentation française à la hauteur de la participation internationale annoncée. Enfin, les efforts de la délégation française à la réunion du comité de Conservation à Edimbourg ont porté puisque la prochaine délégation triennale de ce comité en 1999 se tiendra à Lyon. Outre la reconnaissance du travail de nos collègues dans cette discipline, c’est aussi une victoire pour la Francophonie.
Je souhaite vivement que ces informations positives vous auront fait oublier un instant les coupes de budget et autres annulations d’expositions, lot commun de tout professionnel de musée européen en cet automne.
Jean-Yves Marin
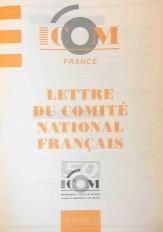
Lettre de l'Icom France n°21

Editorial
Cette lettre qui a pour ambition de vous tenir informés de l’action du Comité français au sein de l’ICOM n’évoque que très partiellement l’action des comités internationaux qui constitue par ailleurs la matière première des « Nouvelles de l’ICOM ». Je voudrais toutefois m’arrêter un moment sur ces comités internationaux car c’est en leur sein que se réalisent les principaux objectifs de l’Organisation. Ils sont le lieu d’échange d’informations scientifiques au niveau international où s’élaborent les normes professionnelles nécessaires à notre travail quotidien, garante de notre déontologie. Les réunions annuelles des comités internationaux sont l’occasion de rencontres à caractère souvent universel, véritable laboratoire permanent de la muséologie. Le nombre sans cesse grandissant de publication émanant de ces comités atteste, s’il en était besoin, de la vigueur de l’ICOM.
Pour toutes ces raisons, il nous faut suivre avec vigilance l’évolution de ces comités. La croissance exponentielle du nombre de ses membres actifs provoque une lente mutation tant dans le fonctionnement –meilleure rotation des responsables qui ne restent guère plus de six ans en place- que dans le travail de fond, comme en témoignent les groupes de travail et les publications.
Rappelons que le fait d’appartenir comme membre votant à l’un des comités internationaux est la marque d’un engagement professionnel même s’il est souvent difficile de pouvoir assister à des réunions lointaines. La réorganisation récente du Centre de documentation de l’ICOM a opportunément donné une place nouvelle aux publications des comités nationaux et internationaux. Je ne saurai trop vous inciter à les consulter pour mieux en mesurer les résultats.
A cet égard, l’ICOM est victime de son succès car l’afflux de participants aux réunions internationales oblige certains comités à repenser leur organisation, à mieux étudier le financement de leurs actions, à s’ouvrir à des partenaires qui tendent vers une interdisciplinarité parfois difficile mais indispensable, sous peine d’un émiettement de notre travail qui va à l’encontre des principes d’universalités qui sont les nôtres.
Nos membres sont très présents dans ce débat comme l’atteste cette année l’accueil en France des comités « Costume » et « Muséologie » dont on trouvera les programmes définitifs dans cette Lettre.
D’autres actions concrètent se mettent en place avec des comités nationaux. Ainsi, une récente rencontre avec le bureau d’ICOM-Italie à Paris ouvre des perspectives de collaboration dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels par la publication en liaison avec le Secrétariat Général d’un ouvrage de la série « 100 objets disparus ».
A l’initiative du Comité canadien, une délégation française conduite par Françoise Wasserman s’est rendue à Ottawa, Montréal et Québec pour poser les bases d’une collaboration destinée à mieux faire connaître les nouvelles réalisations des musées de société de part et d’autre de l’Atlantique.
Le jeune Comité marocain organise périodiquement des séminaires de formation continue pour ses membres avec le concours de l’ICOM-France, les prochaines auront lieu en mai.
Enfin, l’Organisation Régionale Europe, créée à Stavanger en 1995, trouve lentement son rythme de travail (c’est si difficile l’Europe !) et devient petit à petit un lieu où s’élabore un partenariat entre les musées du continent, renforçant le rôle fédérateur de l’ICOM.
Bien d’autres actions sont en cours dont vous trouverez les échos dans cette Lettre, qui, j’en suis sûr, inciteront nombre d’entre vous à investir plus encore à nos côtés pour la défense des musées.
Jean-Yves Marin