
Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Lettre de l'Icom France n°22

Editorial
Il est de bon ton depuis quelques mois d’affirmer qu’après la vague de grands travaux de la décennie passée les musées ne sont plus une priorité en France. Rien n’est moins vrai. Si beaucoup d’établissements se sont vu transformés, agrandis, renouvelés, souvent avec bonheur, le moins que l’on puisse dire est que l’intendance ne suit pas. Tel musée de province refait à neuf n’est jamais entièrement ouvert faute de gardiens, tel établissement de la capitale voit ses crédits d’exposition amputés et, pire encore, ses crédits d’acquisition réduits. L’heure est donc à la mobilisation pour les musées.
L’urgence est de forger un outil législatif fort qui nous sorte enfin des ordonnances d’après-guerre. Le projet de loi relatif aux musées de France est à cet égard un point de départ convenable. Certes on aurait préféré y trouver une définition du musée où le « but non lucratif » aurait été implicitement revendiqué plutôt que suggéré. Une suppression des catégories de musées aurait été plus conforme aux statuts des conservateurs des deux fonctions publiques. Enfin, en allant dans le sens d’une labellisation du mot musée, on aurait affirmé la volonté des musées français d’être au cœur du dispositif éducatif et culturel. On le voit, des modifications pourront être heureusement apportés, mais ce qui nous semble important, c’est que pour la première fois la spécificité de l’institution muséale dans sa diversité soit affirmée avec force.
Problème juridique encore avec le long combat pour l’établissement d’un dispositif législatif international destiné à lutter contre le trafic illicite des biens culturels. A peine la France a-t-elle enfin ratifiée la convention de 1970 de l’UNESCO sur le trafic illicite, qu’un nouveau sigle, UNIDROIT, vient s’imposer dans notre vocabulaire professionnel. Pour tous ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec ce texte partant sur le retour des biens illicitement exportés –non rétroactif, évidemment !- j’ai demandé à un juriste spécialiste de ces problèmes et membre de notre comité, d’ne résumer la teneur et d’en présenter les enjeux aux lecteurs de cette Lettre.
Dans la précédente Lettre, j’évoquais le rôle essentiel des comités internationaux pour le bon fonctionnement de l’ICOM. En ce domaine, l’année a été particulièrement faste pour la France qui a successivement accueilli en juin 97 le comité Costume et le comité de Muséologie. Dans les deux cas, les congressistes venus de plus de 20 pays ont pu apprécier les réalisations récentes des musées tant de province que de la capitale.
Parallèlement, le Comité Consultatif siégeait à l’UNESCO et décidait en particulier du lieu de la Conférence générale en 2001. En choisissant Barcelone, le Comité rappelait avec force l’importance du monde hispanophone au sein de l’ICOM. Beaucoup d’autres décisions prises à cette occasion tracent le chemin que suivra l’ICOM dans les années à venir. Vous en trouverez mention dans les pages suivantes ainsi, bien sûr, que dans les Nouvelles de l’ICOM pour les orientations générales.
Enfin, nous venons d’apprendre que Madame Elisabeth Des Portes, secrétaire générale de l’ICOM, a choisi de quitter notre Organisation pour rejoindre d’autres fonctions. Secrétaire générale depuis 1991, à la tête d’une équipe dont l’efficacité et la gentillesse sont unanimement saluées, Elisabeth Des Portes a joué un rôle déterminant dans une période particulièrement complexe. Alors que le désenchantement était fort à l’écart des Agences internationales, et des ONG, l’ICOM lançait, en 1991, son programme « Quels musées pour l’Afrique ? » avec le succès que l’ont sait. Au cours de ces six dernières années, un travail important a été accompli : création de nouveaux comités nationaux partout dans le monde, la difficile transition du Centre de Documentation devenue enfin la mémoire vivante de l’ICOM, l’organisation de deux Conférences générales et, peut-être plus difficile et plus réussi encore, les fêtes du 50e anniversaire de l’ICOM qui ont été une occasion unique de montrer la vitalité des musées dans le monde.
Je sais me faire l’interprète des nombreux membres du comité français de l’ICOM qui ont eu la chance de travailler avec Elisabeth Des Portes, en l’assurant de notre respectueuse affection et de tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.
Jean-Yves Marin
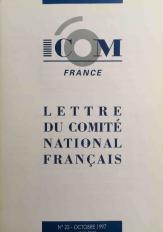
Lettre de l'Icom France n°23

Editorial
Cher(e) Collègue,
L’année 1998 s’annonce financièrement difficile pour notre Comité, ce qui nous amène à réduire le rythme de parution de la Lettre. La prochaine paraîtra cette automne et comportera nombre d’information sur l’action des Français au sein de l’ICOM.
Malgré l’aide régulière de la Direction des musées de France, de la Réunions des musées nationaux et de l’Etablissement Public du Louvre, on ne peut nier que les subventions diminuent régulièrement ce qui limitent nos moyens d’action. Une récente intervention auprès du Ministre de la Culture, décrivant l’indigence des moyens alloués au Organisations Non-Gouvernementales par ce ministère, laisse espérer une amélioration de la situation.
Ceci étant tout sera fait dans les mois à venir pour aider tous ceux qui souhaiteront se rendre à la Conférence Générale de Melbourne. Il est d’ores et déjà possible de dire que nous serons en mesure de prendre ne charge les frais d’inscription de tout membre à jour de cotisation qui en fera la demande et, je l’espère, du billet d’avion des auteurs de communications ainsi que celui des membres occupant un poste de responsabilité dans un bureau international.
Il est inutile de revenir sur l’importance de la Conférence Générale triennale pour la reconnaissance du travail des professionnels de musées français, trop mal connu en de nombreux domaines.
A cet égard, la candidature de Jacques Perot à la présidence de l’ICOM est essentielle. Tout le parcours de Jacques atteste du bien-fondé de cette candidature tant son engagement au sein de notre Organisation est exemplaire. Secrétaire général du comité international des Arts appliqués (ICAA), président du comité français puis président du comité consultatif, il connait tous les rouages complexes de l’ICOM et dans ses fonctions a fait preuve d’une probité et d’un sens aigu du respect de notre Code de Déontologie, véritable charte des valeurs universelles qui unissent la communauté muséale mondiale.
Au nom du bureau exécutif du comité français, je voudrais dire à Jacques Perot toute la confiance que nous mettons en lui et à tous nos collègues étrangers qu’ils peuvent compter sur lui pour défendre au mieux les intérêts de l’ICOM et développer le rayonnement et l’efficacité de notre Organisation.
Chaque année, les contacts que le comité français entretient avec ses homologues sont plus nombreux ; les demandes de collaborations, souvent sous forme d’aide à la formation des professionnels, émanent de pays nouvellement entrés dans l’ICOM. Aujourd’hui, tous les continents sont représentés, même si certains musées marquent le pas ici ou là, ils sont de plus en plus au cœur des valeurs culturelles et donc démocratiques des Etats. C’est là une source d’espoir que notre comité participe avec vigilance et opiniâtreté à entretenir.
Jean-Yves Marin

Lettre de l'Icom France n°24

Editorial
La XVIIIe Conférence générale du Conseil international des musées aura été un « grand cru » pour les professionnels de musées français. L’élection de Jacques Perot à la présidence de l’ICOM récompense une activité internationale multiple et exemplaire. Elle est aussi une reconnaissance du travail considérable accompli par les muséologues de notre pays au cours des dernières décennies.
L’élection de collègues français dans les bureaux des comités internationaux dont vous trouverez la liste dans cette Lettre ne doit se lire ni comme un palmarès, ni comme une quelconque manifestation de nationalisme. Elle est tout au contraire la concrétisation d’une action universaliste, au service de la communauté muséale dans l’esprit du Code de Déontologie de l’ICOM.
A cet égard, on ne saurait oublier le soutien sans faille de la Direction des musées de France et plus généralement de toutes les directions du ministère de la Culture que nous avons si souvent sollicitées. J’évoquerai également le ministère des Affaires étrangères, particulièrement les services culturels des Ambassades qui nous ont toujours réservé le meilleur accueil.
J’ai souvent écrit que le savoir-faire des professionnels de musée français était insuffisamment connu à l’étranger, que trop peu d’entre nous acceptions cette nouvelle forme de nomadisme qu’est l’action internationale. Cependant beaucoup a été fait en appliquant la règle d’au moins un membre du comité français dans chaque réunion internationale. Il est impératif que des moyens suffisants permettent de maintenir cet objectif.
Le comité français se porte bien, avec un nombre de membres en progression constante, une diversité accrue des professions représentées et des finances saines dues au dévouement de notre trésorier Charles Penel. Au cours des six dernières années, nous avons ouvert de nouvelles collaborations en Afrique de l’Ouest, à la Caraïbe, dans l’Est de l’Europe, mais toutes ces actions demandent à être poursuivies et approfondies dans les années à venir
Le 11 décembre prochain, nous renouvellerons une large part du bureau exécutif français conformément aux statuts. Faut-il dire encore que voter est bien le moindre pour un membre responsable, surtout lorsque –comme c’est le cas- la liste des candidats offre un choix très ouvert.
Venant d’être élu à la présidence du Comité international des musées d’archéologie et d’histoire, il me parait souhaitable de quitter celle du comité français après six années au cours desquelles j’aurai été en contact avec la majorité des membres d’ICOM-France. Ce fut pour moi un enrichissement personnel et professionnel exceptionnel dont je vous remercie.
Plus que jamais les musées ont besoin de l’ICOM et le comité français doit rester un maillon fort de l’Organisation. De cela, je n’ai aucun doute.
Jean-Yves Marin

Lettre de l'Icom France n°25

Editorial
Mieux se connaître
Chaque comité national de l’ICOM présente ses caractéristiques qui, pour une part, reflètent l’histoire des musées de leur pays, avec ses forces et ses faiblesses.
Au plan international, notre comité français de l’ICOM se définit ainsi comme le plus important par le nombre de ses adhérents, avec le comité allemand. Au-delà de la satisfaction et des responsabilités qui en découlent, responsabilités que les précédents bureaux de notre association ont justement soulignées, il n’est pas inutile d’analyser les motivations de ses centaines d’adhérents. Ce remarquable niveau d’adhésion résulte pour une part de notre vitalité et de celle des musées français, mais probablement aussi de la tardive professionnalisation de ce secteur culturel en France. Ainsi, le comité français de l’ICOM n’a pas eu, comme en Amérique du Nord, à se situer vis-à-vis d’associations professionnelles préexistantes comme l’AAM aux USA.
En Europe même, l’histoire des musées et de ses métiers génèrent des particularités dans le profil des membres de chaque comité national. Ainsi, l’interprétation des critères d’adhésion, défini au niveau international par l’ICOM, suscite de vives discussions au sein du bureau de notre comité, lors de chaque réunion où sont examinées de nouvelles candidatures d’adhésion.
Pour mieux répondre à vos attentes, mieux exprimer les questionnements qui parviennent au secrétariat, susciter aussi et faire progresser des débats sur nos métiers et nos institutions, il est apparu utile de mieux connaître la nature des 1500 membres de notre comité et l’évolution de leurs profils ces dernières années. C’est dans cet esprit que nous lançons une étude, dont les résultats vous seront présentés dans une prochaine lettre.
Mieux se connaître, c’est aussi émerger dans un débat collectif les remarques et les questions individuelles dont vous faites part et dont la fréquence témoigne d’intérêts et de questionnements communs. Nombreuses aussi vos interrogations sur les conséquences de l’évolution institutionnelle des musées et de la diversification des professions.
La diversification des profession amène de nombreuses remarques sur la nécessité de mieux prendre ne compte le caractère collectif de la création de toute exposition et ainsi sur le caractère désuet de l’interprétation actuelle de notions aussi diverses que la maîtrise d’œuvre, la propriété intellectuelle, le droit à l’image…
L’évolution institutionnelle conduit beaucoup parmi vous à s’inquiéter, non de la présence d’activités commerciales autour de produits dérivés, mais de la nécessaire information des élus, en particulier locaux, sur les risques encourus par les collections et les bâtiments muséaux eux-mêmes dans des formes de gestion partiellement privatisées qui ne considèrent pas les coûts d’infrastructures nécessaires à long terme, au maintien et à l’enrichissement des collections et des bâtiments.
Ces questions sont essentielles et nous appelons vos remarques pour y faire écho dans les prochains numéros de cette Lettre, ainsi que lors de notre assemblée de fin d’année. Mais, dès à présent, une question est apparue, peut-être moins ambitieuse, mais partagée par l’ensemble des membres du bureau, comme méritant un développement : nos expositions font de plus en plus place à des substituts immatériels, mais aussi matériels. Quelles conséquences cela a-t-il sur des plans aussi divers que la conception des expositions, les droits attachés à ces substituts … ?
Mieux faire partager à l’étranger les compétences des professionnels français et aider les membres d’ICOM-France à bénéficier des expériences étrangères.
Nous aider, en tant que professionnels français, à mieux faire connaître la qualité de nos réalisations muséales à l’étranger, diffuser nos expertises, mais aussi bénéficier des expériences de nos collègues étrangers ont toujours guidé l’action du comité français.
C’est le sens des aides financières qui vous sont apportées pour vous permettre de participer aux réunions de vos comités thématiques à l’étranger ou pour organiser des réunions de ceux-ci en France.
L’année 1999 va être particulièrement riche de ce point de vue, car les réunions des quatre comités thématiques vont se dérouler en France à partir du printemps. Il s’agit de la réunion du comité des Musées et instruments de musique (CIMCIM) à Paris du 10 au 14 juin, du comité de Conservation (ICOM-CC) à Lyon du 29 août au 3 septembre, de la réunion conjointe du comité d’Histoire naturelle (NATHIST) axé sur les thèmes de conservation des objets de sciences naturelles, et enfin du comité Marketing et relations publiques (MRP) à Paris du 25 au 29 septembre.
Pour la première fois, un comité étranger, le comité allemand, va tenir sa réunion en France. Du 25 au 28 novembre ; des rencontres et des visites communes de musées avec les membres d’ICOM-Allemagne vous seront proposées selon un programme diffusés dans les prochaines semaines.
Avec le comité ICOM-Japon, la collaboration suscitée par les collègues japonais a pris la forme d’une enquête sur les services éducatifs et culturels des musées français. Vous avez reçu cette enquête en mars et vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu ; que les services éducatifs et culturels qui ne l’auraient pas fait adressent sans tarder au secrétariat du comité le matériel que nous collationnons pour les collègues japonais et qui contribuera à la diffusion de l’expérience française.
Michel Van-Praët
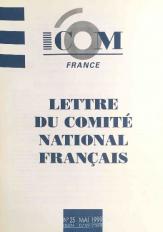
Lettre de l'Icom France n°26

Editorial
‘’Vous voulez acheter un mammouth laineux ?’’
Voilà l’annonce parue il y a quelques semaines sur un site web localisé aux USA. Ce même site se porte d’ailleurs acquéreur de pièces tant ethnographiques que paléontologiques, et déclare disposer d’un large choix d’objets muséaux offerts à la vente.
Au-delà d’objets d’art et d’ethnographie, des spécimens naturalisés et des fossiles sont ainsi de plus en plus fréquemment proposés sur le WEB.
Dès lors qu’une valeur commerciale existe – dans le secteur de la paléontologie cité précédemment, un fossile de Tyrannosaure rex a été vendu aux enchères cinquante millions de francs, aux USA, il y a un an- le WEB est utilisé pour mettre aux enchères patrimoniaux et ainsi développer le commerce voire créer un marché, dans des domaines jusque-là relativement préservés.
Alors qu’une majorité de pays, dont la France, n’ont toujours pas ratifié la convention Unidroit[1] « sur les biens culturels volés ou illicitement exportés », le WEB est mis à profit pour favoriser le développement d’un marché qui joue de la faiblesse des législations nationales et internationales et semble parfois flirter avec le trafic illicite.
Dans le « moins pire des cas » cet usage du WEB amplifie l’enrichissement patrimonial des musées des pays –ou des fondations- les plus riches, aux dépens des populations ayant des musées moins biens dotés. Dans le pire des cas, cet usage du WEB aboutit à la perte pour le public et la communauté scientifique, d’éléments de patrimoines qui mériteraient le qualificatif de « national » voire « international ».
Nous nous félicitons dans ce contexte de l’organisation à l’initiative de l’ICOM en l’An 2000, en France, d’un séminaire sur le trafic illicite en Europe.
Souhaitons que cette manifestation soit aussi l’occasion de favoriser une plus large ratification de la convention Unidroit sur les « biens culturels volés ou illicitement exportés » et que soient considérées les améliorations possibles de la protection de secteurs délaissés –comme celui des fossiles- ainsi que la régulation du commerce des biens culturels sur le WEB.
‘’Voulez-vous vendre votre musée ?’’
C’est ce qu’on ne trouve pas encore sur le WEB –du moins ce n’est le cas que de parties de collections hors de France-, mais c’est l’incertitude qui taraude plusieurs de nos collègues français, face à l’attitudes de certaines collectivités territoriales ou institutions, qui « délèguent le service public » dont elles ont la charge vis-à-vis de tel ou tel musée, à des entreprises privées.
A l’opposé d’une attitude frileuse sur les questions de gestion des musées, comme voudraient le faire croire certains, une réflexion est engagée par l’Association générale des Conservateurs, la Fédération des Ecomusées et le comité français de l’ICOM, pour contribuer à la modernisation de la gestion des musées dans le respect de leurs missions de service public.
Le débat engagé publiquement début novembre lors des journées Ptolémée à la Cité des Sciences et de l’Industrie, a entre autre favorisé la présentation par M. Robert Lecat du rapport de l’inspection générale de l’Administration des Affaires culturelles sur la « rénovation des instruments juridiques des services publics culturels locaux[2] ». Le débat s’est poursuivi lors des journées d’étude de l’Association générale des Conservateurs (17-19 novembre) et notre comité ICOM-France, en organisant son assemblée générale le vendredi 14 janvier 2000à Agen mettra à profit la proximité régionale avec l’Espagne, pour présenter l’approche espagnole de la gestion des musées. Nous espérons ainsi favoriser, avec votre participation, un échange entre professionnels de nos deux pays sur cette question qui sera dans deux ans au cœur de la conférence triennale de l’ICOM, en 2001 à Barcelone.
En espérant que vous serez nombreux à participer à l’Assemblée générale d’Agen, je vous adresse dès à présent, avec l’ensemble du bureau d’ICOM-France, mes vœux pour la dernière année du deuxième millénaire et pour des musées intégrés dans la Société et au service de tous.
Michel Van-Praët
[1] La convention Unidroit sur les biens volés ou illicitement exportés rédigée à Rome en juin 1995, a été signée par la France mais n’a jamais été ratifiée par notre pays. A ce jour, seuls l’ont ratifiée : la Lituanie, le Paraguay, la Roumanie, le Pérou, la Hongrie, la Finlande et l’Italie. Il est à noter que parmi les pays développés, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon et les USA ne l’ont ni signée ni ratifiée !
[2] Le rapport réalisé par Madame Chiffert et MM Lecat et Reliquet, sur « la rénovation des instruments juridiques des services publics culturels locaux » remis au Ministre de la Culture et de la Communication en février 1999, peut être consulté au secrétariat d’ICOM-France.
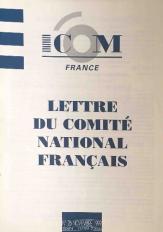
Lettre de l'Icom France n°27

Editorial
Cette Lettre témoigne de la richesse de vos activités, ainsi que de celle de l’ICOM, ce qui nous permet de réduire cet éditorial à quatre points.
Nous nous étions engagés à accroître les échanges d’informations entre les membres par la création d’un site internet. Voilà qui est fait grâce à plusieurs d’entre vous, merci ; utilisez-le, il est le vôtre : http://www.culture.fr/icom-france
Amplifier la lutte contre le trafic illicite :
Dans notre précédent éditorial nous soulignions l’importance d’une ratification internationale la plus large possible de la convention Unidroit sur la restitution des œuvres provenant de trafic illicite et sommes depuis intervenus à ce sujet dans plusieurs media, en soulignant que la France devait sans tarder la ratifier. Dans le même temps la direction de l’ICOM a, dans le même esprit, publié un important document sur le pillage du patrimoine africain : La Liste rouge de l’ICOM et nous faisons état dans cette Lettre des accords passés entre l’ICOM et les services des douanes dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite (voir plus loin). Quelles que soient les opportunités d’enrichissement des collections de nos musées, il ne saurait y avoir dans le domaine de la protection du patrimoine de concession à faire : la lutte contre le trafic illicite passe par une attitude exemplaire de notre pays via la ratification de la convention Unidroit, de nos musées dans leurs pratiques d’acquisition et d’exposition et de chacun de nous. C’est dans cet état d’esprit que nous nous adressons à la nouvelle ministre de la Culture, ainsi qu’aux ministres en charge des musées de l’Education et des collectivités territoriales.
Elargir la participation à la vie de l’ICOM :
La réunion en juin du comité consultatif de l’ICOM a permis aux représentants des 106 comités nationaux de l’ICOM et les 26 comités thématiques internationaux e faire le point de la réflexion engagée sur la réforme des statuts de l’ICOM et celle du code de déontologie. La volonté d’une réforme permettant d’associer plus largement les adhérents de l’ICOM à la vie de l’association a été unanimement approuvée. Parallèlement à la discussion du thème de la conférence de Barcelone en 2001 (voir plus loin), la réforme des statuts et du code de déontologie seront deux éléments très importants à débattre et à adopter à Barcelone. Retenez sur vos agendas les dates de cette conférence internationale (1-8 juillet 2001) qui se tient à nos portes, alors que celle de 2004 sera très probablement organisée à Séoul. Sans attendre, intervenez dans les comités internationaux, dont vous êtes membre pour les inciter à la tenue à barcelone de réunions avec d’autres comités sur des thèmes communs et adressez-nous toutes vos suggestions sur la réforme des statuts et du code de déontologie.
Certains d’entre vous pourront être surpris de la tenue de deux assemblées générales de notre Comités français au cours de l’année 2000. Chaque année, l’assemblée générale examine en fait les comptes de l’exercice achevé plusieurs mois auparavant. Ainsi l’assemblée générale tenue en janvier à Agen a approuvé les comptes et le compte-rendu de l’activité de l’année 1998, alors que nos collègues Jean-Yves Marin et Charles Penel étaient respectivement président et trésorier de notre comité. C’est pour combler une partie du retard que nous tiendrons, en octobre, une assemblée générale à Reims. Au-delà de l’examen de l’exercice 1999, elle nous permettra de débattre ensemble des problématiques du tourisme culturel.
Poursuivre la professionnalisation de notre milieu :
Nous félicitons la réflexion engagée par l’Ecole nationale du Patrimoine sur l’évolution du mode de recrutement des futurs conservateurs et sur la nature de ses enseignements, comme nous avons pu en débattre avec sa directrice Geneviève Gallot. A l’initiative du comité portugais de l’ICOM, nous avons participé à une réunion des représentants des comités ICOM de l’Union européenne sur la formation des personnels de musées. L’hétérogénéité des modes de formation et de recrutement demeure la règle. Quelles que soient les évolutions indispensables du mode de formation des conservateurs en France et la nécessaire mise en place de mesures d’harmonisation permettant une circulation aisée des collègues entre les musées relevant d’administrations diverses (en particulier la Culture, les collectivités territoriales et l’Education), la professionnalisation des conservateurs français apparait au niveau européen comme une réalité. Il n’en va pas de même pour d’autres métiers, en particulier ceux de l’exposition et de la médiation. La diversité des offres universitaires constitue sans nul doute une étape positive (voir l’inventaire des formations) mais elle doit aujourd’hui se compléter d’une réflexion accrue sur les contenus des formations grâce d’une part à l’examen des expériences étrangères et d’autre part à une collaboration accentuée avec le milieu muséal.
Michel Van-Praët
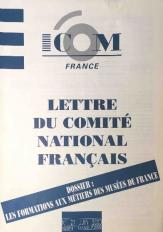
Lettre de l'Icom France n°29

Editorial
Depuis que le Conseil internationale des musées a vu le jour dans le sillage de l’UNESCO en 1946, la France a toujours occupé une place importante dans la vie de notre Organisation.
Sans doute parce que depuis la révolution française, ce pays a progressivement développé des musées qui, tout au long du XIe et du XXe siècle, se sont enrichis, entraînant très tôt la constitution d’un véritable corps de professionnels de musée.
Sans doute aussi parce que la liberté d’esprit des Français les prédisposait à trouver leur place dans les Organisations non gouvernementales où la liberté de ton et d’action sont le garant de l’efficacité.
La France est le pays siège de notre Organisation. A ce titre, nous entretenons d’excellentes relations avec les autorités culturelles françaises dont le soutien indéfectible a permis à l’ICOM de rester en France jusqu’à ce jour. Il nous faut pérenniser cette situation, et j’en appelle à la mobilisation des professionnels de musées français afin qu’ils attirent l’attention sur l’intérêt pour l’ICOM de maintenir son siège en France.
Je sais pouvoir compter sur les membres de l’ICOM, leur dynamisme, leur engagement auprès des instances de notre Organisation, comme en témoignent les nombreux membres français qui occupent des fonctions au sein des bureaux des Comités internationaux, lorsqu’ils n’en assurent pas la présidence.
Les présidents qui se sont succédés à la tête du Comité national français, deuxième Comité ayant le plus de membres, ont toujours su s’investir et défendre nos valeurs. L’ICOM s’est engagé dans un processus de planification stratégique. Nous comptons donc sur vous pour que l’ICOM soit perçue en tant qu’Organisation qui répond aux besoins de membres représentatifs d’une diversité géographique.
La tenue d’une réunion conjointe avec l’Allemagne est une excellente initiative. C’est un exemple qui devrait être poursuivi par d’autres Comités afin de favoriser la coopération interrégionale et soutenir nos efforts pour faire de l’ICOM une Organisation favorisant la diversité intellectuelle, culturelle ou sociale en tant que moteur de l’harmonie sociale et d’une meilleure compréhension des différences culturelles.
Alissandra Cummins
Présidente de l’ICOM
Qui sommes-nous ? Le dossier de cette Lettre du Comité national français de l’ICOM rend compte de l’enquête lancée auprès de nos 2 600 adhérents pour connaître vos activités mais aussi vos attentes vis-à-vis de notre organisation. Parmi celles-ci apparait clairement le souhait d’une meilleure liaison entre notre Comité national et les Comités internationaux de l’ICOM. Dans cette nouvelle édition de la Lettre vous retrouverez une rubrique régulière « 3 questions à … » qui donnera la parole aux collègues français élus dans les Comités internationaux, aujourd’hui Patrice Verrier pour le CIMCIM. Par ailleurs, la prochaine Assemblée générale ICOM France aura lieu à Berlin au Deutsches Historisches Museum grâce au concours actif de nos collègues du Comité national allemand. Placé sous le patronage du Haut Conseil culturel franco-allemand, cette réunion à Berlin marque l’engagement du comité national français dans les échanges européens et particulièrement dans la coopération culturelle franco-allemande. Francine Mariani-Ducray, directrice des musées de France, participera à cette Assemblée générale et à la table-ronde réunissant professionnels français et allemands. Nous rendrons compte de ces échanges dans le prochain numéro de la Lettre.
Dans ce numéro sont repris les textes des interventions proposées lors de notre dernière Assemblée Générale organisée en mai dernier à Paris au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Michel Van-Praët, Président de notre Comité national français jusqu’en octobre 2004, introduit ces communications qui portaient sur « le patrimoine immatériel dans les musées ». Ce thème général était également celui retenu pour la dernière Conférence internationale de l’ICOM à Séoul en 2004. Lieu d’innovation, le Conseil international des musées a toujours en effet défendu et illustré les formes nouvelles d’une muséologie qui, depuis la création de l’ICOM en 1946, a su évoluer dans le respect des différentes familles de musées que je souhaiterais mettre en œuvre avec vous dans les trois prochaines années. Cette Lettre du Comité national français de l’ICOM est d’abord votre Lettre et nous serons heureux de recevoir vos suggestions pour améliorer encore cet outil commun de communication. Notre prochaine réunion générale est à Berlin le 20 mai 2005, j’espère que vous pourrez venir nombreux pour ce moment important de la vie de notre Association.
Dominique Ferriot
Présidente d'ICOM France

Lettre de l'Icom France n°30

Editorial
En tant que Secrétaire général du Conseil international des musées, c’est un honneur pour moi de m’adresser à nos collègues d’ICOM France, tout particulièrement dans le premier numéro de la Lettre du Comité national français de 2006.
Pour notre organisation, l’année 2006 est doublement importante : elle marque le 60e anniversaire de notre naissance à Paris, mais aussi la célébration des 20ans de notre Code de déontologie pour les musées, qui a mis à jour il y a juste un an il y a juste un an lors de notre conférence générale à Séoul. Ce double anniversaire sera l’occasion de réfléchir aux acquis de notre organisation, mais aussi de définir notre ligne d’action pour les années à venir ; il va également permettre de renouveler notre engagement en faveur de la protection du patrimoine culturel à travers le monde en encourageant l’adhésion inconditionnelle de nos membres –tant individuels qu’institutionnels- aux meilleures normes et pratiques professionnelles telles qu’énoncées dans notre code.
L’COM peut s’enorgueillir du soutien que sa mission reçoit de ses quelques 22 000 membres, et du fait qu’il est consulté sur un éventail sans cesse plus large de questions liées au patrimoine culturel, tant par les agences internationales, les agences intergouvernementales que les gouvernements. L’ICOM peut célébrer cette année d’anniversaire avec un sentiment profond de satisfaction pour les connaissances produites et pour le processus de création qui, grâce à son réseau unique de professionnels et d’experts, de Comités nationaux et internationaux, est en marche constante. Le succès de la diffusion et du partage de ces compétences auprès de la communauté muséale du monde entier, voilà une autre source de fierté, tout comme le sont les solutions que nous proposons pour répondre aux besoins des musées en détresse, des praticiens demandeurs de programme de développement des capacités, et, enfin, du patrimoine culturel en danger.
Les accomplissements de l’ICOM au cours de ces 60 années sont, à n’en pas douter, remarquables ; pour autant, il n’est pas question de nous endormir sur nos lauriers. Beaucoup reste à faire et, encore plus, à apporter : l’ICOM a parfaitement conscience qu’il lui faut préparer ses membres à un environnement du patrimoine culturel en constante évolution, englobant de nouvelles manifestations de l’activité humaine et pour une meilleure compréhension.
Les changements climatiques nous montrent, de manière tragique, combien le patrimoine culturel est vulnérable ; ces nouvelles menaces, prenons-les comme des défis nous encourageant à trouver et à diffuser des mesures d’atténuation efficaces. Alors que notre communauté ne cesse de grandir, nous devons multiplier les efforts pour toucher les pays qui ne peuvent que difficilement accéder à nos compétences et qui ont besoin de notre aide pour mieux protéger leur patrimoine culturel en danger. Enfin, il reste à mieux exploiter les technologies de l’information et de la communication pour les mettre au service d’une communauté du patrimoine véritablement mondiale, ouverte et solidaire.
Nous pouvons en particulier souligner la relation étroite entre ICOM France et le Secrétariat général de l’ICOM. Pour de nombreuses raisons, et notamment la proximité de l’UNESCO et les relations anciennes qui remontent à la fondation de l’ICOM au Louvre en 1946, les bureaux de l’ICOM sont restés à Paris. La richesse des ressources et de l’action culturelle en France –en termes matériels et de personnels- ainsi que la priorité donnée à la culture ont constamment servi la cause de notre organisation et plus généralement celle des musées dans le monde. Récemment, la France a pris la tête des soutiens en faveur de la Convention pour la diversité culturelle adoptée par l’UNESCO et ICOM France, ainsi que les Comités internationaux basés en France (AVICOM, CIMAM, CIMUSET), ont participé activement au mouvement pour introduire les nouvelles technologies dans le monde des musées. Ces initiatives sont liées, et de plus en plus, les professionnels de musées sont des acteurs essentiels pour établir des ponts entre l’Europe et les autres parties du monde.
Les bonnes raisons de célébrer l’année 2006, l’ICOM les doit aussi à des comités tels que l’ICOM France, dont les activités intenses ont énormément apporté à l’organisation, dont l’esprit de solidarité, dont témoignent de généreuses contributions au fonds de l’ICOM, ont aidé l’organisation à toucher nos membres moins biens dotés et, finalement, dont le soutien s’est révélé précieux pour le Secrétariat tout au long de ces 60 années.
J’encourage ICOM France à célébrer ces deux anniversaires en faisant une promotion active de notre code de déontologie auprès de ses membres, en multipliant ses activités, en poursuivant ses pratiques généreuses et, enfin, en nous aidant à identifier les besoins qui se font jour dans la communauté muséale.
John Zvereff
Secrétaire général de l’ICOM
Organiser une Assemblée générale du Comité national français en Allemagne, cette idée s’est imposée au nouveau Bureau exécutif de notre association. En Allemagne et plus particulièrement à Berlin, au Deutsches Historisches Museum, dont les expositions rendent visible notre histoire commune au travers des violences mais aussi des rapprochements qui ont marqué la période récente. En 2003, à l’occasion du 40e anniversaire du Traité de l’Elysée, le Haut Conseil culturel franco-allemand a encouragé les échanges entre les professionnels de musée et soutenu notamment les Rencontres de professionnels de musées de science qui se sont déroulées à Munich avant de nouveaux Dialogues franco-allemands organisés à Dijon et qui ont rassemblé de nombreux jeunes professionnels.
A Berlin, le thème de notre Assemblée générale était « musée et ville », un sujet trop vaste pour être traité dans toute sa complexité mais les communications que nous éditons dans ce numéro de la Lettre rendent bien compte de la diversité des approches : du musée de ville au musée dans la ville puis au « musée fabrique de ville », les intervenants français et allemands se sont attachés à des expériences sensibles que les visites proposées dans les musées à Berlin ont permis d’incarner. Le programme de l’île des musées en particulier a été présenté par le directeur général des musées de Berlin, Peter-Klaus Schuster. Les collègues qui nous ont accueillis au Musée Juif, à la Berlinische Galerie comme au Pergamon Musem ou dans les musées situés à Dahlem ont ouvert de nouvelles voies pour une coopération déjà engagée par des recherches ou des expositions conçues dans cet esprit de coopération culturelle qui a marqué cette Assemblée générale du Comité national français en Allemagne. L’écoute de la langue du partenaire était favorisée par une traduction simultanée des débats.
La présence à Berlin de la Directrice des musées de France, Francine Mariani-Ducray, a été vivement appréciée par les participants français et allemands. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser ces journées et notamment le Président d’ICOM Allemagne, York Langenstein, Johanna Westphal dont la parfaite maîtrise de notre langue a été un atout pour la réussite de cette manifestation, Hans-Martin Hinz, membre du Conseil exécutif de l’ICOM et Hans Ottomeyer, directeur général du Deutsches Historisches Museum. Rien n’aurait été possible également sans le concours actif de notre conseiller culturel à Berlin, Chantal Colleu-Dumond et je remercie plus particulièrement l’ambassadeur de France à Berlin, M. Claude Martin, qui a favorisé une rencontre chaleureuse entre tous les participants.
La densité des communications et le nombre de textes n’ont pas permis de reprendre dans cette Lettre les compte-rendus des conférences organisées par les comités internationaux durant cette année 2005. Ces comptes rendus paraîtront donc dans une prochaine édition.
L’année 2006 est une année-anniversaire pour notre organisation, l’ICOM, fondée en 1946, à Paris. John Zvereff, secrétaire général de l’ICOM, nous livre ici les principales réflexions qui marqueront ce 60e anniversaire mais aussi le 20e anniversaire du code de déontologie, véritable charte de notre organisation.
Jacques Perot, ancien Président de l’ICOM, a été désigné comme président d’honneur de la célébration du 60e anniversaire. Le Comité national français participera naturellement aux moments forts de cette année 2006 et notamment aux rencontres organisées pour notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en juin 2006 à Rennes. Je me réjouis de vous retrouver, nombreux, à l’occasion de ces futures journées qui témoigneront une fois encore de notre attachement à l’ICOM, lieu de rassemblement mais aussi d’innovation pour tous les professionnels de musées.
Cet attachement est tout d’abord celui que nous portons à nos collègues. Nous sommes nombreux à nous souvenir avec émotion de l’engagement de Viviane Huchard qui nous a quitté cette année et à laquelle M. Hubert Landais, ancien président et membre d’honneur de l’ICOM, rend dans cette Lettre un hommage auquel s’associe, avec une profonde sincérité, toute notre communauté.
Dominique Ferriot,
Présidente ICOM France

Lettre de l'Icom France n°31

Editorial
L'année 2006 a été riche en célébrations pour l'ICOM, ce Conseil international des musées fondé à Paris, au Musée du Louvre, en 1946. En 1986, au cours de la Conférence générale de Buenos Aires, était adopté le Code de déontologie professionnelle qui régit toujours l'activité des 22 000 professionnels qui adhèrent à notre organisation commune. Lieu de rassemblement, outil de référence, l'ICOM est aussi un lieu d'innovation qui ne cesse, depuis 60 ans, de renouveler la réflexion et les pratiques des professionnels de musée.
Le Comité national français dont la genèse a été retracé par Françoise Wasserman dans la Lettre numéro 20 est l'un des premiers comités de l'ICOM. Son ancienneté comme le nombre élevé de ses adhérents lui confèrent une responsabilité particulière et notamment celle de contribuer aux activités des autres comités nationaux plus jeunes mais non moins dynamiques. C'est ainsi que j'ai participé avec plaisir au séminaire organisé à Riga par le Comité national letton créé plus récemment. C'est aussi le sens de notre engagement dans le cadre de l'ICTOP et avec nos collègues des comités italien, autrichien, allemand, suisse pour la réalisation d'une cartographie des professions musicales. À l'occasion de la réunion à Paris du Comité Consultatif, nous avons pu faire découvrir à ses membres les dernières réalisations dans le musée et les recevoir, grâce au soutien de la Ville de Paris, dans le musée du Petit Palais, magnifiquement rénové. Rassemblement des différentes familles de musées, le Comité national français a aussi contribué au rapprochement entre la Journée internationale des musées de l'ICOM et la Nuit des musées, organisée par la Direction des musées de France, en facilitant la mise en place d'opérations nouvelles conduites dans différents pays européens.
En 2006 notre Assemblée Générale s'est tenue, dans ce nouvel équipement culturel baptisé Les Champs libres qui réunit le Musée de Bretagne, l'Espace des sciences et la Bibliothèque de Rennes. La Présidente de l'ICOM, Alissandra Cummins, a honoré de sa présence cette manifestation qui marque annuellement la vie de notre Association. Le maire de Rennes, président de Rennes Métropole, Edmond Hervé nous a chaleureusement accueilli au Champs libres et dans son Hôtel de Ville est a réaffirmé le sens de son engagement au service d'un meilleur partage des savoirs. Ce thème du musée et du partage des savoir était tout naturellement celui que nous avions choisi pour la table-ronde qui est suivi notre assemblée générale statutaire. Nous reprenons dans ce numéro de la Lettre les interventions faites dans ce cadre ainsi que la présentation des différentes composantes des Champs libres.
La « rentrée » et le mois de septembre ont vu l'arrivée d'un nouveau permanent ICOM France, Benjamin Granjon, qui remplace Terrière que le Conseil d'administration a vivement remercié pour la qualité de son engagement au service de notre comité.
Cette année 2006 a été aussi marquée par la disparition d'Hubert Landais, ressentie très douloureusement par l'ensemble de votre Comité. Ancien Directeur des musées de France, Président de l'ICOM, Hubert Landais était avec nous à Versailles pour la réception qui marquait la fin des travaux du Comité Consultatif et la célébration du 60e anniversaire de l'ICOM. Il nous disait comment, jeune conservateur, il avait été appelé dans son bureau par Georges Salles pour participer à la mise en place de notre Organisation au rayonnement de laquelle il a tant contribué. Pour lui rester fidèle, nous aurons à cœur, chacun à notre place, de contribuer à la poursuite d'une œuvre à laquelle il était si passionnément attaché. Dans cette grande famille des musées que représente l'ICOM, l'esprit de collégialité est en effet ce qui nous anime au quotidien pour mieux faire vivre nos collections et répondre aux attentes de publics toujours plus variés. Les idées généreuses énoncé par les fondateurs de l'ICOM définissent toujours le cadre de nos actions futures et de notre engagement commun. À un moment où le musée devient pour certains une simple « marque culturelle », il est urgent de réaffirmer cet idéal humaniste et cette conviction que le musée est une institution au service de la société et de son développement.
Dominique Ferriot
Présidente d'ICOM France

Lettre de l'Icom France n°32

Editorial
Malaise dans les musées, ce titre de l’ouvrage de Jean Clair récemment paru (Flammarion 2007) dit bien l’esprit d’une communauté qui voit les repères qui guidaient les pratiques professionnelles dans les musées progressivement remis en question sans être pour autant remplacés par de nouvelles normes. En matière de normes, l’ICOM a fait œuvre de pionniers en publiant dès 1986 un Code de déontologie qui reste une référence dans la plupart des pays du monde. La question de l’éventuelle cession des collections comme celle de la restitution des œuvres indûment captées aux pays sources sont exprimées de manière ouverte mais ferme rappelant en particulier que « Les collections des musées sont constituées pour la collectivité et ne doivent en aucun cas être considérées comme un actif financier ». (Code, 2.16)
La mission même du musée est aujourd’hui contestée par des économistes et des financiers dont les avis sont repris dans le Rapport sur l’économie de l’Immatériel remis ne novembre 2006 au ministre de l’Economie et des Finances de l’époque (Maurice Lévy, Jean-Pierre Jouyet, La Documentation française, novembre 2006). Ce Rapport énonce clairement que le musée est une « marque culturelle » dans une « portefeuilles d’actifs matériels et immatériels » qu’il convient de valoriser pour faire gagner un point de croissance à la « marque France ». Pour ce faire, la vente du nom, quand elle est possible, est vivement souhaitée (Le Louvre Abou Dhabi en est l’exemple emblématique) et la cession d’une partie des collections des musées considérée comme nécessaire et d’ailleurs déjà pratiquée dans un certain nombre de pays en Europe.
Lors du débat organisé par ICOM France le 15 juin 2007, à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine et dont nous publions ici les Actes (Culture, marché, où vont les musées ?), la Directrice des musées de France rappelait avec force que le principe d’inaliénabilité des collections publiques de France, inscrit dans la loi, ne saurait être remis en cause. Depuis, la lettre de mission du Président de la République à la ministre de la Culture lui demande « d’engager une réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d’aliéner des œuvres de leur collection, sans compromettre naturellement le patrimoine de la Nation, mais au contraire dans le souci de le valoriser au mieux ». La ministre de la Culture a confié une mission de réflexion à Jacques Rigaud qui remettra son rapport début 2008.
Ainsi tout est possible et les collections constituées en France pour lutte contre le « vandalisme » et être mise au service de la collectivité pourraient n’être plus que des monnaies d’échanges dans les opérations commerciales et diplomatiques aux finalités différentes. Certes l’Etat et les collectivités locales se défendent d’avoir de telles pensées et arguent du fait que les réserves dans les musées seraient surchargées voire mal gérées et que les collections des musées, en circulant davantage et en étant « mieux valorisées » serviraient mieux la cause du rapprochement entre des sociétés ou des cultures différentes, cette « diversité culturelle » promue par ailleurs parmi les causes nationales.
Les différentes associations des professionnels de musées en France ne sont pas convaincues par de tels arguments et proposent d’organiser des Assises qui permettront de clarifier les enjeux et de proposer des solutions définies en commun. Mais, comme à l’époque de la création de nos grands Musées nationaux, il y a urgence à réagir avant que des décisions hâtives ne mettent en péril un patrimoine créé et préservé depuis plus de deux siècles. ICOM France sera dans ce Débat un partenaire ouvert sur le monde mais ferme sur des principes qui sont au cœur de notre engagement pour les musées et leurs collections au service des publics d’aujourd’hui et de demain.
« Le monde des objets, qui est immense, est souvent plus révélateur de l’esprit lui-même ». Cette phrase de François Dagognet exprime notre responsabilité au service du patrimoine compris comme une mémoire féconde et un espace de création, un ferment actif qui repose sur un socle de valeurs et de connaissances dont le partage définit la culture. Les patients travaux des professionnels de musées portent ainsi une grande ambition tout en revendiquant au quotidien une leçon d’humilité et le souci de la durabilité de nos actions.
Dominique Ferriot,
Présidente ICOM France

