
Recherche
Résultats de la recherche
2103 résultats trouvés
Construire des solidarités entre musées à travers le monde

Retrouvez l'enregistrement de la séance portant sur la coopération entre les musées dans le monde
Quelle coopération a été mise en place entre les musées durant la pandémie tant au niveau national qu'international ?
Comment les musées se sont-ils connectés entre eux durant la crise sanitaire ?
Quelles leçons tirer de la gestion de cette crise ?
Comment préparer le réseau de l'ICOM en cas d'une nouvelle crise ? Comment renforcer le réseau pour le futur ?
Avec les témoignages de :
- Stéphane Chagnon, directeur général de la Société des musées du Québec
- Syrago Tsiara, directrice par intérim du MOMus - Musée d'art contemporain & Areti Leopoulous, conservatrice du MOMus - Musée d'art contemporain, Musée de la photographie de Thessalonique
- Michèle Rivet, C.M., vice-présidente, Conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne, membre des conseils d'administration, ICOM Canada et ICOFOM
- Tuuli Uusikukka, présidente de l'Association finlandaise pour l'éducation dans les musées Pedaali et conservatrice de l'éducation au musée finlandais du jouet Hevoenkenkä à Espoo
- Lior Zalmanson, responsable du forum numérique d'ICOM Israël, maître de conférences à l'université de Tel Aviv, spécialisé dans les processus de transformation numérique
Conclusion de la séance par Nava Kessler, présidente d'ICOM Israël
La séance a été modérée par Juliette Raoul-Duval, présidente d'ICOM France
Vidéo de la séance
Podcast in English
Grabación sonora en español
Le Cycle "Solidarités, musées : de quoi parle-t-on ?" est une initiative d'ICOM France en partenariat avec ICOM Finlande, ICOM Grèce, ICOM Israël et CIMUSET. Il a obtenu le soutien financier de l'ICOM international.
Nuit européenne des musées - 17ème édition
Rendez-vous le 3 juillet 2021 pour la 17ème Nuit européenne des musées
Cette date, correspondant au dernier week-end avant les vacances d'été, a notamment été retenue afin de permettre aux élèves participants à « La classe, l’œuvre ! » de présenter le travail effectué ces derniers mois.
Les inscriptions pour cette 17ème édition sont d’ores et déjà ouvertes ! Il vous est donc possible de saisir vos événements afin que ces derniers soient répertoriés sur le site de la Nuit européenne des musées.
La plateforme Open Agenda est votre outil privilégié pour inscrire l’ensemble de vos événements. Si vous avez déjà participé aux éditions précédentes, vos identifiants restent inchangés. En cas de perte de mot de passe, vous pouvez demander sa réinitialisation en suivant la procédure en ligne.
Pour les musées n’ayant jamais participé, il existe deux procédures d’inscription :
- Si votre musée est labellisé musée de France (MF), vous pouvez créer un compte sur Open agenda et vous inscrire directement.
- Si votre musée n’est pas labellisé MF, sa participation sera soumise à l’accord de la Direction régionale des affaires culturelles. Il faudra alors nous contacter par mail (nuitdesmusees.dgpat@culture.gouv.fr) en précisant le nom, la localisation et le statut de votre musée.

Recueillir les traces du COVID
Solidarités, musées : de quoi parle-t-on ?
Avec la Covid-19, certains mots ont pris du poids. Solidarité en est un.
Le confinement, les fermetures de musées, le travail à distance, la précarisation… suscitent des élans de générosité, des désirs d’échange, des espoirs de partage. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Est-ce durable ?
ICOM France propose chaque troisième mardi du mois une rencontre-discussion sur la plateforme Zoom de 13h à 14h30 autour du thème "Solidarité" pour vous permettre d'échanger et de transmettre vos expériences entre professionnels de musée.
Mardi 15 juin - séance 8
Recueillir les traces du Covid
Comment les musées témoigneront-ils de cette page d'histoire mondiale ?
Entre objets et idées, comment les musées ont-ils collecté les traces du Covid ?
Comment cette pandémie est-elle observée, vécue et racontée par les musées ?
La pandémie a-t-elle mis en lumière le rôle éducatif des musées face aux « fake news » ?
Quelle place accorder au digital et aux témoignages numériques ?
Quelles conséquences sur les collections des musées et leurs professionnels ?
Venez dialoguer et échanger avec :
- Foteini Aravani, conservatrice de la collection digitale du musée de Londres
- Emilie Girard, directrice scientifique et des collections du Mucem (Marseille)
- Elisabeth Ioannides, conservatrice au musée national d'art contemporain d'Athènes (EMST) & art-thérapeute
- Maria Ollila, conservatrice au musée national de Finlande (Helsinki) & secrétaire du réseau finlandais TAKO pour la collecte et la documentation contemporaine
- Corinne Thépaut-Cabasset, présidente d'ICOM Costume, Mode & Textiles
- Jacob Thorek Jensen, membre du conseil d'administration du CIMUSET & conservateur au musée national des sciences et de la technologie du Danemark (Elseneur)
Liens vers la séance
ID de réunion : 879 0629 6669
Code secret : 853196
La séance sera modérée par Estelle Guille des Buttes, conservateur en chef du patrimoine, trésorière adjointe à ICOM France.
Elle se tiendra simultanément en français, en anglais et en espagnol.

Le Cycle "Solidarités, musées : de quoi parle-t-on ?" est une initiative d'ICOM France en partenariat avec ICOM Finlande, ICOM Grèce, ICOM Israël et CIMUSET. Il a obtenu le soutien financier de l'ICOM international.
Recueillir les traces du COVID
Solidarités, musées : de quoi parle-t-on ?
Avec la Covid-19, certains mots ont pris du poids. Solidarité en est un.
Le confinement, les fermetures de musées, le travail à distance, la précarisation… suscitent des élans de générosité, des désirs d’échange, des espoirs de partage. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Est-ce durable ?
ICOM France propose chaque troisième mardi du mois une rencontre-discussion sur la plateforme Zoom de 13h à 14h30 autour du thème "Solidarité" pour vous permettre d'échanger et de transmettre vos expériences entre professionnels de musée.
Mardi 15 juin - séance 8
Recueillir les traces du Covid
Comment les musées témoigneront-ils de cette page d'histoire mondiale ?
Entre objets et idées, comment les musées ont-ils collecté les traces du Covid ?
Comment cette pandémie est-elle observée, vécue et racontée par les musées ?
La pandémie a-t-elle mis en lumière le rôle éducatif des musées face aux « fake news » ?
Quelle place accorder au digital et aux témoignages numériques ?
Quelles conséquences sur les collections des musées et leurs professionnels ?
Venez dialoguer et échanger avec :
- Foteini Aravani, conservatrice de la collection digitale au numérique du musée de Londres
- Emilie Girard, directrice scientifique et des collections du Mucem (Marseille)
- Elisabeth Ioannides, conservatrice éducative au musée national d'art contemporain d'Athènes (EMST) & art-thérapeute
- Maria Ollila, conservatrice au musée national de Finlande (Helsinki) & secrétaire du réseau finlandais TAKO pour la collecte et la documentation contemporaine
- Corinne Thépaut-Cabasset, présidente d'ICOM Costume, Mode & Textiles
- Jacob Thorek Jensen, membre du conseil d'administration du CIMUSET & conservateur au musée national des sciences et de la technologie du Danemark (Elseneur)
Liens vers la séance
ID de réunion : 879 0629 6669
Code secret : 853196
La séance sera modérée par Estelle Guille des Buttes, conservateur en chef du patrimoine, trésorière adjointe à ICOM France.
Elle se tiendra simultanément en français, en anglais et en espagnol.

Le Cycle "Solidarités, musées : de quoi parle-t-on ?" est une initiative d'ICOM France en partenariat avec ICOM Finlande, ICOM Grèce, ICOM Israël et CIMUSET. Il a obtenu le soutien financier de l'ICOM international
Des modèles à l’étude, une pédagogie par l’objet
Matinées des jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021 de 9h à 12H30
Dans le fil de l’exposition Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle, le musée des Arts et Métiers propose une journée d’étude reprenant et approfondissant les thèmes de l’exposition : la pédagogie genlisienne, les modèles réduits et leur fonction d’apprentissage.
La première matinée sera consacrée à la figure de Félicité de Genlis (1746-1830) : sa longue carrière littéraire ainsi que la place occupée par le théâtre, les journaux d’éducation et les voyages dans son programme pédagogique. La seconde matinée donnera l’occasion d’éclairer l’usage du modèle d’instruction en examinant ceux conservés au musée de l’Armée et au musée de la Marine. Ce sera également le temps d’évoquer plus précisément l’originalité de ces représentations d’ateliers dans la typologie complexe des modèles du musée des Arts et Métiers, ainsi qu’une nouvelle proposition d’attribution.
Les interventions se termineront par une présentation de la récente campagne de restauration menée dans le cadre de l’exposition Top Modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle qui a permis de redécouvrir les interventions successives sur ces objets, restées peu documentées.
En ligne sur Zoom et sur inscription.
Le lien de connexion vous sera envoyé avant l’événement.
Nouveau logo pour ICOM Costume
Le comité international ICOM Costume a un nouveau logo
En 2021 le comité international ICOM Costume, créé en 1962 par François Boucher, devient : le Comité international de l’ICOM pour les musées et collections de Costume, Mode et Textile
Alberto Garlandini, Président de l’ICOM, était heureux d’annoncer lors de la 153ème session du 22 février 2021 que le comité exécutif de l’ICOM avait approuvé le changement du nom du comité international ICOM Costume dans les trois langues officielles de l’ICOM, selon le règlement intérieur (art. 7.3) et les règles du comité international comme suit :
• in English: ICOM International Committee for Museums and Collections of Costume, Fashion and Textiles;
• en français: Comité international de l’ICOM pour les musées et collections de costume, mode et textile;
• en español: Comité internacional del ICOM para Museos y Colecciones de Indumentaria, Moda y Textil.

Multaka : Musées, point de rencontres
NEMO est heureux de partager un appel à participants pour la formation "Multaka : Musées, point de rencontres", qui aura lieu en ligne de 10h00 à 12h00 (heure de Paris) les 8, 17 et 23 juin 2021.
La formation en ligne sera animée par Sarah Fortmann-Hijazi et Salma Jreige, l'équipe de gestion du projet, les membres de l'équipe du projet Multaka Berlin ainsi que les partenaires du réseau international Multaka. Cette formation est conçue comme une introduction au concept d'initiatives de sensibilisation nationales et internationales dans les musées en utilisant l'exemple de Multaka.
L'initiative Multaka vise à faciliter l'échange d'expériences culturelles et historiques diverses et à construire des ponts culturels. Multaka (qui signifie "point de rencontre" en arabe) a pour but de favoriser une participation culturelle active en diversifiant les structures des musées et en s'adressant à des communautés non représentées, ainsi que de soutenir l'échange et le déplacement de diverses perspectives.
Dossier de candidature :
Déposez votre candidature avant le jeudi 3 juin 2021en envoyant les documents suivants :
- Votre CV
- 1 paragraphe motivant votre participation et vos attentes, avec une déclaration de votre adhésion à NEMO ou de votre sponsor membre de NEMO.

Recherche et musées

Les liens entre recherche et musées sont complexes. Avec la pandémie, de nouvelles questions ont été soulevées. Pourquoi et comment le musée s'est-il posé comme garant du savoir et du "vrai" ? Qu'est ce que la recherche pour un musée ? Comment s'organisent les relations de travail entre chercheurs et (autres) professionnels de musée ? Qui fait quoi et comment les uns et les autres articulent-ils leurs travaux ?
La rencontre visait à mettre en évidence la place de l'esprit scientifique dans la pratique et dans la formation aux métiers des musées. ICOM France avait pour cela réuni un panel d'intervenants aux profils variés allant du chercheur au professionnel des musées.
Retrouvez les interventions d'Eric de Chassey, Christian Hottin, Roland May, Pascal Liévaux, Steph Scholten, Ariane James-Sarazin, Francis Duranthon, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, André Delpuech.
La rencontre a été modérée par Juliette Raoul-Duval, Hélène Vassal et Laurence Isnard et s'est conclue avec une synthèse de Christian Hottin.
Retrouvez ci-dessous les actes de la soirée.
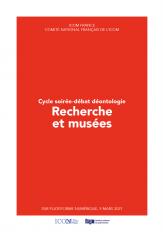
Les relations entre narration, art et histoire de l’art
La revue Perspective : actualité en histoire de l'art consacrera son n° 2022 – 2 à la question des relations entre narration, art et histoire de l’art.
Qu’il s’agisse des récits sur lesquels se fondent les images et les objets d’art, de ceux que (se) constituent ses regardeurs, ou des « mises en récits » opérées par les historiens et les historiennes de l’art, ce numéro entend s’emparer de l’acte de raconter comme d’un outil heuristique aussi fécond que déstabilisant. L’image et l’objet d’art racontent, même en l’absence de contenu diégétique figuré, ne serait-ce qu’en tant que témoins d’une époque ou de pratiques – ne serait-ce qu’en tant que vecteurs de narrativité.
Enracinée dans les travaux de Giorgio Vasari et de Karel van Mander, l’histoire de l’art est, depuis l’Antiquité, fondée sur un exercice narratif, de l’ekphrasis aux grands récits de l’autonomie moderniste, en passant par l’anecdote ou la légende biographique. La manière dont les historiens et les historiennes de l’art ont façonné leur discipline, s’extrayant d’une pratique littéraire, volontiers mythique, pour embrasser, forger et discuter peu à peu des méthodes « scientifiques », témoigne d’un rapport complexe au récit, à la narration – à la fiction en quelque sorte.
Que l’image et la mise en récit marchent main dans la main, nul ne le contestera : l’antériorité de l’une sur l’autre, en revanche, est à jamais objet de débats, de même que les phénomènes de relais ou d’enchâssement dont elles semblent procéder, du paragone au discours moderniste ne cessant de raconter la fin des œuvres qui racontent. Ces séries d’oppositions et ces phénomènes complexes de transmission pourront être abordés sous différents angles, pourvu que la réflexion soit toujours ancrée dans une perspective historiographique – des processus de narration à l’œuvre dans la création et la réception en art, des origines à nos jours, des expressions symboliques paléolithiques au cinéma.
Dossier de candidature :
Les propositions devront s’inscrire dans la ligne éditoriale de la revue : sans jamais se limiter à de simples études de cas, les contributions veilleront à développer une réflexion sur la manière dont l’histoire de l’art, l’histoire du patrimoine et l’archéologie se saisissent des relations entre narration, art et histoire de l'art pour penser leurs méthodes et leurs cadres scientifiques.
Le dossier devra comprendre :
- un résumé de 2 000 à 3 000 signes, avec un titre provisoire
- une bibliographie succincte sur le sujet
- une biographie de 2 ou 3 lignes
Prière de faire parvenir vos propositions à l’adresse de la rédaction avant le 1er juillet 2021. Les auteurs des articles retenus seront informés de la décision du comité à la fin du mois de juillet 2021, tandis que les articles seront à remettre le 15 décembre 2021. Les articles soumis seront définitivement acceptés à l’issue d’un processus anonyme d’évaluation par les pairs.
Humanités numériques
Le nouveau numéro de la revue Histoire de l'art propose un tour d'horizon de ce que recouvre le champs des humanités numériques en histoire de l'art.
Les humanités numériques ouvrent des champs nouveaux d’étude et de recherche. Loin d’être seulement des outils pour constituer des ressources en histoire de l’art, elles jouent un rôle de plus en plus important dans la conception de la discipline et son développement. Elles transforment les oeuvres, leurs reproductions et les textes à leur sujet non pas en objets ni en représentations, mais en données, qui peuvent s’insérer dans des séries temporelles, matérielles, visuelles et spatiales.
L’approche numérique est une pratique intellectuelle amenée à changer en profondeur la discipline, dans l’étude de ses objets, la constitution, l’exploitation et la transmission de savoirs, mais aussi dans l’interaction entre oeuvres, public et chercheurs, et entre institutions culturelles et recherche. Ce numéro met en lumière les nouveaux discours et questions que les humanités numériques permettent de faire émerger, incitant à penser autrement la pratique de l’histoire de l’art et sa diffusion. Il associe chercheurs confirmés, qui se sont prêtés à des débats croisés, et jeunes chercheurs.
Numéro coordonné par : Olivier Bonfait (université de Bourgogne, LIR3S, CNRS), Antoine Courtin (Institut national d’histoire de l’art / université Paris-Nanterre) et Anne Klammt (Centre allemand d’histoire de l’art)
Avec les contributions de : Mathieu Aubry Peter Bell Mathias Blanc, Damien Bril, Victor Claass, Céline Chanas, Emmanuel Château-Dutier Gwendoline Corthier-Hardoin, Lisandra Costiner, Emmanuelle Delmas-Glass, Isabella Di Lenardo, Aline Guillermet, Anne Helmreich, Charles van den Heuvel, Leonardo Imeptt, Stuart James, Paul B. Jaskot, Béatrice Joyeux-Prunel, Maximilian Kaiser, Frédéric Kaplan, Harald Klinke, Hubertus Kohle, Matthew Lincoln, Hubert Locher, Sigrid Mirabaud, Jean-Claude Moissinac, Anne-Myrtille Renoux, Anne Ritz-Guilbert, Régis Robineau, Nuria Rodriguez-Ortega, Léa Saint-Raymond, Alexandra Stoleru, Marenka Thompson-Odlum, Perrine Val, Élise Vanriest et Piyush Wadhera
Rédactrice en chef : Dominique de Font-Reaulx
Revue semestrielle éditée par l’Apahau et distribuée par Pollen-Difpop.
ISBN : 978-2-909196-33-6 | ISSN : 0992-2059 | 216 p., 82 fig., 17 × 24 cm | 25 €.
En vente en librairies, en ligne et sur abonnement.



