
Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Montrer & interpréter la vigne et le vin
|
Le chantier cathédral en Europe
Le chantier cathédral en Europe
Diffusion et sauvegarde des savoirs, savoir-faire et matériaux du Moyen Âge à nos jours
Après l’inclusion des savoir-faire de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel en France (2017), la reconnaissance de la démarche de sauvegarde des savoirs, des compétences techniques et des pratiques sociales des ateliers de cathédrales a progressivement fédéré les ateliers de cinq pays européens (Allemagne, Autriche, France, Norvège, Suisse). En mars 2019, ils ont déposé auprès de l’UNESCO, pour le Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, une candidature commune : « Les techniques artisanales et les pratiques coutumières des ateliers de cathédrales, ou Bauhütten, en Europe : savoir-faire, transmission, développement des savoirs, innovation ». Ces dix-huit ateliers se consacrent tous à la réservation de cathédrales et de grands édifices, ainsi qu’à la recherche, à la documentation et à la transmission des savoirs associés. Comme d’autres en Europe, ils forment un réseau transfrontalier et vivant au sein de la plus large association européenne d’architectes et le responsables d’ateliers de cathédrales, le Dombaumeister e.V., fondé en 1988, qui promeut la transmission du travail en atelier et les pratiques qui y sont mises en œuvre. Ces ateliers abritent une communauté de travail, mais aussi une communauté vivante avec ses rituels, ses fêtes et des formes de communication bien établies. Ils conservent les traditions coutumières des ouvriers du bâtiment, ainsi qu’une mine de connaissances intellectuelles et techniques, transmises à la fois oralement, d’artisan à artisan, par l’imitation et l’observation, et par écrit, grâce à de nombreuses archives en particulier.
L’existence de ces chantiers permanents autour des cathédrales a préservé des techniques artisanales, un savoir traditionnel ou nouvellement acquis et des coutumes liées à la construction et à la préservation d’édifices nécessitant un entretien constant. Elle a aussi créé les conditions d’une transmission des techniques, des formes et des thèmes et d’une circulation et d’une émulation des savoirs à grande échelle. Ces deux dernières décennies, les avancées de la recherche en histoire de l’architecture et en histoire et anthropologie des techniques ont fait sensiblement progresser les connaissances sur l’institution des chantiers de cathédrales, sur le fonctionnement des métiers en leur sein et sur la circulation des savoirs et des hommes d’un chantier à l’autre. Les travaux ont cherché aussi à expliciter les causes et les conséquences, au plan politique, culturel, économique, mais aussi administratif et statutaire, de ces transferts techniques et artistiques sur la production architecturale, puis sur l’histoire de la restauration monumentale, à l'échelle européenne. Pour autant, il n’en a été proposé que peu de synthèses à l’échelle européenne, surtout sur le temps long, y compris jusqu’à nos jours, pour en faire émerger les constances et les ruptures, les points de convergence et les spécificités, et ainsi mieux qualifier le contexte d’élaboration de la culture architecturale et technique autour des cathédrales européennes, replacées dans leur contexte.
Les contributeurs de ce colloque européen étudieront durant ces trois jours la spécificité du fonctionnement des chantiers et des métiers impliqués dans la construction des cathédrales hier et dans leur restauration aujourd’hui ; ils mettront en valeur les sources, écrites ou figurées, autorisant la recherche en ces domaines et la façon dont elles ont été exploitées ces toutes dernières décennies ; enfin, ils questionneront les phénomènes de circulation et d’échanges des savoirs et des compétences que l’on connaît depuis le Moyen Âge autour des chantiers des cathédrales et ces pratiques de conservation inscrites dans un processus de transfert durable des connaissances.
COORDINATION
Le colloque est organisé par :
- le département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture (Isabelle Chave)
- le Centre André-Chastel (Dany Sandron)
- le labex « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » (Étienne Faisant)
avec le soutien de :
- l’Institut national du Patrimoine
- l’Observatoire des patrimoines de Sorbonne Université
- l’Office allemand d’échanges universitaires — Deutscher Akademischer Austauschdienst
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Christophe AMSLER, architecte du patrimoine, Lausanne
Flaminia BARDATI, Université La Sapienza, Rome
Dr. Sabine BENGEL, Fondation de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg
Philippe BERNARDI, CNRS
Isabelle CHAVE, ministère de la Culture / direction générale des Patrimoines
Étienne FAISANT, Sorbonne Université / Centre André-Chastel / labEx EHNE
Prof. Christian FREIGANG, Freie Universität, Berlin
Étienne HAMON, Université de Lille
Pascal LIÉVAUX, ministère de la Culture / direction générale des Patrimoines
Mathieu LOURS, Université de Cergy-Pontoise
Caroline PIEL, ministère de la Culture / Inspection générale des patrimoines
Dany SANDRON, Sorbonne Université / Centre André-Chastel / labEx EHNE
Dr. Barbara SCHOCK-WERNER, Zentral Dombau-Verein zu Köln / Dombaumeister e. V.
Prof. Dr. Eva-Maria SENG, Université de Paderborn
Roger SOMÉ, Université de Strasbourg
Dipl.-Ing. Wolfgang ZEHETNER, Dombauhütte St. Stephan, Wien / Dombaumeister e.V.
Les musées universitaires et leurs publics
Les musées universitaires connaissent, depuis le début du XXIe siècle, un véritable regain d’intérêt : fondation d’un réseau européen UNIVERSEUM (2000) et du Comité international pour les musées et collections universitaires (UMAC) au sein de l’ICOM (2001), rénovation de l’Ashmolean Museum à Oxford (2009) reconnu comme premier musée universitaire (1683), création de nouvelles réserves accessibles et rénovation du Conservatoire national des arts et métiers à Paris (2000). Ces quelques initiatives semblent incarner la volonté des acteurs universitaires de donner un nouveau sens à leurs structures muséales mais aussi le besoin d’une reconnaissance officielle par la communauté internationale des professionnels des musées ; alors que le grand public semble se sentir moins concerné.
Aujourd’hui, l’Embarcadère du Savoir s’associe au Séminaire de Muséologie de l’Université de Liège pour l’organisation d’un colloque relatif aux publics des musées universitaires qui aura lieu du 5 au 7 novembre 2019. Ce colloque bénéficiera du soutien de l’UMAC.
Pourquoi se pencher sur les publics ?
Les musées universitaires actuels sont fréquentés par un public encore trop restreint (limité aux chercheurs/étudiants/professeurs, quelques familles ou amateurs avisés). Cela nous incite donc à évaluer, à l’occasion du colloque, les raisons de cette conjoncture et à questionner les pratiques contemporaines de nos institutions universitaires : discours élitiste ? scénographie poussiéreuse ? inadaptation des modes de communication vers les publics ? vitrine de l’université ? collections trop méconnues et hétérogènes ? Ainsi, ce colloque a pour objectif d’inviter les autorités universitaires et les gestionnaires de collections à mener une réflexion globale sur leur politique d’accueil des publics.
Au programme de ce colloque sur « Les musées universitaires et leurs publics », sept problématiques seront envisagées et ce, à partir de plusieurs questionnements relatifs :
- Pourquoi le public ne se rend pas au musée universitaire ?
- Quels modes de communication pour le public des musées universitaires ?
- Le musée universitaire peut-il être un lieu de démonstration de la recherche académique ?
- Marketing du musée universitaire : représente-t-il une vitrine potentielle de l’Université ?
- Quelle expographie pour le musée universitaire ?
- Comment assurer une inclusion sociale et culturelle au musée universitaire ?
- Musées universitaires et étudiants/chercheurs : quelle place pour un lieu de formation ?
Musées et droits culturels

ICOM France, le Musée de Bretagne et Les Champs Libres ont organisé une journée d'étude à Rennes le vendredi 8 février 2019 consacrée à l'étude des droits culturels et leur application dans les musées.
Cette journée a réuni des experts de la notion "droits culturels" (Patrice Meyer-Bisch, Gabi Dolff-Bonekämper, Léna Boisard Le Coat), des professionnels de musées français (Céline Chanas, Candice Runderkamp, Mathilde Schneider, Kelig Yann Cotto) et des acteurs du champ muséal international (Johannes Beltz, Isabelle Anatole-Gabriel).
Retrouvez l’intégralité de cette rencontre en vidéos : captation
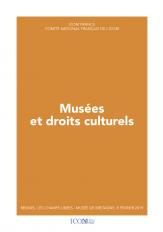
Le traitement des biens de collections issus de contextes coloniaux

La présente publication est une deuxième version, la première étant parue en mai 2018. Cette édition remaniée prend en compte la perspective internationale, qui a fait l’objet d’un atelier en octobre 2018.
Ce guide est un outil pratique pour l'ensemble des personnes travaillant en lien avec des musées (c'est-à-dire dans un musée, pour un musée ou avec un musée). Il prend sa source dans les besoins, les expériences professionnelles et les questionnements des musées allemands. Il a été élaboré dans le but d’informer les responsables au sein des musées sur la thématique complexe du colonialisme et des collections afférentes, de les y sensibiliser et de leur fournir des recommandations concrètes pour leur travail.

Les collections patrimoniales ont-elles un avenir ?
Depuis le dix-huitième siècle ont été amassées, inventoriées, étudiées et cataloguées d’innombrables collections patrimoniales. Soigneusement stockées et conservées, et en partie exposées au public par des monuments, des archives, des bibliothèques et surtout des musées, elles représentent un fardeau envahissant et d’autant plus coûteux que, depuis une cinquantaine d’années, la patrimonialisation n’a cessé d’élargir son domaine d’action.
En France où elles sont, pour une grande partie d'entre elles dit la loi, inaliénables et imprescriptibles, et partout ailleurs dans le monde, quelle est donc leur utilité au moment où, du moins en apparence, seules les grandes expositions temporaires, réalisées à grand frais pour de courtes périodes, sont susceptibles d’attirer un public nombreux ? Les collections, notamment celles que les musées par principe (selon la définition jusqu'il y a peu consensuelle, diffusée par l’Icom) sont obligés de détenir, représentent-elles encore pour ces derniers un avantage déterminant ?Dialectiquement, et même si cette proposition semblera à certains sacrilège, ne faut-il pas envisager de se défaire des collections ? Ou, comme on le fait dans une bibliothèque, de les « désherber » périodiquement en mettant au pilon des pans entiers de collections, des séries, ou de multiples exemplaires identiques devenus encombrants, démodés ou inutiles ? Les musées doivent-ils accepter sans discussion les legs des collectionneurs ou les collections des différents musées qui décident de fermer ?
Les collections sont au cœur des politiques patrimoniales et muséales. Mais on n’en parle qu’assez peu. Il aura fallu que la loi impose aux établissements labellisés « Musées de France » la production d’un projet scientifique et culturel (ou son renouvellement) puisque le volet scientifique concerne surtout la gestion des collections, pour que les responsables des musées soient contraints de retravailler cette ardente obligation. Les chercheurs contemporains en muséologie, dès la période où ils se sont davantage centrés sur les publics et les médiations, ont cessé de s’intéresser aux collections : elles demeurent en arrière plan de la réflexion muséologique comme une sorte d’impensé ou de non-dit. Certes, les musées ont des collections, mais ce ne sont plus elles qui constituent le levier de leur réputation internationale et le fer de lance de leur politique culturelle en direction des publics. Il faut cependant remarquer que l’univers des collections, sur le plan professionnel, a vécu deux petites révolutions. Il a d’abord été décidé qu’il était indispensable au XXIe siècle qu’elles soient numérisées afin que leurs listes - et les fichiers correspondants - soient mises en ligne ou versées dans des bases de données générales ou spécialisées. Et par ailleurs, à l’occasion de déménagements ou de rénovations, on a décidé de les transférer en sécurité dans des réserves le plus souvent aménagées dans de nouveaux bâtiments, dans l’idéal visitables. C’est, entre autres, le cas du CNAM ou du MUCEM, mais aussi du Museon Arlaten et son CERCO, de Confluences, du Schaudepot du Campus Vitra, et bientôt du Louvre. De facto, la numérisation des collections et la transformation des caves et greniers en réserves dûment climatisées sont les deux seules innovations qui ont traversé le monde clos et opaque des collections patrimoniales.
Pourtant, on observe un certain frémissement dans la vie et surtout la politique scientifique et culturelle des grandes institutions patrimoniales. C’est le cas notamment du musée du Louvre qui a délibérément réorienté sa politique d’expositions temporaires en privilégiant la mise en valeur de ses propres collections. Mais d’autres tendances viennent secouer ou malmener le monde des collections patrimoniales. Faut-il conserver tous les vestiges archéologiques mis au jour lors de fouilles dites de sauvetage qui se sont multipliées ? Comment intégrer dans les réserves les objets qui n’ont pas de matérialité ou de présence physique telles les performances de l’art contemporain ou les résultats de collectes de témoignages oraux conduites par les musées des sciences et des techniques ou ceux d’ethnologie ? Faut-il choisir, et si oui au nom de quelle politique, entre les collections nobles et dignes et celles qui, parce qu’elles sont sales, dangereuses, honteuses et indignes, ne le mériteraient pas ?
Suite de l'appel à proposition
Envoi des résumés
Merci d’adresser vos propositions d’articles sous la forme de résumés (5000 à 7000 signes) par courriel avant le 16 décembre 2019 à : Daniel Jacobi (danieljacobi[a]orange.fr), avec copie à culture-et-musees[a]univ-avignon.fr et Marie-Christine Bordeaux (marie-christine.bordeaux[a]univ-grenoble-alpes.fr).
Les résumés comporteront :
- un titre,
- 5 références bibliographiques mobilisées dans le projet d’article,
- les noms, adresse électronique, qualité et rattachement institutionnel (université, laboratoire) de leur auteur.e., ainsi que des références bibliographiques pour chaque auteur.e (5 environ par personne) Ils détailleront :
- l’ancrage disciplinaire ou interdisciplinaire de la recherche,
- la problématique,
- le terrain ou le corpus,
- la méthodologie employée
- le cas échéant, une première projection sur les résultats
Calendrier
- Octobre 2019 : diffusion de l’appel à propositions d’articles : 16 décembre 2019 : réception des propositions (résumés) Mi- janvier 2020 : réponses aux propositions (résumés) Mi-avril 2020 : réception des textes complets Mai-juin 2020 : expertise en double aveugle Début septembre 2020 : réponses définitives aux auteur.e.s et propositions éventuelles de modifications Novembre 2020 : réception des versions définitives Novembre-décembre 2020 : début du processus éditorial Juin 2021 : publication
Contact
Daniel Jacobi
danieljacobi[a]orange.fr
Avignon Université
74 rue Pasteur
84029 Avignon
Tourisme de masse, tourisme international, de nouveaux défis pour les musées
Cette journée professionnelle est le second temps que l’association consacre au Tourisme après celui organisé à Bordeaux le 8 février 2019 ayant pour thème : Musée et tourisme, une cause commune ? Elle s’adresse aux professionnels des musées et du tourisme, aux universitaires, étudiants et toute personne intéressée par le sujet.
Coordination : Christophe VITAL, conservateur en chef honoraire, administrateur de l’AGCCPF
Entrée gratuite, nombre de places limitées, inscriptions auprès d’Adrien Foucquier, agccpf[a]yahoo.com
Le musée en scène : regards critiques sur la muséographie 1969-2019
Depuis une cinquantaine d’années, la présentation des collections muséales est devenue une question centrale tant au niveau pratique que théorique, aussi bien dans le cadre muséal qu’universitaire. Plusieurs musées ont promu des muséographies expérimentales ou proposé la restitution plus ou moins fidèle d’anciens dispositifs d’exposition temporaire. Toutes ces reconstructions ont recueilli un grand succès public.
Plusieurs projets de recherche examinent les enjeux précis des dispositifs anciens dans l’histoire de la contemplation muséale, ou proposent une histoire des paradigmes qui ont présidé au développement de la muséographie au cours de l’histoire. Les débats des années 1970 entre muséologie « officielle » et muséologie contestataire se sont également ouverts à la dimension sociale des sciences humaines, avec la sociologie, la sémiologie et le courant des Visual Studies ; de nos jours cette ouverture englobe également les témoignages issus des neurosciences ainsi que les expériences virtuelles.
Le musée du Louvre, quant à lui, n’a cessé de produire des événements sur le sujet pour accompagner ses grands travaux depuis l’ouverture de la pyramide en 1989. En France, depuis lors, le ministère de la Culture a promu une architecture muséale ambitieuse, qui ne se réduit plus à un simple équipement, mais qui est propre à mettre en scène le rapport entre l’art et le grand public. Ces changements institutionnels ont favorisé le rôle croissant de l’architecte et/ou du scénographe dans l’élaboration d’un dispositif muséographique.
Aujourd’hui, un bilan s’impose, pour prendre la mesure des grandes transformations intervenues durant les cinquante dernières années dans ce domaine, et pour réfléchir aux perspectives nouvelles qui se dessinent au XXIe siècle.
Tel est le projet de ce colloque international, organisé par l’École du Louvre et le musée du Louvre (Centre Vivant Denon), les 23 et 24 avril 2020, pour débattre des enjeux muséographiques soulevés par l’exposition de l’objet de musée, en veillant à diversifier les spécialités et les continents (musées d’archéologie, d’art ancien, d’art moderne, des arts extra-européens, de civilisation, d’histoire naturelle…), sans oublier l’art contemporain qui a radicalement transformé la nature de la muséographie et nous engage à analyser comment la création artistique la plus récente a induit de nouveaux modes d’« expographie », comment elle a modifié jusqu’à notre rapport à l’objet et notre expérience de la visite au musée.
Télécharger l’appel à communication :
en français
en anglais
Date limite de dépôt des propositions de communications :
Les propositions de communications (400 mots maximum) en anglais ou en français peuvent être adressées à :
cecilia.hurley-griener[a]ecoledulouvre.fr
ou
colloques[a]ecoledulouvre.fr
avant le 16 décembre 2019
Les frais de voyage et d’hôtel seront à la charge des organisateurs.
Comité d’organisation :
Cécilia Hurley Griener,
HDR, responsable du pôle patrimonial, Université de Neuchâtel
professeure, Université de Neuchâtel, École du Louvre
membre de l’Équipe de recherche, École du Louvre
Françoise Mardrus,
cheffe de service, Centre Dominique-Vivant Denon, Direction de la recherche et des collections, musée du Louvre professeure, École du Louvre
Comité scientifique :
Bruce Altshuler,
directeur du programme en études muséales, New York University
Laurence Bertrand-Dorléac,
professeure d’histoire de l’art, Sciences-Po Paris, École du Louvre
Blandine Chavanne,
conservatrice générale du patrimoine honoraire, professeure, École du Louvre
Octave Debary,
professeur, Université Paris Descartes
Cécile Debray,
conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée de l’Orangerie
Cécile Degos,
scénographe
Philippe Durey,
conservateur général du patrimoine honoraire, ancien directeur de l’École du Louvre
Dominique de Font-Réaulx,
conservatrice générale du patrimoine, directrice de la médiation et de la programmation culturelle, musée du Louvre
Jérôme Glicenstein,
professeur, Université de Paris 8
Thierry Leviez,
directeur scénographie, École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris
François Mairesse,
professeur, Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, École du Louvre
Néguine Mathieux,
conservatrice du patrimoine, directrice de la recherche et des collections, musée du Louvre
Marielle Pic,
conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des antiquités orientales, musée du Louvre
Rebondir après le drame : patrimoines et résilience
Le Comité français du Bouclier Bleu organise un colloque sur le thème "Rebondir après le drame : patrimoines et résilience" le jeudi 19 décembre 2019 à l’amphithéâtre Colbert de l’INP.
Après un sinistre, un conflit armé ou une catastrophe naturelle, comment surmonter la crise et retrouver un équilibre, une forme de normalité ? Le patrimoine culturel est-il « simplement » un enjeu, n’est-il pas aussi un facteur de résilience ? Ce colloque, après avoir défini la notion de résilience, illustrera, par des exemples pris dans le monde puis sur le territoire national, quelques propositions ayant permis à des populations ou des établissements culturels de rebondir après le drame. Où l’on voit que l’anticipation et la culture du risque sont des clés pour la construction d’un patrimoine résilient.
Les Journées RéMuT 2019
Depuis décembre 2009, 430 musées ont adhéré à RéMuT, répartis sur l’ensemble du territoire. La diversité des thématiques, des statuts et dimension des collections et des institutions représentées reflète la richesse de notre patrimoine technique. Richesse que RéMuT a pour mission de faire connaître et reconnaître auprès de tous les publics. De concert, RéMuT représente un lieu d’expression et de mutualisation, qui nous permet de confronter nos expériences, de tisser des liens et de favoriser des rapprochements, pour construire une structure qui apporte du soutien et du conseil professionnel, qui suscite et favorise la mutualisation de moyens et le développement de partenariats.
L’un des moments forts de ce réseau est sa journée annuelle de rencontre : la Journée RéMuT est le rendez-vous essentiel pour l’animation et le développement du réseau. Temps de partage des idées, des pratiques et de nos expériences multiples, il nous permet de réfléchir aux problématiques de nos musées, d’éclairer nos pratiques respectives pour organiser et construire ensemble des solutions. À l’anniversaire des 10 ans de RéMuT, la Journée nationale devient le moment privilégié pour définir et décider ensemble la feuille de route du réseau et ses actions stratégiques : la participation du plus grand nombre est particulièrement importante.
Nous vous proposons donc une rencontre riche en discussions, formelles et moins formelles, ateliers, conférence et table ronde, ainsi bien sûr que notre réunion plénière le mardi 3 décembre matin.
Les Ateliers sont animés par des membres de RéMuT et des structures partenaires, et sont organisés sur deux durées : 2h00 et 3h30. Faites vos choix !
