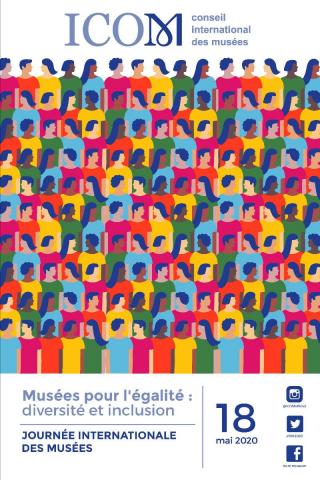Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
Le sens de l'objet
« OBJETS INANIMÉS,
AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME
QUI S’ATTACHE À NOTRE ÂME
ET LA FORCE D’AIMER ? »
Alphonse de Lamartine
Dans la définition du dictionnaire, l’objet est « toute chose concrète, perceptible par la vue et le toucher ».
Pour des professionnels de musée, le mot d’objet revêt un sens singulier : il désigne de manière générale ce que le musée conserve, qu’il s’agisse d’une institution muséale de beaux-arts, d’histoire, d’histoire naturelle, de sciences et techniques, d’art contemporain, etc. On peut parler d’objets virtuels, objet et abstraction ne s’opposent pas.
Pourtant, le vif débat de cet été lors de la conférence générale de l’ICOM à Kyoto sur la « nouvelle définition des musées » a semé le doute : d’objets, il n’était pas question, ni de collections ou d’œuvres, ou seulement en arrière-plan d’un « lieu polyphonique et inclusif » que devrait être pour certains le musée de demain. La position des professionnels français a été consensuelle pour échapper à cette banalisation.
Quatre mois plus tard, la sixième soirée-débat organisée avec l’INP, sur le « sens de l’objet », vise à revenir au cœur des métiers et de la matière des musées.
- L’objet a-t-il un sens en lui-même ? « Le musée est un dictionnaire dans lequel les objets sont les mots […]. Non-inscrits dans un propos, dans un discours, ils perdent leur sens »1.
C’est précisément le travail des professionnels de musée de donner un sens, un langage, une interprétation à l’objet qu’ils conservent ; l’objet est un témoin préservé pour transmettre la mémoire des arts, des sciences, des sociétés. Le conserver est la mission première. S’il est blessé, par le temps ou les guerres, perd-il son sens ou en prend-il un autre ? Les cicatrices font partie du témoignage dont il est porteur. À quelles conditions – traçabilité, réversibilité… – restaure-t-on le sens de l’objet ? C’est le cœur des missions de l’INP.
- Sous l’angle de la déontologie, on peut parler d’objet de connaissance, dont il faut rendre le récit le plus juste possible. Garante de l’authenticité, c’est la part du travail scientifique des musées. On l’a vu au cours d’un autre débat vif de l’année 2019, sur les « restitutions » : la recherche sur les collections et leur provenance est ardue, jamais achevée et n’épuise pas les questions du « sens de l’objet » : œuvres d’art porteuses de valeurs esthétiques ici, objets rituels porteurs de valeurs spirituelles pour leurs créateurs
- Le sens de l’objet est-il séparable de son contexte ? Pierre Soulages dit cela : « la peinture c’est une chose, mais ce qui importe c’est l’art et ce qui, dans un objet, nous transporte dans des zones de ce que nous sommes et que nous ne connaissons peut-être pas »2.
- Le sens de l’objet est-il « durable » ? Pour la directrice du Louvre-Lens, le sens et l'interprétation d'une œuvre d'art « ne sont pas définis une fois pour toute par l'artiste ni son époque, mais ils sont enrichis par chaque regard, chaque visiteur »3.
Se peut-il aussi qu’ils soient enrichis par les technologies, numériques, 3D, IA… ? Que l’objet répliqué, reproduit, numérisé, partagé, « démocratisé », comme on le lirait dans le rapport Musée du XXIe siècle, porte en lui-même un sens ?
Dans plusieurs musées, les publics sont invités à choisir - parfois dans les réserves - les objets qui vont être exposés. Quel retour sur ces expériences de contextualisation a posteriori, voire d’inversion des rôles entre commissaires et publics ? Quels sens neufs apportent-ils à l’objet ?
D’autres questions, certains paradoxes viendront encore dans le débat, par exemple : un musée sans objets, est-ce un musée ? Une installation, une œuvre éphémère, sont-elles des objets ?
En trois heures, on ne pourra pas tout dire… Sur toutes ces interrogations techniques et scientifiques, mais aussi philosophiques, le débat sera ouvert et non refermé. En effet, il intervient à un moment-clé de dialogue entre les 135 pays membres de l’ICOM, sur ce qu’est l’objet-même du musée, aujourd’hui, demain, de par le monde ?
Cette soirée débat préfigurera ainsi la journée que nous tiendrons le 10 mars à Paris avec nos homologues de l’ICOM qui ont souhaité poursuivre avec nous la réflexion prospective sur la « définition du musée » .
1. Jacques Hainard, « L’expologie bien tempérée », in quaderns-e, 2007
2. Propos de Pierre Soulages dans Béatrice Gurrey, « Pierre Soulages : Dans ma centième année, j’ai toujours du plaisir à peindre », in Le Monde, 24 novembre 2019
3. Propos de Marie Lavandier (directrice du musée du Louvre Lens) dans Nicolas Delesalle, « Comment regardons-nous les œuvres d’art ? », in Télérama, 1er février 2018
Appel à autoriser l'azote pour la protection du patrimoine culturel
Les musées, les institutions de mémoire et les professionnels du patrimoine de l'Union européenne ont une dernière chance d'annuler un règlement de l'UE interdisant l'utilisation d'azote généré in situ.
En tant qu'organisations professionnelles consacrées à la protection du patrimoine culturel, l'ICOM et l'ICOMOS encouragent toutes les parties prenantes du patrimoine culturel dans un appel commun à faire entendre leur voix et à expliquer pourquoi, à leur sens, le règlement de l'UE interdisant l'utilisation d'azote généré in situ dans le traitement anoxique (https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation) met en danger la protection du patrimoine culturel.
L'azote généré in situ est couramment utilisé pour la préservation de collections et d'objets culturels d'une valeur inestimable. Par rapport à d'autres méthodes beaucoup plus dangereuses et toxiques, l'utilisation de l'azote présente de nombreux avantages : cette méthode peut être utilisée pour le traitement de presque tous les objets culturels et présente le profil environnemental et sanitaire le plus favorable (l'azote/N2 représente 78 % de l'air que nous respirons !). L'azote peut être appliqué à des objets fabriqués à partir de matériaux qui ne peuvent pas être soumis à d'autres traitements tels que la congélation ou les traitements thermiques, et en particulier à des objets faits de matériaux organiques ou combinés. Il n'existe pas d'alternative viable au traitement anoxique qui serait compatible avec les exigences de conservation.
Suite à la demande de dérogation de l'Autriche au titre de l'article 55, paragraphe 3, du RPB, la Commission décidera s'il y a lieu d'accorder ou non une dérogation. Pour ce faire, elle doit analyser la justification fournie par l'Autriche ainsi que d'autres informations disponibles ou fournies par les parties intéressées, notamment en ce qui concerne les solutions de remplacement disponibles (En savoir plus, En savoir plus).
À cette fin, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a lancé une consultation publique, invitant les parties intéressées à fournir des informations sur les alternatives potentielles disponibles pour la protection du patrimoine culturel. Les informations recueillies dans le cadre de la consultation publique seront prises en compte pour décider d'accorder ou non une dérogation.
C'est peut-être la dernière chance offerte à la communauté de la conservation pour se mobiliser sur ce sujet. La date limite pour soumettre votre déclaration est le 18 janvier 2020 !
Merci de soutenir notre appel à l'utilisation de l'azote produit in situ dans le cadre de la consultation publique de l'UE, disponible sur le site web de l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) :
Contexte :
Pour participer à la consultation publique :
À cette fin et pour faciliter vos efforts, l'ICOM et l'ICOMOS ont rédigé une brève lettre, que vous trouverez ci-contre. Vous pouvez l’utiliser comme vous le souhaitez (les institutions participantes et les particuliers doivent ajouter leur papier à en-tête à la lettre et la télécharger en format PDF) et la soumettre au processus de consultation publique en tant que IV. Attachments - Non-confidential information.
Le rôle des collections dans les musées de musique
La prochaine conférence annuelle du CIMCIM se tiendra du 6 au 10 septembre 2020 à Londres, et sera accueillie par le Royal College of Music Museum et le Horniman Museum & Gardens. Elle sera suivie d’une visite post-conférence du St. Cecilia’s Hall à Édimbourg. Ces trois musées ont récemment subi d'importants réaménagements, qui seront présentés par leurs équipes respectives.
Le sujet de la conférence annuelle est
"Beyond the Object and Back: the Role of Collections in Music Museums".
Un appel à contribution est lancé par le CIMCIM.
Date limite d'envoi des propositions : 10 février 2020 à l'adresse de Marie Martens, secrétaire du CIMCIM (Marie.Martens@natmus.dk)
Sujet :
Une même collection s'avère souvent capable de raconter des histoires profondément différentes. Des collections d'instruments de musique ont été déployées pour soutenir des propos divers, du récit évolutionniste au récit de la décolonisation, de l'organologie systématique aux récits mettant en évidence les contextes, privilégiant parfois la conservation, la recherche universitaire, l'exposition ou la jouabilité de l'instrument.
Alors que certaines collections reflètent les goûts et les intérêts individuels, d'autres représentent des idées collectives et des grandes tendances, les méthodologies et les priorités culturelles de leur époque. En tant que tels, ils sont de puissants miroirs d'une époque - et indiquent la nature de la relation entre la musique et la société elle-même.
Aujourd'hui, l'évolution des attitudes vis-à-vis du public et le rôle culturel et social attribué aux musées, l'équilibre entre le patrimoine matériel et immatériel et l'accès aux technologies numériques comptent parmi les nombreux facteurs qui influencent la manière dont les musées collectent ou éliminent les objets, choisissent les éléments à exposer ou à préserver, et gèrent les objets qui ne peuvent pas être présentés. Les agendas culturels et politiques, l'intérêt public et les idées préconçues ont souvent joué un rôle majeur dans la définition de ce qui doit et ne doit pas être montré. Dans certains cas, la pertinence des collections dans les musées a même été complètement remise en question, alors que le rôle central des objets dans les expositions a été reconsidéré, et tandis que l'espace de stockage s'est révélé comme un défi de plus en plus complexe.
Cette conférence vise à présenter des perspectives critiques sur la façon dont les collections de musique représentent - ou peinent à représenter - les ambitions et les objectifs des institutions qui les gèrent, hier et aujourd'hui. Comment les collections de musique répondent-elles aux changements d'identité des musées ? Que cela implique-t-il au niveau de la préservation et de la conservation des collections ? Qu'est-ce qui motive ou entrave ces changements ? De quelles manières les collections historiques peuvent-elles encore être utilisées pour représenter des idées actuelles ?
Peuvent-être soumis des articles aux formats suivants :
- Articles complets - intervention de 20 min.
- Articles brefs - intervention de 10 min.
- Tables rondes - jusqu'à 60 min.
Dans le cadre du programme, une session abordera les sujets ci-dessus en se référant spécifiquement à la collecte et au jeu d'instruments à clavier historiques ; une session traitera spécifiquement de la conservation. Une autre sera réservée à de courts articles (7 min), visant à présenter des projets en cours et des mises à jour dans le domaine des musées de musique, pas nécessairement liés au thème de la conférence.
Merci d'envoyer des résumés de maximum 300 mots pour les articles complets, ou 200 mots pour les articles courts, en spécifiant clairement votre nom complet, votre institution, votre adresse et en joignant une brève biographie (max 100 mots) à Marie.Martens@natmus.dk d'ici le 10 février 2020.
Les résumés acceptés seront publiés sur le site Web de la conférence, peu de temps après. Une version plus longue des textes et des images sera demandée d'ici fin juillet pour une publication dans les actes numériques de la conférence. Les articles doivent être présentés à la conférence par l'auteur en personne, (ou l'un des auteurs cités, si l'article a été rédigé par plusieurs auteurs).
Marketing Planet 360° - Musée POLIN : Marketing et recherche en pratique
Du 2 au 3 mars 2020, le service Marketing et Communication du Musée POLIN partagera ses connaissances et ses retours d'expériences à travers des présentations, des ateliers et des discussions.
Date limite de candidature : 1er février 2020
Les candidatures seront examinées par le bureau exécutif de NEMO et par le comité d'organisation de la conférence. Toute candidature doit être composée de :
- la preuve de son adhésion à NEMO
- une lettre de motivation, exprimant les attentes du candidat
- un CV
L'échange d'apprentissage (NEMO Learning Exchange) est gratuit pour les membres de NEMO, sous conditions de candidature validée. Les participants se verront rembourser leurs frais de voyage, d'hébergement et de séjour, par une somme forfaitaire fixe de 600 euros.
La fabrication du luxe
À vos agendas !
La conférence annuelle de COSTUME, comité international de l'ICOM, se tiendra du 29 juin au 3 juillet 2020 au Château de Versailles sur le thème "La Fabrication du luxe".
Château de Versailles
Auditorium - Pavillon Dufour
78000 Versailles
- Programme à venir
- Information et contact : corinne.thepaut-cabasset[a]chateauversailles.fr
Appel à communication - avant le 20 février 2020
Dans la mode, le luxe est tout d’abord associé avec les plus riches. Rois, princes et aristocrates rivalisaient grâce à leurs vêtements indiquant directement leur statut et leur fortune. Cependant, chacun, même quelqu’un de pauvre, avait sa propre conception du luxe auquel il aspirait. Pour une dame de la cour un châle en cachemire de la meilleure qualité était un luxe, tandis que pour une femme de la classe moyenne un châle de coton brodé imitant le châle de cachemire pouvait être l’objet de luxe. Le château de Versailles est le meilleur endroit pour approcher les aspects variés de la création, du luxe et de la mode.
Les communications sur les sujets suivants seront particulièrement bien reçus, mais n’hésitez pas à appréhender d’autres aspects du luxe dans la mode tout au long de son histoire jusqu’au 21e siècle :
- Concurrence entre monarques, ou comment éclipser les autres ?
- Luxe et extravagance
- Matériaux luxueux, techniques sophistiquées et innovations au service de la mode
- Les réseaux et circuits de la production du luxe, commerce et consommation
- Le luxe de tout un chacun, copies et imitations de vêtements luxueux et d’accessoires de mode
- Comment s’habiller pour l’église ou la fête du village ?
Le sens de l'objet
« OBJETS INANIMÉS,
AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME
QUI S’ATTACHE À NOTRE ÂME
ET LA FORCE D’AIMER ? »
Alphonse de Lamartine
Dans la définition du dictionnaire, l’objet est « toute chose concrète, perceptible par la vue et le toucher ».
Pour des professionnels de musée, le mot d’objet revêt un sens singulier : il désigne de manière générale ce que le musée conserve, qu’il s’agisse d’une institution muséale de beaux-arts, d’histoire, d’histoire naturelle, de sciences et techniques, d’art contemporain, etc. On peut parler d’objets virtuels, objet et abstraction ne s’opposent pas.
Pourtant, le vif débat de cet été lors de la conférence générale de l’ICOM à Kyoto sur la « nouvelle définition des musées » a semé le doute : d’objets, il n’était pas question, ni de collections ou d’œuvres, ou seulement en arrière-plan d’un « lieu polyphonique et inclusif » que devrait être pour certains le musée de demain. La position des professionnels français a été consensuelle pour échapper à cette banalisation.
Quatre mois plus tard, la sixième soirée-débat organisée avec l’INP, sur le « sens de l’objet », vise à revenir au cœur des métiers et de la matière des musées.
- L’objet a-t-il un sens en lui-même ? « Le musée est un dictionnaire dans lequel les objets sont les mots […]. Non-inscrits dans un propos, dans un discours, ils perdent leur sens »1.
C’est précisément le travail des professionnels de musée de donner un sens, un langage, une interprétation à l’objet qu’ils conservent ; l’objet est un témoin préservé pour transmettre la mémoire des arts, des sciences, des sociétés. Le conserver est la mission première. S’il est blessé, par le temps ou les guerres, perd-il son sens ou en prend-il un autre ? Les cicatrices font partie du témoignage dont il est porteur. À quelles conditions – traçabilité, réversibilité… – restaure-t-on le sens de l’objet ? C’est le cœur des missions de l’INP.
- Sous l’angle de la déontologie, on peut parler d’objet de connaissance, dont il faut rendre le récit le plus juste possible. Garante de l’authenticité, c’est la part du travail scientifique des musées. On l’a vu au cours d’un autre débat vif de l’année 2019, sur les « restitutions » : la recherche sur les collections et leur provenance est ardue, jamais achevée et n’épuise pas les questions du « sens de l’objet » : œuvres d’art porteuses de valeurs esthétiques ici, objets rituels porteurs de valeurs spirituelles pour leurs créateurs
- Le sens de l’objet est-il séparable de son contexte ? Pierre Soulages dit cela : « la peinture c’est une chose, mais ce qui importe c’est l’art et ce qui, dans un objet, nous transporte dans des zones de ce que nous sommes et que nous ne connaissons peut-être pas »2.
- Le sens de l’objet est-il « durable » ? Pour la directrice du Louvre-Lens, le sens et l'interprétation d'une œuvre d'art « ne sont pas définis une fois pour toute par l'artiste ni son époque, mais ils sont enrichis par chaque regard, chaque visiteur »3.
Se peut-il aussi qu’ils soient enrichis par les technologies, numériques, 3D, IA… ? Que l’objet répliqué, reproduit, numérisé, partagé, « démocratisé », comme on le lirait dans le rapport Musée du XXIe siècle, porte en lui-même un sens ?
Dans plusieurs musées, les publics sont invités à choisir - parfois dans les réserves - les objets qui vont être exposés. Quel retour sur ces expériences de contextualisation a posteriori, voire d’inversion des rôles entre commissaires et publics ? Quels sens neufs apportent-ils à l’objet ?
D’autres questions, certains paradoxes viendront encore dans le débat, par exemple : un musée sans objets, est-ce un musée ? Une installation, une œuvre éphémère, sont-elles des objets ?
En trois heures, on ne pourra pas tout dire… Sur toutes ces interrogations techniques et scientifiques, mais aussi philosophiques, le débat sera ouvert et non refermé. En effet, il intervient à un moment-clé de dialogue entre les 135 pays membres de l’ICOM, sur ce qu’est l’objet-même du musée, aujourd’hui, demain, de par le monde ?
Cette soirée débat préfigurera ainsi la journée que nous tiendrons le 10 mars à Paris avec nos homologues de l’ICOM qui ont souhaité poursuivre avec nous la réflexion prospective sur la « définition du musée » .
1. Jacques Hainard, « L’expologie bien tempérée », in quaderns-e, 2007
2. Propos de Pierre Soulages dans Béatrice Gurrey, « Pierre Soulages : Dans ma centième année, j’ai toujours du plaisir à peindre », in Le Monde, 24 novembre 2019
3. Propos de Marie Lavandier (directrice du musée du Louvre Lens) dans Nicolas Delesalle, « Comment regardons-nous les œuvres d’art ? », in Télérama, 1er février 2018
Formation ICOM/MAC sur la gestion des risques au sein des musées
Les professionnels francophones des musées de la région des Caraïbes sont invités à participer à un atelier de formation professionnelle de cinq jours sur la gestion des risques qui aura lieu en Martinique du 11 au 15 mai 2020.
L’atelier est le fruit d’une collaboration entre l’ICOM, l’Association des Musées des Caraïbes (MAC) et la Collectivité Territoriale de Martinique. Il sera soutenu par le Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines – Smithsonian Institution et le Ministère français de la Culture.
L’objectif du programme est de renforcer les capacités des professionnels des musées à identifier et à atténuer les risques, et à répondre efficacement aux situations d’urgences et de crises. À travers des activités participatives, des séminaires et des conférences, l’atelier offrira également un espace de dialogue et de réflexion entre les professionnels des musées de la région et avec des experts d’autres pays. Des bourses seront offertes à tous les participants.
Pour postuler à ce programme, les candidats doivent répondre aux critères suivants :
• occuper un poste de cadre intermédiaire dans un musée reconnu de la région des Caraïbes (voir la liste des pays et territoires ci-dessous) ;
• Être membre de l’ICOM ou MAC ou s’engager à rejoindre ces organisations en cas de sélection ;
• Parler couramment le français ;
Deux types de bourses seront proposés pour assurer la participation des professionnels sélectionnés :
Pour les professionnels des musées des pays et territoires sur la liste ci-dessous (sauf ceux vivant en Martinique) la bourse couvrira :
- les frais de participation ;
- billet d’avion / bateau en classe économique aller-retour ;
- l’hébergement en hôtel avec petit déjeuner ;
- Les déjeuners et pauses café.
Pour les participants résidant en Martinique :
- les frais de participation;
- les déjeuners et pauses café.
Les frais de visa, d’assurance et les autres dépenses non explicitement mentionnées ci-dessus sont à la charge des participants.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants en français :
- Une lettre de motivation (une page);
- Un curriculum vitae du candidat indiquant la formation, l’expérience professionnelle et les responsabilités professionnelles actuelles (deux pages maximum);
- Une lettre de recommandation du directeur de l’institution du demandeur;
- Une copie de la première page du passeport, ou CNI pour les résidents de la Martinique ; (NB: votre passeport doit être valide au moins jusqu’au 30 décembre 2020)
- Preuve de paiement de la cotisation ICOM ou MAC 2019, le cas échéant (copie de la carte ICOM avec autocollant 2019 ou document officiel du Comité national).
- Toutes les candidatures doivent parvenir aux organisateurs en ligne avant minuit (CET + 1), le 4 février 2020.
Remplir le formulaire en ligne
Liste de pays et territoires :
- Dominique
- Grenada
- St Vincent et les Grenadines
- Guadeloupe
- Guyane Française
- Haïti
- Martinique
- République Dominicaine
- Saint-Barthélemy
- Sainte-Lucie
- Saint-Kitts et Nevis
- Collectivité de Saint-Martin
- Sint Maarten
- Trinidad et Tobago
- Antigua and Barbuda
- Jamaica
- Barbados
- Suriname
- Guyana
Formation ICOM/MAC sur la gestion des risques au sein des musées
Les professionnels francophones des musées de la région des Caraïbes sont invités à participer à un atelier de formation professionnelle de cinq jours sur la gestion des risques qui aura lieu en Martinique du 11 au 15 mai 2020.
L’atelier est le fruit d’une collaboration entre l’ICOM, l’Association des Musées des Caraïbes (MAC) et la Collectivité Territoriale de Martinique. Il sera soutenu par le Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines – Smithsonian Institution et le Ministère français de la Culture.
L’objectif du programme est de renforcer les capacités des professionnels des musées à identifier et à atténuer les risques, et à répondre efficacement aux situations d’urgences et de crises. À travers des activités participatives, des séminaires et des conférences, l’atelier offrira également un espace de dialogue et de réflexion entre les professionnels des musées de la région et avec des experts d’autres pays. Des bourses seront offertes à tous les participants.
Pour postuler à ce programme, les candidats doivent répondre aux critères suivants :
• occuper un poste de cadre intermédiaire dans un musée reconnu de la région des Caraïbes (voir la liste des pays et territoires ci-dessous) ;
• Être membre de l’ICOM ou MAC ou s’engager à rejoindre ces organisations en cas de sélection ;
• Parler couramment le français ;
Deux types de bourses seront proposés pour assurer la participation des professionnels sélectionnés :
Pour les professionnels des musées des pays et territoires sur la liste ci-dessous (sauf ceux vivant en Martinique) la bourse couvrira :
- les frais de participation ;
- billet d’avion / bateau en classe économique aller-retour ;
- l’hébergement en hôtel avec petit déjeuner ;
- Les déjeuners et pauses café.
Pour les participants résidant en Martinique :
- les frais de participation;
- les déjeuners et pauses café.
Les frais de visa, d’assurance et les autres dépenses non explicitement mentionnées ci-dessus sont à la charge des participants.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants en français :
- Une lettre de motivation (une page);
- Un curriculum vitae du candidat indiquant la formation, l’expérience professionnelle et les responsabilités professionnelles actuelles (deux pages maximum);
- Une lettre de recommandation du directeur de l’institution du demandeur;
- Une copie de la première page du passeport, ou CNI pour les résidents de la Martinique ; (NB: votre passeport doit être valide au moins jusqu’au 30 décembre 2020)
- Preuve de paiement de la cotisation ICOM ou MAC 2019, le cas échéant (copie de la carte ICOM avec autocollant 2019 ou document officiel du Comité national).
- Toutes les candidatures doivent parvenir aux organisateurs en ligne avant minuit (CET + 1), le 4 février 2020.
Remplir le formulaire en ligne
Liste de pays et territoires :
- Dominique
- Grenada
- St Vincent et les Grenadines
- Guadeloupe
- Guyane Française
- Haïti
- Martinique
- République Dominicaine
- Saint-Barthélemy
- Sainte-Lucie
- Saint-Kitts et Nevis
- Collectivité de Saint-Martin
- Sint Maarten
- Trinidad et Tobago
- Antigua and Barbuda
- Jamaica
- Barbados
- Suriname
- Guyana
Dons, legs, donations... Comment intégrer les "libéralités" dans les PSC ?

La journée professionnelle 2019 a porté sur les libéralités comme mode d'enrichissement des collections des musées, et les modalités scientifiques et juridiques de leur intégration dans les PSC.
Cette journée a réuni des responsables de musées, qui ont partagé leurs expériences et exposé leurs points de vue : bénéfices pour les musées, conséquences sur la politique scientifique et culturelle des institutions, cas singulier d'institutions créées ad hoc, relations avec les donateurs, politique de la philanthropie au musée...

Tous au musée : diversité et inclusion
ÉVÉNEMENT NUMERIQUE - Tous au musée : diversité et inclusion
Rien n'empêche #IMD2020 de se poursuivre et de promouvoir ses valeurs d'inclusion et le rôle des musées dans la société. Les événements numériques et en ligne sont plus que bienvenus !
Nous invitons les musées du monde entier à organiser des activités en ligne autour de cette journée et à célébrer avec nous les Musées pour l'égalité : diversité et inclusion.
Pour cela, partager vos activités dans la carte interactive de la JIM2020 !
Carte interactive
DATE ALTERNATIVE
Pour les musées qui souhaitent organiser des activités sur place, l'ICOM propose une date alternative : une célébration de trois jours entre le 14 novembre - date coïncidant avec la Nuit européenne des musées - et le 16 novembre 2020 - date du 74e anniversaire de l'ICOM.
D'ici fin novembre, l'ICOM continuera à soutenir tous les musées qui souhaitent participer à cette célébration mondiale des musées et de leurs communautés, qu'ils le fassent virtuellement ou sur place.
THÉMATIQUE
Renforcer la diversité et l’inclusion dans nos institutions culturelles
Le potentiel des musées à créer des expériences significatives pour des publics de toutes origines et de tous horizons est au cœur de leur valeur sociale. En tant qu’agents du changement et institutions de confiance, il n’y a pas d'époque plus significative que la nôtre pour que les musées démontrent leur pertinence, en s’engageant de manière constructive dans les réalités politiques, sociales et culturelles de la société moderne.
Les défis de l’inclusion et de la diversité, et la difficulté de faire face à des problèmes sociaux complexes dans des environnements de plus en plus polarisés, sont importants, bien qu’ils ne soient pas propres aux musées et aux institutions culturelles, en raison du haut degré de confiance dont bénéficient les musées dans la société.
Une attente croissante du public pour le changement social a catalysé une conversation sur le potentiel des musées pour le bien social sous la forme d’expositions, de conférences, de performances, de programmes éducatifs et d’autres initiatives. Cependant, il reste beaucoup à faire pour surmonter les dynamiques de pouvoir conscientes et subconscientes qui peuvent créer des disparités au sein des musées, et entre les musées et leurs visiteurs.
Ces disparités peuvent concerner de nombreux sujets, notamment l’origine ethnique, le sexe, l’orientation et l’identité sexuelle, le milieu socio-économique, le niveau d’éducation, les capacités physiques, l’appartenance politique et les croyances religieuses.
Avec le thème « Tous au musée : diversité et inclusion », la Journée internationale des musées 2020 vise à devenir un point de ralliement pour célébrer à la fois la diversité des perspectives qui composent les communautés et le personnel des musées, et promouvoir des outils pour identifier et surmonter les préjugés dans ce qu’ils affichent et les histoires qu’ils racontent.
Télécharger le kit de communication
Devenez auteur pour l'ICOM, répondez à l'appel à contribution :