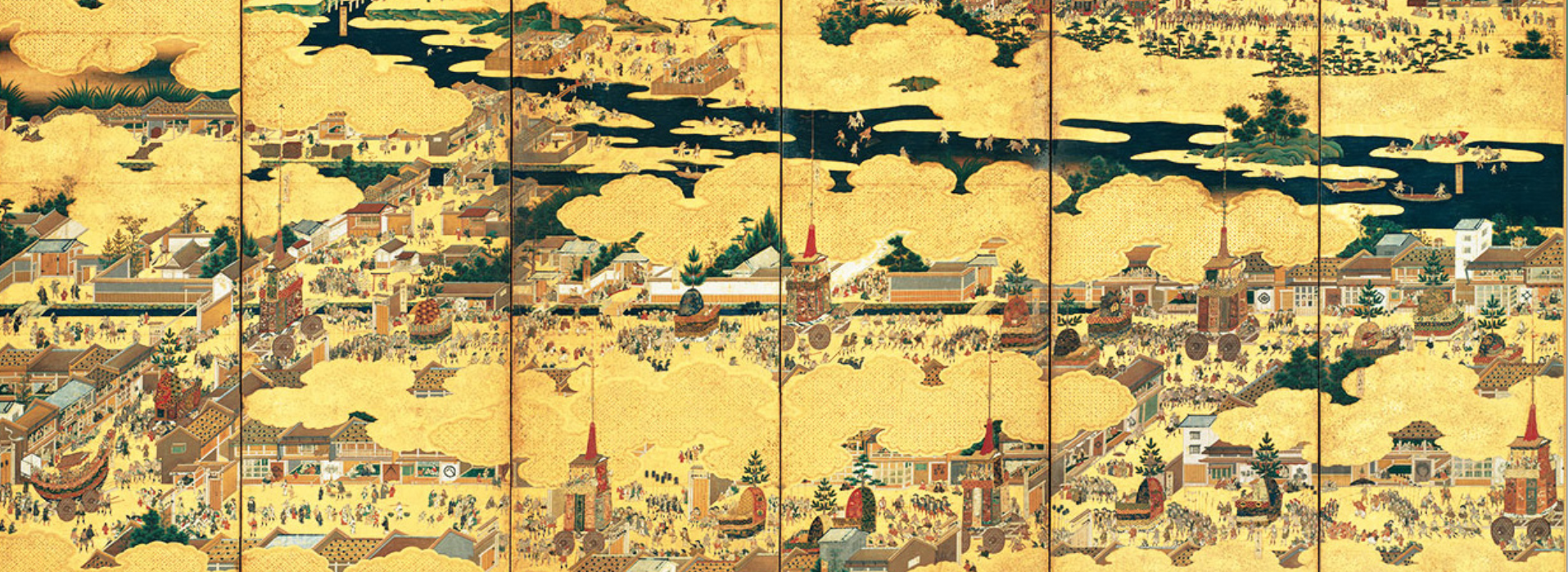Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
25e Conférence Générale de l’ICOM à Kyoto
Les travaux de la 25e Conférence Générale de l’ICOM, rassemblant plus de 4000 professionnels de musée, se sont achevés samedi 7 septembre 2019 à Kyoto.
Une délégation française très nombreuse (73 professionnels français) y a participé.
Le comité national français de l’ICOM a été particulièrement actif sur les trois sujets-clés à l’ordre du jour de cette conférence générale :
La « nouvelle » définition du musée
Proposée par le conseil exécutif de l’ICOM le 25 juillet, les termes retenus pour actualiser la définition existante ont suscité tout l’été l’émoi parmi les professionnels, en particulier en France. Commençant ainsi : « Les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d’artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l’égalité des droits et l’égalité d’accès au patrimoine pour tous les peuples », la proposition tient plutôt de la déclaration de d’intentions que d’une définition, ce qui surprend quand on sait que la définition des musées par l’ICOM sert de référence dans le monde entier et est incluse dans les textes réglementaires ou législatifs de nombreux états membres.
La réaction du comité national français a été immédiate : dès juin, un courrier a été adressé par Juliette Raoul-Duval, Présidente d’ICOM France, à Suay Aksoy, Présidente de l’ICOM pour signaler la politisation inappropriée du rapport préparatoire à cette définition. A la sortie sur les réseaux sociaux de la définition elle-même, un communiqué a été publié, largement relayé par les membres d’ICOM France (qui en compte 5200), par la communauté des musées dans son ensemble, par de nombreux professionnels et personnalités de la culture et par la presse. Les termes alambiqués, la tonalité plus politique que professionnelle ainsi que la précipitation à faire voter cette modification d’envergure impactant les statuts de l’organisation ont entrainé la mobilisation derrière la position française conjointe avec ICOM Europe, de 27 comités nationaux et 7 comités internationaux, signataires solidaires d’une lettre adressée mi-août à la Présidente de l’ICOM l’invitant à surseoir à la tenue de l’Assemblée Générale extraordinaire du 7 septembre ayant ce seul point à son ordre du jour. Invitation que la présidente d’ICOM a décliné. Tout au long de la semaine à Kyoto, les signatures se sont alors multipliées, rassemblant au final une large majorité de membres, confrontés à des débats difficiles, divisant à la limite de la rupture cette communauté professionnelle de 44 000 membres, répartis dans 135 pays et soudée depuis plus de 70 ans.
Au vote, la décision de repousser l’adoption de cette définition a recueilli 70, 41 % des voix.
Il s'agit maintenant de reprendre le dialogue sereinement en prenant en considération l'importance que revêt pour certains pays membres la reconnaissance de missions sociales et politiques de leurs musées.
S’il est toujours intéressant d'actualiser une définition, cela peut se faire sans fracturer une organisation. Le travail sur la redéfinition du musée va donc se poursuivre, dans un climat qu'on espère apaisé et selon un calendrier propice à l’expression démocratique. Le comité national français revendique d'y être pleinement associé.
La francophonie
La France avait lancé l'initiative de créer un réseau mondial des musées francophones. La réunion de préfiguration s’est tenue à Kyoto le 3 septembre en présence de représentants de 40 membres de 17 pays francophones. Le désir de se retrouver en réseau, la volonté de faire des musées des acteurs à part entière de la francophonie en même tant que le constat d'une perte d'usage du plurilinguisme dans les organisations internationales, a été partagé par tous les participants. Ce réseau devra trouver sa forme juridique au sein de l'ICOM, pour pouvoir prendre appui sur la riche base de données des membres, parmi lesquels on peut considérer qu'environ 18 % (7 900 membres) sont francophones ou locuteurs français.
La « décolonisation des musées »
Ce sujet avait été mis à l'ordre du jour car il est dans l’actualité de nombreux pays membres, notamment en France, à la suite de la publication du rapport Savoy-Sarr recommandant la restitution de 26 œuvres au Bénin. ICOM France avait organisé en février une journée de travail : « Restituer ? Les musées parlent aux musées », rassemblant 130 professionnels parmi les plus concernés. Les actes sont disponibles sur son site. Bertrand Guillet, directeur du Château des ducs de Bretagne - musée d’histoire de Nantes, a présenté les principales propositions qui en découlent ainsi que celles qui ont été évoquées lors du « Forum patrimoines africains » en juillet à l’Institut de France : développer la connaissance et la recherche sur les provenances des collections, multiplier les possibilités de travail avec les musées africains, développer des outils d’information et d’éducation des publics sur les collections exposées… Bertrand Guillet a également exposé le projet de son musée, intitulé « Expression(s) décoloniale(s) ». Le film « L’ Afrique collectionnée » a été projeté au cours de la réception de la délégation française à la Villa Kujoyama, résidence d'artistes français à Kyoto.
La France occupe une place grandissante dans l’ICOM. Première contributrice de l’organisation internationale, elle est également en tête en nombre d’adhérents, juste derrière l’Allemagne. Notre communauté professionnelle est de loin la mieux représentée dans les comités internationaux de l’organisation (2484 membres, l’Allemagne arrivant ensuite avec 1500 membres suivie par les Etats-Unis, 1281) et 13 professionnels français ont été élus ou cooptés dans les « boards » de 12 comités internationaux sur les 30 que compte l’ICOM.
Cette remarquable progression était un objectif et un engagement pris par l’équipe élue en 2016. Les institutions et les membres ont positivement répondu à la sensibilisation organisée, tout au long de la mandature qui se terminera le 4 octobre prochain lors de l’assemblée générale d’ICOM France qui se tiendra à l’Institut du Monde Arabe.
Juliette Raoul-Duval
Présidente d'ICOM France
Arts & Vestiges : Contextualisation, Exposition, Scénographie
Le colloque international « Arts& Vestiges : Contextualisation, Exposition, Scénographie » proposé par « Contextualités-Réflexions et Regards Hybrides », et organisé en collaboration avec le Centre de Recherches sur l'Amérique Préhispanique (CeRAP), le Centre André Chastel et l'École Doctorale 124 de Sorbonne Université, aura lieu les 14 et 15 octobre 2019, de 9h30 à 17h30 dans l'auditorium de l'Institut National d'Histoire de l'Art, 2 rue Vivienne à Paris.
Il sera accompagné de l'exposition événement mise en place par le CeRAP : « Missions Tiahuanaco : aux origines des Incas » installée exceptionnellement, le temps du colloque, en salle Warburg au sein de la Galerie Colbert. L’exposition éphémère sera inaugurée par un « cocktail organique et fleuri » mis en scène par Patrick Perron, le 14 octobre à la suite des conférences de la première journée.
Invité d'honneur de ce colloque international, le Professeur Alexandre Gady, inaugurera le cycle des communications qui aura lieu le lundi 14 octobre par un prologue bouleversant intitulé : « Notre-Dame de Paris, miroir du temps. De l'incendie à l'art d'accommoder les restes » en mémoire de l’événement tragique qu’a subi la cathédrale en avril dernier. Par ailleurs, des thématiques éclectiques et transversales nous feront voyager dans les différents univers de la recherche universitaires à travers des sujets pointus rendus accessibles aux amateurs éclairés et au grand public. Ce nouveau colloque s’inscrit dans la continuité des projets universitaires de Sorbonne Université. En 2018 déjà, une première journée d’études avait été initiée par le Professeur Daniel Lévine et Micaela Neveu, doctorante du CeRAP et fondatrice de « Contextualités-Réflexions et Regards Hybrides ».
Ayant pour thème « La théâtralité et le pouvoir dans l’art et l’archéologie », cet événement avait rencontré un fort succès à l’INHA. Ce laboratoire de réflexions sur la communication de l’art, de la culture et du monde des musées développé en partenariat avec le CeRAP – structure aujourd’hui dirigée par François Cuynet – a pour objectif d'offrir un espace d'échanges et de rencontres aux étudiants, doctorants et jeunes chercheurs mais également d'ouvrir le champ de la recherche. C’est dans cette démarche d’ouverture que Micaela Neveu et François Cuynet ont conjointement pris l’initiative d’inaugurer ce projet de rencontres universitaires centrées sur la pluridisciplinarité et la communication aux publics les plus variés.
L'exposition « Missions Tiahuanaco : aux origines des Incas » retracera le récit en images des missions archéologiques en Bolivie sous la forme d'un carnet de voyage intimiste qui nous mènera aux confins des splendides paysages boliviens. Évocation sacrée des quatre éléments, l’eau, la terre, l’air et le feu, cet itinéraire expographique exprimera l’essence de la nature andine. Organisée conjointement par François Cuynet, directeur du CeRAP et Maître de conférences à Sorbonne Université, ainsi que par Micaela Neveu, fondatrice de « Contextualités-Réflexions et Regards Hybrides », l’exposition dont elle a réalisé le commissariat et la scénographie avec Anaïs Guérin, doctorante au CeRAP, signe un parcours visuel évoquant le contexte des fouilles françaises. Il nous mènera dans l'Altiplano, de la Cordillère des Andes au bleu de la « mer intérieure », le lac sacré Titicaca, pour découvrir le temps du feu et des offrandes en l’honneur de la Pachamama. Espace sacré et espace profane, espace du matériel archéologique et de la collecte d'informations, de la reconstitution et des interprétations culturelles ou encore espace du rêve et de l'imagination, les sublimes photographies de l'exposition nous montreront toute l'importance de la contextualisation dans l'univers de la recherche archéologique et de la scénographie des objets extra-européens in situ. Cette belle exposition dévoilera aussi des visages, ceux de peuples autochtones amplement impliqués ici au projet des missions archéologiques comme le fait d'un retour aux sources : à l’immense civilisation des Incas et des possibles pistes de leurs origines sur le continent sud-américain.
Proposé par Micaela Neveu et François Cuynet
En collaboration avec Daniel Lévine,
Arnaud Maillet, Sabine Berger et l’ED 124 de Sorbonne Université
Contact : contextualites@gmail.com
Membres organisateurs de Sorbonne Université :
Micaela Neveu, Doctorante, CeRAP
François Cuynet, Maître de conférences, Directeur du CeRAP
Daniel Lévine, Professeur titulaire de la Chaire d’Archéologie des Civilisations de l’Amérique
Préhispanique, CeRAP
Sabine Berger, Maître de conférences, Centre André Chastel
Arnaud Maillet, Maître de conférences, Centre André Chastel
Joanna Sezol, Doctorante CeRAP
Marie Planchot et l’équipe de l’École Doctorale 124.
Comité scientifique :
Micaela Neveu
François Cuynet
Daniel Lévine
Sabine Berger
Arnaud Maillet
Exposition :
Commissariat de l’exposition : Micaela Neveu
Comité scientifique : François Cuynet et Christophe Delaere
Scénographie : Micaela Neveu et Anaïs Guérin
ICOM Shanghai 2010 : Allocution du Président Chirac
Le Président Chirac avait été invité à prononcer le discours de clôture de la XXIIe Conférence Générale de l'ICOM à Shanghai en 2010.
Nous vous proposons de relire l'intervention donnée devant l'assemblée des professionnels de musées.
Monsieur le Vice-Ministre,
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs,
Mes chers Amis,
C'est un bonheur d'être parmi vous aujourd’hui, à Shanghai, pour clore la XXIIème Conférence Générale de l’ICOM.
C’est aussi pour moi un grand honneur. Et je veux d’abord remercier chaleureusement les autorités chinoises, ainsi que les organisateurs de la Conférence, pour la qualité de leur accueil.
Je rends hommage à l’engagement de M. Wu Cai, Ministre de la Culture chinois, qui a présidé la Conférence pendant six journées de travaux fructueux, ainsi qu'à M. Shang Jixiang, Vice Ministre, et Directeur Général de l'Administration d'Etat du Patrimoine Culturel. Je salue Monsieur Julien Anfruns, Directeur général de l’ICOM, qui a facilité ma présence parmi vous aujourd’hui. Et j'adresse à votre nouveau Président du Conseil d'Administration, élu ce matin, mes plus chaleureuses félicitations.
La satisfaction qui est la mienne, c’est d’abord celle de m’exprimer, une nouvelle fois, ici, en Chine, foyer de haute civilisation, pays que j’aime profondément, pays qui mobilise toutes les ressources de son histoire pluri-millénaire pour s’ancrer dans la modernité, et inventer les réponses audacieuses qu’appellent les grands défis de notre temps. A cet égard, l’Exposition Universelle de Shanghai a été, je le sais, une remarquable démonstration et une formidable réussite.
L’honneur qui est le mien, c’est également celui de pouvoir m’adresser à une institution aussi prestigieuse que le Conseil international des musées.
Depuis bientôt 65 ans, l’ICOM protège, préserve et communique la valeur du patrimoine culturel mondial.
Forte d’un réseau de 30 000 membres à travers 137 pays du monde, l’ICOM est parvenue à s’imposer comme un acteur essentiel de la coopération culturelle internationale.
Dans votre enceinte, les professionnels des musées débattent et échangent. Ils travaillent au-delà des barrières culturelles et nationales.
Ils contribuent à faire de la culture un instrument au service d’une société plus ouverte, plus tolérante et plus harmonieuse.
Le thème retenu cette année pour la Conférence -l’harmonie sociale -illustre, parfaitement le rôle que les professionnels des musées peuvent et doivent avoir.
Ma conviction, c’est que dans des périodes troublées telles que nous les connaissons aujourd’hui, les musées ont une vocation sociale et morale.
A l’origine, lieux d’exposition et de conservation érudites, les musées sont devenus des lieux d’échange et de rencontre.
De sanctuaires, ils se sont la plupart du temps transformés en institutions culturelles ouvertes, populaires et interactives.
Le développement de la fréquentation des musées par les jeunes, partout dans le monde, est, à ce titre, significatif.
En offrant un accès à la culture, les musées favorisent la connaissance et la compréhension mutuelles.
Souvent, ils sont une vitrine du patrimoine et de l’histoire d’un pays. Ils contribuent alors à valoriser une culture et une histoire nationales ou régionales.
Mais leur place nouvelle dans la société leur permet aujourd’hui d’aller plus loin.
Je crois désormais essentiel que les Musées puissent favoriser l’accès à l’autre.
A ce que font les autres. A ce que sont les autres. C’est l’ambition qui a été la mienne lorsque j’ai œuvré à la création, à Paris, du Musée du Quai Branly, consacré aux arts dits premiers, et à des cultures aussi éloignées que méconnues.
J’ai toujours considéré en effet que nous avions beaucoup à apprendre des civilisations millénaires et de leurs expressions artistiques.
Le Musée du Quai Branly, c’est aujourd’hui un lieu d’accueil, moderne et chaleureux, où les cultures révèlent pleinement leur génie et leur richesse.
Son ambition, c’est d’offrir à chaque visiteur une véritable leçon d’humanité.
Je suis profondément attaché au renforcement du dialogue des cultures et des civilisations.
Sans arrogance, mais sans indifférence. Dans la tolérance et le respect.
Ces convictions sont celles qui ont fondé l’engagement de ma vie.
Un engagement au service de la paix que je poursuis aujourd’hui avec la Fondation que j’ai créée.
Cette Fondation se consacre, à travers les projets qu’elle soutient dans les domaines de la solidarité, de l’environnement et du dialogue des cultures, à agir au service de la paix.
La paix, bien entendu, est directement menacée par les conflits non résolus ou par les crises.
Mais elle l’est aussi par la disparition des cultures singulières. C’est cette disparition des cultures et des identités qui peut générer, au fil du temps, d’abord la crispation identitaire, puis le développement des comportements de mépris et de rejet de l’autre, enfin la violence et même le terrorisme.
Entendons le : chaque peuple, chaque culte, a un message singulier à délivrer au monde. Chaque peuple, chaque religion, peut enrichir l’humanité en apportant sa part de beauté, de création, de vérité.
La diversité culturelle, c’est le respect de la singularité de toute création. C’est le refus d'un standard qui bâtirait un univers parfaitement rationnel et parfaitement aseptisé.
Le combat pour la diversité culturelle n’est donc pas assimilable à la préservation anxieuse ou nostalgique de ce qui vient du passé.
Les cultures sont vivantes, et se transforment sans cesse.
Et pour inventer, il faut garder la mémoire du passé.
Ma conviction, c’est que chaque civilisation, chaque culture est porteuse de multiples richesses.
Devant une mondialisation qui s’accélère, et face aux risques d’uniformisation qu’elle comporte, le destin du monde est là : dans la capacité des peuples à porter les uns sur les autres un regard instruit et compréhensif, à faire dialoguer leurs différences et leurs cultures et à se respecter mutuellement.
Et si le monde a connu une croissance exponentielle du nombre de ses musées, au cours des dix dernières années, ce n’est pas un hasard.
Je veux ici saluer la modernité de ces nouvelles institutions, et féliciter celles et ceux d’entre vous qui s’engagent dans cette conception du musée, lieu de rencontre et de dialogue, de partage et de connaissance ; un musée comme lieu d’interrogation sur notre monde en perpétuelle évolution.
Mes Chers Amis,
Depuis 6 jours, vous échangez et vous débattez pour améliorer votre action, pour améliorer la lutte contre les trafics de biens culturels et leur sécurité, pour valoriser les patrimoines, pour développer la communauté muséale mondiale. Je sais combien vos discussions ont été riches et passionnées.
Tous, vous travaillez dans des contextes politiques différents. Mais tous, par vos collections et vos expositions, par votre engagement et votre passion, par votre travail scientifique et vos recherches, vous faites vivre le patrimoine de l’humanité.
Cette tâche est parmi les plus nobles qui soient.
Je souhaitais aujourd’hui vous en féliciter et vous en remercier. Parce que c’est de la compréhension de l’autre que naît la paix entre les hommes, et la paix entre les peuples.
Je vous remercie.
Jacques Chirac
« Croqueurs de Patrimoine » - Infestation : aide au diagnostic
Identifier et évaluer les risques liés aux infestations entomologiques, prendre les mesures adaptées en cas d’infestation avérée.
La formation permettra la réalisation de boites entomologiques de références et l’identification des insectes fréquemment rencontrés dans les institutions patrimoniales, au moyen de matériel optique adapté telle que des loupes binoculaires en lien avec la base de données « Insectes du patrimoine culturel» et autres ressources bibliographiques du Web.
Public visé : toute personne œuvrant ou souhaitant œuvrer dans le domaine patrimonial (biens culturels mobiliers ou immobiliers : monuments historiques, musées, archéologie, patrimoine écrit….)
Nombre de stagiaires : 5 - 10
Durée de la formation : 2 jours
Prix du module : 300 euros
Modalités : les stagiaires sont invités dans la mesure du possible à apporter des échantillons infestés ou des insectes pour identification.
Formateur : Fabien Fohrer, entomologie, CICRP
Pour tout renseignement : info@cicrp.fr
Pour inscription : formulaire en ligne sur le site du CICRP
Composition du Conseil d'administration et du Bureau d'ICOM France
Bureau exécutif
Juliette Raoul-Duval - Présidente
Emilie Girard - Vice-présidente
Marie Grasse - Trésorière
Hélène Vassal - Secrétaire
Estelle Guille des Buttes - Trésorière adjointe
Florence Le Corre - Secrétaire adjointe
Équipe
Anne-Claude Morice, déléguée générale
Lisa Eymet, assistante
Toute demande administrative doit être adressée à l'e-mail d'ICOM France : icomfrance[a]wanadoo.fr

Conseil d’Administration
Le conseil d’administration d’ICOM France est composé d’élus et de membres de droit. Il est représentatif de toute la profession, grands et petits établissements, nationaux et territoriaux, individus et associations de professionnels, acteurs de terrain et chercheurs. Le ministère de la Culture en est membre de droit et soutient son action.
Le Conseil d’administration d’ICOM France est composé de 16 membres élus pour un mandat de six ans et 14 membres de droit représentatifs de l’écosystème muséal français.
Membres élus
Odile Boubakeur – RMN-GP - Paris
Isabelle Brianso – Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
André Delpuech – Musée de l'Homme - Paris
Marie-Laure Estignard – Musée des Arts et Métiers - Paris
Emilie Girard – MuCEM - Marseille
Estelle Guille des Buttes – Musée de Pont-Aven et du Musée de la Pêche - Concarneau
Marie Grasse – Musée national du Sport - Nice
Sophie Harent – Musée national Magnin - Dijon
Frédéric Ladonne – Architecte
Florence Le Corre – Musée du service de santé des Armées - Paris
Laure Ménétrier – Musées de Beaune
Véronique Milande – Service de la conservation des oeuvres d'art religieuses et civiles - Paris
Juliette Raoul-Duval – Conseil en organisation des musées - Mission Musée de l'Air et de l'Espace
Jacques Terrière – Ville de Dinard
Laurent Thurnherr – Maison de Robert Schuman / Musée départemental de la guerre de 1870 et de l'Annexion - Scy-Chazelles
Hélène Vassal – Centre Pompidou - Paris
Membres de droit
Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle – Guillaume Desbrosse
Association générale des conservateurs des collections publiques de France – Catherine Cuenca
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou – Michael Schischke
Direction générale des patrimoines / Service des musées de France – Anne-Solène Rolland
Direction générale des patrimoines / Département des affaires européennes internationales – Bruno Favel
Etablissement public du Musée du Louvre – Dominique de Font-Réaulx.
Etablissement public du Musée du quai Branly-Jacques Chirac – Yves Le Fur
Etablissement public Paris Musées – Charles Villeneuve de Janti
Fédération des écomusées et musées de société – Céline Chanas
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration – Nathalie Bruhière
Musée des arts et métiers – NN
Musées nationaux du Ministère de la Défense – Anne-Catherine Robert-Hauglustaine
Muséum national d’Histoire naturelle – Agnès Parent
Universcience, Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie – Sophie Biecheler
Jouer et actionner les instruments des collections patrimoniales
La valeur patrimoniale des instruments de musique et des objets des musées réside autant dans leur matérialité, qu'il faut préserver, que dans les interactions et les pratiques culturelles dans lesquels ils sont ancrés. Pour certains, une dimension « performative » particulièrement forte peut exister, puisque l’objet est l’outil qui permet d’accomplir une action. Les instruments de musique, les véhicules, les horloges, les machines et les instruments scientifiques sont des exemples de ce type d'objets dont on ne comprend pleinement la fonction que lorsqu'ils sont joués ou actionnés.
Depuis des décennies, les politiques de conservation des musées tiennent compte de la nécessité de mettre en mouvement ces objets et du risque que cela peut représenter pour leur conservation. La mise en avant des différences et des points de rencontre qui existent entre les pratiques de plusieurs collections, musées et pays permettra de mieux comprendre les enjeux éthiques et techniques qui sont à l’origine de ces politiques.
Le colloque se tiendra en l'anglais. Une traduction simultanée de l'anglais vers le français est prévue.
Comité scientifique :
Frank P. Bär (CIMCIM)
Gabriele Rossi-Rognoni (CIMCIM)
Ech-cherki Dahmali (CIMUSET)
Juliette Raoul-Duval (CIMUSET)
Johanna Vähäpesola (CIMUSET)
Stéphane Vaiedelich (Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Thierry Maniguet (Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Marie-Pauline Martin (Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Emmanuel Hondré (Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Organisation :
Mathilde Thomas (Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Coproduction Philharmonie de Paris, International Council of Museums (ICOM), Comité international pour les musées et collections d'instruments et de musique (CIMCIM) et International Committee for museums and collections of science and technology (CIMUSET)
Lancement de l'antenne régionale AFROA
PROGRAMME
10h00 : Café d'accueil
10h30 : Présentation de l'AFROA et des antennes animée par des membres du
bureau de l'AFROA dont Claire Vasdeboncoeur
11h30 : Questions / Réponses
12h00 - 13h00 : Pause déjeuner
13h15 – 13h45 : Présentation du chantier de déménagement du Musée National du
Sport de Paris à Nice
14h – 15h15 : Visite des réserves avec Hélène Barbiero, responsable du Pôle
Collections du Musée National du Sport
15h30 – 16h : Présentation des chantiers actuels du musée en réserve et de ses
problématiques (conservation préventive des matériaux contemporains,
réaménagement des réserves, marquage et récolement, etc.)
ADRESSE
Musée National du Sport
Boulevard des Jardiniers
06200 Nice
Marchés publics en conservation-restauration. De la conception à l’exécution.
Cette journée d’étude se propose d’observer comment les prestations de conservation-
restauration sont définies et décomposées pour passer dans le filtre des marchés publics.
Ces retours d’expériences devront permettre d’analyser ce qui a été pertinent dans la
conception, de ce qu’il ne l’a pas été, confronté aux réalités du chantier, à travers plusieurs
types de marchés public, concernant plusieurs typologies de collections et des structures aux
fonctionnements variés. Le but de cette journée est d’en tirer des grandes lignes
d’enseignement pour améliorer les pratiques.
Pour mieux faire connaître cette diversité et améliorer les pratiques en se fondant sur des
retours d’expérience, le musée du quai Branly - Jacques Chirac et la Fédération
française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR) organisent une journée
de rencontres autour de ce thème.
Il est possible d’y assister gratuitement, dans la limite des places disponibles et sur
inscription auprès d’Éléonore Kissel.
La restitution des biens culturels
PROPOS
"La restitution des œuvres d’art est une question qui revient régulièrement dans la presse, le plus souvent à l’occasion de la rétrocession de biens spoliés durant la seconde guerre mondiale ou issus de pillages. Récemment, cette question a pris un tour et une ampleur inédits. La présidence de la République française a commandé un rapport sur la question de la restitution du patrimoine africain subsaharien à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. Ce rapport a relancé le débat par ses préconisations très radicales : restitution de toutes les collections dont les musées ne pourraient justifier provenir d’une cession librement consentie par son propriétaire
originel.
La constitution des collections et la circulation des biens culturels sont un immense champ de recherche. Les circonstances de l’acquisition de certaines œuvres peuvent apparaître contestables aujourd’hui alors qu’elles étaient licites autrefois. La circulation des biens culturels est encadrée par un corpus juridique important et complet. La restitution d’une œuvre intervient principalement lorsque l’on peut démontrer sa sortie illicite du territoire du pays d’origine (après 1970) ou sa provenance frauduleuse (vol ou spoliation).
Le colloque reviendra sur l’histoire des restitutions dans un cadre plus large que celui du seul art africain. Il abordera des cas qui ont eu lieu au sein d’un même pays ou entre des contrées étrangères, pour des biens allant de l’antiquité à la période contemporaine. La situation des spoliations nazies et des MNR sera observée avec attention, car elle représente un bon exemple du travail de recherche des provenances et des propriétaires de biens incontestablement volés. Enfin, la situation de l’art africain dans les musées européens sera largement analysée. Une présentation de l’histoire des collections permettra de montrer qu’elles ne sont pas toutes issues de pillages et que les problèmes qu’elles soulèvent méritent d’être traités avec nuances.
La question des restitutions et du rapport Savoy-Sarr n’est pas anodine pour nos sociétés. Elle renvoie directement à l’identité des musées et de notre rapport au reste du monde. Proposer de restituer toutes les collections d’art africain subsaharien en arguant qu’un musée n’a pas de légitimité à exposer autre chose que sa production nationale revient à tendre vers un dangereux isolationnisme intellectuel et un communautarisme bien éloigné des principes d’humanisme et d’universalité des musées."
Léonard de Vinci : l'expérience de l'art
L’exposition « Léonard de Vinci » au musée du Louvre et l’achèvement du projet
IPERION-CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure On Cultural Heritage) sont l’occasion de présenter à un large public les études, menées depuis une dizaine d’années par différentes institutions, des œuvres de l’artiste.
La journée sera consacrée à la présentation de ces résultats inédits, susceptibles de faire mieux comprendre la pratique singulière de Léonard de Vinci.
Comité d’organisation scientifique :
Vincent Delieuvin, musée du Louvre
Louis Frank, musée du Louvre
Michel Menu, C2RMF
Bruno Mottin, C2RMF
Élisabeth Ravaud, C2RMF
En collaboration avec le C2RMF, le CNRS, E-RIHS, IPERION-CH