
Recherche
Résultats de la recherche
2104 résultats trouvés
JIM2020 Musées pour l'égalité : diversité et inclusion
Chaque année depuis 1977, l’ICOM organise la Journée internationale des musées (JIM), événement qui représente un moment unique pour la communauté muséale internationale.
La Journée internationale des musées a pour objectif de sensibiliser la société civile au fait que « Les musées [sont un] moyen important d’échanges culturels, d’enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples. » Organisée le 18 mai ou autour de cette même date, les manifestations et activités prévues pour célébrer la Journée internationale des musées peuvent durer une journée, un week-end ou une semaine. La JIM a été célébrée pour la première fois il y a 40 ans. Son objectif est clair : diffuser l'idée que les musées sont un moyen important d’échanges culturels et d’enrichissement des cultures, et encourager la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre les peuples. La Journée internationale des musées fédère de plus en plus de musées à travers le monde. L’année dernière, plus de 37 000 musées ont participé à l’événement dans près de 156 pays.
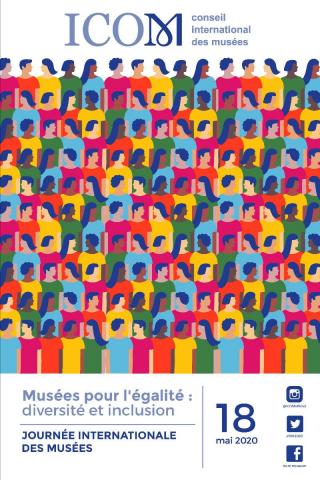
ICOM et ICOMOS condamnent toute destruction délibérée du patrimoine culturel
Dans les conflits armés et les bouleversements politiques depuis le début du millénaire, le patrimoine culturel est de plus en plus souvent pris pour cible. Il a été pillé ou délibérément détruit afin de financer la guerre ou d'affecter l'identité et la confiance des adversaires. Les musées ainsi que les sites culturels sont touchés dans de nombreux pays du monde.
Le Conseil international des musées (ICOM) et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), en tant que représentants de la communauté du patrimoine dans le monde, sont très préoccupés par cette évolution et les développements récents.
L'ICOM et l'ICOMOS rappellent à toutes les parties prenantes de conflits armés la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Dans cette Convention, les États parties reconnaissent que « les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ». Les États-Unis ont ratifié la Convention de La Haye en 2009, l’Iran en 1959.
Les deux pays sont également parties à la Convention du patrimoine mondial de 1972, que les États-Unis d'Amérique ont été le premier pays à ratifier en 1973 et ont joué un rôle clé dans sa promotion. L'Iran abrite 24 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO d'une grande importance culturelle et naturelle - non seulement pour les iraniens, mais aussi pour l'humanité et sa mémoire collective.
En outre, en 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 2347 qui stipule que : « lancer une attaque contre des sites et des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à la bienfaisance, ou contre des monuments historiques peut constituer, dans certaines circonstances et en vertu du droit international, un crime de guerre et que les auteurs de ce genre d’attaque doivent être traduits en justice ».
L'ICOM et l'ICOMOS condamnent conjointement et fermement toute destruction délibérée du patrimoine culturel. Nous appelons toutes les parties à respecter les accords internationaux qui régissent les conflits armés et à protéger le patrimoine culturel mondial où qu’il se trouve, quelles que soient les convictions religieuses ou les intentions politiques.
SITEM - édition 2020
Le SITEM : l'écosystème culturel et touristique rassemblé pendant 3 jours à Paris
Véritable catalyseur, le SITEM est un événement unique pour le monde des musées et du tourisme culturel.
Spécialistes de l’équipement, de la valorisation et de l'innovation des musées, des lieux de culture et de tourisme : l’ensemble des professionnels de l’écosystème culturel et touristique est rassemblé pendant trois jours à Paris, au Carrousel du Louvre.
ICOM France sera présent sur le stand n°S26.

Bourses de voyage pour la Conférence annuelle du CIMCIM 2020
La prochaine conférence annuelle du CIMCIM se tiendra du 6 au 10 septembre 2020 à Londres, et sera accueillie par le Royal College of Music Museum et le Horniman Museum & Gardens. Elle sera suivie d’une visite post-conférence du St. Cecilia’s Hall à Édimbourg. Ces trois musées ont récemment subi d'importants réaménagements, qui seront présentés par leurs équipes respectives.
Le sujet de la conférence annuelle est
"Beyond the Object and Back: the Role of Collections in Music Museums"
Le CIMCIM invite ses membres à faire une demande de bourse de voyage pour assister à la conférence CIMCIM 2020. Tous les candidats répondant aux critères d'éligibilité seront pris en compte : les candidats des catégories de pays 3 et 4 de l'ICOM et les membres "jeunes membres" (moins de 40 ans) sont particulièrement encouragés à postuler.
Pour plus d'informations sur les critères d'éligibilité et la procédure de candidature :
Contact : marie.martens[a]natmus.dk
Séminaire sur la gestion des parasites et des contaminations
Le 27 janvier 2020 se tiendra au Musée des arts décoratifs (107 rue de Rivoli - 75001 Paris) un séminaire sur la gestion des parasites et des contaminations organisé par l'ICM - Integrated Contamination Management.
Développer les liens entre réel et virtuel dans l'expérience visiteur
Le numérique s’est déployé de manière protéiforme au musée, faisant coexister réel et virtuel. Cette évolution offre un éventail de potentialités pour favoriser les interactions. Une exposition et ses discours peuvent trouver de nouvelles manières de diffuser des contenus à la fois au musée, dans l’espace public, sur Internet et les réseaux sociaux. Un objet de collection peut par exemple être enrichi de contenus accessibles en ligne via une tablette ou un téléphone. À la fois dispersés et immersifs, les applications de la réalité augmentée, applications mobiles et autres dispositifs équivalents de médiation impactent les formes d’accès aux savoirs – ceux des publics, mais aussi ceux des professionnels.
Comment les liens entre réel et virtuel se construisent-ils ? Quelle stratégie de narration transmédiatique adopter ? Avec quelle réception pour les publics et quel impact sur la relation entre le musée et les visiteurs ?
Cette formation dresse un panorama des formes d’interactions existantes entre réel et virtuel. Elle croise le regard d’acteurs de terrain et de chercheurs pour analyser les outils innovants mis en œuvre par des institutions muséales.
Objectifs de la formation
- définir l’articulation entre virtuel et réel sur la forme et le fond
- acquérir une méthodologie pour développer ces liens
- analyser l’impact sur l’expérience visiteur
Destinataires
Responsables de service des expositions, concepteurs d’exposition, responsables de la médiation, chargés de projet, chargés de l’action culturelle
Frais de participation
990 € incluant l’hébergement et la restauration
Femmes de verre, femmes de verrerie
Afin de célébrer avec tout l’éclat du verre le Cinquantième anniversaire de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2020), journée ayant pour thème « Je suis de la Génération Égalité », l’AMAVERRE (Aisne, France) et le Musée du Verre de Charleroi (Hainaut, Belgique) vous proposent d’assister au colloque international Femmes de verre, Femmes de verrerie qui se déroulera les 5 et 6 mars 2020 au Musée du Verre de Charleroi, site du Bois du Cazier à Marcinelle (Belgique). Tout en mêlant communications à caractère historique et témoignages vivants, il sera désormais possible de cerner la place occupée par la gente féminine en verrerie, monde que l’on disait pourtant réservé aux hommes. Le choix du titre est révélateur de la place occupée par les femmes dans le monde du verre. Très souvent, trop, elles apparaissent « transparentes » tel du verre quand il s’agit de parler de verrerie.
Car c’est bien d’un art industriel que nous partons, bien que doublement millénaire, pour gagner jusqu’à la création artistique actuelle. La présence des femmes dans l’art du verre a toujours été et demeure diverse et variée, et non simplement une histoire de relégation en seconde zone du travail du matériau.
L’approche résolument volontaire est multiple : femmes souffleuses à part entière, femmes artistes en verre, femmes à la direction d’établissements verriers, femmes qui ont influencé la création de modèles de verrerie, femmes en usines, mais aussi enseignantes, élèves, conservatrices… Parmi d’autres entrées fournissant matière dans le milieu verrier, au « bout chaud » comme au « bout froid » voire bien au-delà.
Le sens de l'objet

Retrouvez l’intégralité de la soirée-débat déontologie organisée sur le thème "Le sens de l'objet", par ICOM France et l’Institut national du patrimoine le 29 janvier 2020 :
"Médiations du passé : histoire, patrimoine, mémoire"
Le labex Les passés dans le présent et l'Université Paris Nanterre proposent une offre de formations courtes dans le cadre du diplôme universitaire Médiations du passé : histoire, patrimoine, mémoire, pour l’année 2020.
Les formations courtes Médiations du passé sont destinées aux professionnels de la culture et du patrimoine qui souhaiteraient concevoir et mettre en œuvre un projet de médiation culturelle et scientifique.
Elles s'appuient sur l'expérience croisée des chercheurs, enseignants-chercheurs, des conservateurs et des médiateurs impliqués dans les projets innovants de médiation numérique du Laboratoire d'excellence (LABEX) Les Passés dans le présent : http://passes-present.eu/
Chacun des modules, de deux ou trois jours, donne droit à une attestation de formation. Le suivi de l'ensemble des modules permet d'obtenir le diplôme universitaire (DU) Médiations du passé de l'Université Paris-Nanterre.
Sessions 2020 :
- Collecter et exposer les sources du passé : du 16 au 18 mars 2020 (3 jours)
- Le passé in situ : parcours urbains et ateliers de sensibilisation aux patrimoines : les 19 et 20 mars 2020 (2 jours)
- Concevoir un projet de médiation : du 22 au 24 juin 2020 (3 jours)
- Évaluer un projet de médiation : les 28 et 29 septembre 2020 (2 jours)
La décolonisation de la muséologie
À l'occasion du 43e symposium d'ICOFOM qui se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 2020 à Montréal (Québec, Canada), ICOFOM propose un colloque autour de deux thèmes inspirés par le processus de renouvellement de la définition du musée (ICOM – Kyoto 2019) et des grandes tendances qui contribuent à transformer les musées (Mairesse, 2015 et 2016). Ces deux thèmes centraux soulèvent de nombreuses interrogations sur la mission première du musée. La décolonisation est au cœur de la remise en question fondamentale de la fonction sociale du musée. Conséquemment, ce sont les discours, voire les mythes d’origine des nations, qui sont contestés.
Communautés culturelles et « Premières Nations »
Plus que jamais, la question de la représentation des communautés culturelles et autochtones dans les musées fait débat. Il en est de même de la délicate question de la restitution des œuvres d’art et des collections aux communautés d’origine (Sarr et Savoy, 2018).
Quelle place les musées accordent-ils à la culture des communautés culturelles et des premières nations dans les collections nationales et dans les expositions de synthèse consacrées aux grands récits nationaux ?
Jusqu’où doivent aller les musées dans la décolonisation ?
« Un musée (…) ouvert au public du champ social, se réinventant sans cesse, développant des partenariats (…) » (Eidelman, 2017, p. 88), le fait-il par la consultation avec les partenaires des différentes communautés culturelles ou des Premières Nations ?
Par des partenariats dans la prise de décision relativement à des expositions les concernant ?
Par une représentation au sein des conseils d’administration des musées ?
Décolonisation
Dans la perspective de la nouvelle proposition de définition du musée présentée à Kyoto, les musées s’engagent-ils dans un dialogue critique sur le passé et l’avenir des nations et des communautés? Les musées envisagent-ils la voie de la décolonisation ou entretiennent-ils encore les mythes de sociétés homogènes ? Conséquemment, quelles sont les responsabilités des musées à l’égard de ces grandes tendances internationales ?
Mythes d’origine
Au Canada, comme dans de nombreux pays, la décolonisation pose la question de l’origine d’un pays et de sa propre culture. Cette problématique apparaît fondamentale dans les expositions de synthèses des musées nationaux qui proposent des récits donnant un sens aux mythes d’origine des nations (Bouchard, 2014; Lévi-Strauss, 2001) que l’on associe également aux mythes d’identification qui participent à la construction des identités collectives. Ainsi, jusqu’au début du XXIe siècle, les musées canadiens proposaient une histoire nationale qui débutait avec la découverte de l’Amérique par les Européens au XVIe siècle. La période de contacts entre l’Ancien et le Nouveau Monde devenant alors le point zéro de l’histoire et de la culture. Cependant, peut-on ignorer que les peuples autochtones, venus d’Asie, ont parcouru, occupé et transformé le territoire nord-américain pendant des millénaires avant l’arrivée des Européens ? Ces divers points de vue sont visibles dans les musées nationaux canadiens, mais il a fallu des actions d’éclat de la part de Premières Nations pour que les musées nationaux prennent conscience de la décolonisation et que les associations muséales et les gouvernements s’impliquent (Phillips, 2011; Clifford, 2013; Sleeper-Smith, 2009). En est-il toujours ainsi dans presque toutes les cultures dominantes ?
Se donner son propre musée
Les grands musées canadiens ont choisi au cours de la dernière décennie de revisiter l’histoire et la place des Autochtones dans les expositions permanentes consacrées à l’histoire du Canada. Démarche délicate dont peuvent témoigner les équipes de plusieurs musées (Kaine, 2016). Parallèlement à ce mouvement, les communautés autochtones ont commencé à se donner leurs propres musées afin de livrer leur version de l’histoire nord-américaine. Les communautés culturelles pourraient-elles emprunter cette voie ? N’y aurait-il pas, au final, un risque de ghettoïsation des cultures ? Comment équilibrer le retour des objets détenus par les musées nationaux avec leur devoir de fiduciaire envers la société civile qu’ils servent ? Le biculturalisme du Musée Te Papa Tongarewa (McCarthy, 2007; Ross, 2013) en Nouvelle-Zélande constitue-t-il un modèle exportable ? Jusqu’où ?
Métissages et hybridations
En Amérique comme ailleurs dans le monde, l’histoire culturelle est faite de métissages et d’hybridations (Turgeon, 2003), s’opposant fondamentalement à l’idée même d’homogénéité des cultures. Les musées n’ont-ils pas tendance à opposer la pureté des origines au concept d’allochtonie qui désigne ce qui n’est pas originaire d’un pays. Mais la réalité des musées est plus complexe que cette opposition binaire, les objets comme les récits au cœur des institutions muselles témoignent du métissage des cultures. Quelles sont les responsabilités des musées à l’égard de ces questions d’interprétation de l’histoire ? En somme, de quelles mémoires les musées témoignent-ils ? L’hybridation est un choix éthique autant qu'esthétique (Morin, 2016), pour privilégier la rencontre entre les peuples et entre les cultures. Elle ouvre la voie à une interculturalité créatrice. Les musées sont des lieux de diplomatie culturelle. Comment peuvent-ils participer à cette hybridation ?
Patrimoine culturel immatériel
Si le projet culturel, social et scientifique des musées consiste à témoigner de l’histoire « matérielle et immatérielle de l’Homme et de son environnement. », les musées ont longtemps fait l’impasse de l’histoire des premières nations (Ames, 1992; Phillips, 2011). De plus, les Premières Nations ont une conception toute autre de l’objet culturel que celle que retient traditionnellement un musée qui les possède (Clavir, 2002). On ne dira jamais assez le pouvoir de l’écriture qui permet d’affirmer l’autorité et l’appropriation. Chez les Premières Nations, l’histoire est longtemps restée orale et la culture s’exprime, comme l’a bien démontré Claude Lévi-Strauss, à travers des récits mythiques qui relèvent du patrimoine culturel immatériel.
La reconnaissance des communautés culturelles et des cultures autochtones se révèlent d’une grande actualité. Quelle place les musées doivent-ils leur accorder dans les musées nationaux? Les musées doivent-ils répondre aux demandes des premières nations et des communautés culturelles en aliénant et en restituant les objets qui les concernent ? Comment les musées doivent-ils interpréter la contribution des diverses communautés culturelles à la culture nationale ? Bref, ces questions qui pourraient sembler propres aux musées nord-américains se posent de manière universelle dans tous les pays. Ce sont les questions que nous proposons pour le symposium d’ICOFOM en 2020.
Modalités de soumission
Les articles, présentés sous une forme brève, sont attendus avant la conférence, seront rassemblés, mis en page et distribués avant celle-ci, et discutés en ateliers durant la conférence.
Les contributions, très synthétiques (12.000 signes maximum, notes et références comprises comme précisé dans notre directive) seront envoyées pour le 19 avril 2020 (au plus tard) à l’adresse suivante :
Ils respecteront les règles de mise en page d’ICOFOM. Les propositions devront intégrer l’un des axes d’analyse proposés. Elles seront écrites dans une des trois langues de l’ICOM (anglais, français, espagnol). La validation des propositions sera donnée dans les deux semaines suivantes.
Les textes colligés et mis en page seront envoyés à l’ensemble auteurs et des participants au colloque, en version électronique, durant le mois de septembre 2020.
Une sélection des contributions écrites sera opérée par les éditeurs, après le colloque, avec le bureau d’ICOFOM, qui seront invités à développer leurs articles dans un format plus long, en vue d’une publication dans ICOFOM Study Series, après un processus de révision par peer review.

